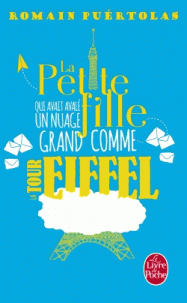 Avant même la réédition en poche, cette semaine, de son deuxième roman, La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel,
l’auteur de L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans
une armoire Ikea en a publié un troisième, Re-vive
l’Empereur. Arrêtons-nous sur le format de poche, avec un entretien
réalisé il y a un peu plus d’un an.
Dans son premier roman, sous couvert de fantaisie, Romain
Puértolas abordait les problèmes des sans-papiers et la question de
l’immigration clandestine pour raisons économiques. La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel
a les poumons envahis par une sale maladie, qui se soigne encore plus mal à Marrakech
qu’en France. Mais Zahera garde une chance de guérir : Providence, qui est
factrice, est en route pour venir la chercher et la confier aux meilleurs
médecins. Sinon que, le jour de son départ, les avions ne décollent pas. La
faute à un foutu volcan islandais.
L’histoire est racontée par un coiffeur à un de ses clients,
les niveaux de narration s’imbriquent comme dans un conte oriental et le
lecteur plane par-dessus avec un bonheur constant. Comme Providence planera
au-dessus des nuages… Mais impossible de raconter en quelques mots comment elle
y parviendra. L’écrivain s’amuse à un itinéraire capricieux qui requiert une
assistance technique très supérieure à celle de n’importe quelle assurance de
voyage.
On rit beaucoup. On tremble un peu. C’est ce que Romain
Puértolas appelle sa marque de fabrique, et il s’en sert comme un fildefériste
de son balancier.
Quand nous avions
parlé du Fakir, vous m’aviez dit que
le roman suivant était prêt et que votre éditeur l’aimait beaucoup. C’était
celui-ci ?
Oui, il était écrit
avant la sortie du Fakir et j’ai eu
un an pour modifier quelques petites choses, en ajouter d’autres, pour
fignoler.
Vous l’avez donc
écrit sans pression, puisque c’était avant le succès ?
En effet. Je sens un
peu plus la pression pour le livre que je suis en train d’écrire. Quand on a
des lecteurs, on se demande si ça plaira ou non. Mais je fais ce que j’aime et
les autres livres ne seront pas le Fakir.
A l’exception de la suite du Fakir
que je suis en train d’écrire.
Quelle distance y
a-t-il entre le premier et le deuxième roman ?
Il y a des
ressemblances et des différences. Je voulais une marque de fabrique. Elle tient
à l’universalité, parce que j’aime parler de personnages de différentes
cultures. C’est un peu le monde Benetton. Moi-même, je parle plusieurs langues
et j’ai vécu dans plusieurs pays. Il y a aussi, en toile de fond, un sujet plus
sérieux que la forme, celle-ci étant humoristique, décalée. Une troisième
constante est l’optimisme. Je suis né heureux et j’ai toujours été heureux malgré
les difficultés. Un « happyculteur », comme je dis. Une différence
réside dans le fait que, dans ce livre, j’ai été poétique et dans l’émotion.
Vers la fin du roman,
on perd les points de repère qu’on croyait bien installés. Est-ce
conscient ?
J’avais d’abord écrit
le livre sans ce coup de théâtre, et puis je me suis dit que ce serait bien.
Dans ce que j’écris maintenant, j’y prends goût. Je trouve que ça redonne vie à
l’histoire. C’est un peu comme, en mangeant un plat, un nouveau goût, une
nouvelle saveur qui éclate sur le palais à la fin. Retourner l’omelette, comme
on dit en Espagne.
Peut-on dire que le
premier roman avait été écrit sans se poser de questions sur le fonctionnement
du récit, et qu’il y a une évolution sur ce plan dans le deuxième ?
Oui, avant j’écrivais
de manière linéaire, une chose en entraînant une autre comme dans le Fakir qui est une chaîne de rebondissements. A
présent, j’avance dans le travail de la structure.
Sans crainte de
perdre la spontanéité ?
Non. De toute façon,
les idées me viennent sans que je les cherche. Et j’écris vite : j’ai mis
deux semaines et demie pour celui-ci.
Sous une forme
poétique et drôle, vous abordez un sujet grave, la mucoviscidose. Comment
est-ce arrivé ?
Je ne sais pas du
tout, je me le demande parfois. On pourrait d’ailleurs remplacer la
mucoviscidose par n’importe quelle maladie, le cancer par exemple. Je voulais
aborder ce thème : quand on est malade, tant qu’on est vivant, il y a
toujours de l’espoir. Peut-être que j’ai vu un jour Grégory Lemarchal à la
télé. La fin de sa vie m’a beaucoup touché.
Le récit est mené à
un rythme soutenu, à travers notamment les dialogues. Est-ce volontaire ?
C’est peut-être mon
oreille musicale. J’ai été compositeur pendant des années et les mots me
viennent comme une musique et un rythme, ce qui me conduit quelquefois à
changer leur ordre.
Savez-vous combien
d’exemplaires du Fakir ont été
vendus ?
Dans le monde, un
demi-million, dont trois cent mille en France.
Avez-vous
l’explication de ce succès ?
Avant même la réédition en poche, cette semaine, de son deuxième roman, La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel,
l’auteur de L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans
une armoire Ikea en a publié un troisième, Re-vive
l’Empereur. Arrêtons-nous sur le format de poche, avec un entretien
réalisé il y a un peu plus d’un an.
Dans son premier roman, sous couvert de fantaisie, Romain
Puértolas abordait les problèmes des sans-papiers et la question de
l’immigration clandestine pour raisons économiques. La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel
a les poumons envahis par une sale maladie, qui se soigne encore plus mal à Marrakech
qu’en France. Mais Zahera garde une chance de guérir : Providence, qui est
factrice, est en route pour venir la chercher et la confier aux meilleurs
médecins. Sinon que, le jour de son départ, les avions ne décollent pas. La
faute à un foutu volcan islandais.
L’histoire est racontée par un coiffeur à un de ses clients,
les niveaux de narration s’imbriquent comme dans un conte oriental et le
lecteur plane par-dessus avec un bonheur constant. Comme Providence planera
au-dessus des nuages… Mais impossible de raconter en quelques mots comment elle
y parviendra. L’écrivain s’amuse à un itinéraire capricieux qui requiert une
assistance technique très supérieure à celle de n’importe quelle assurance de
voyage.
On rit beaucoup. On tremble un peu. C’est ce que Romain
Puértolas appelle sa marque de fabrique, et il s’en sert comme un fildefériste
de son balancier.
Quand nous avions
parlé du Fakir, vous m’aviez dit que
le roman suivant était prêt et que votre éditeur l’aimait beaucoup. C’était
celui-ci ?
Oui, il était écrit
avant la sortie du Fakir et j’ai eu
un an pour modifier quelques petites choses, en ajouter d’autres, pour
fignoler.
Vous l’avez donc
écrit sans pression, puisque c’était avant le succès ?
En effet. Je sens un
peu plus la pression pour le livre que je suis en train d’écrire. Quand on a
des lecteurs, on se demande si ça plaira ou non. Mais je fais ce que j’aime et
les autres livres ne seront pas le Fakir.
A l’exception de la suite du Fakir
que je suis en train d’écrire.
Quelle distance y
a-t-il entre le premier et le deuxième roman ?
Il y a des
ressemblances et des différences. Je voulais une marque de fabrique. Elle tient
à l’universalité, parce que j’aime parler de personnages de différentes
cultures. C’est un peu le monde Benetton. Moi-même, je parle plusieurs langues
et j’ai vécu dans plusieurs pays. Il y a aussi, en toile de fond, un sujet plus
sérieux que la forme, celle-ci étant humoristique, décalée. Une troisième
constante est l’optimisme. Je suis né heureux et j’ai toujours été heureux malgré
les difficultés. Un « happyculteur », comme je dis. Une différence
réside dans le fait que, dans ce livre, j’ai été poétique et dans l’émotion.
Vers la fin du roman,
on perd les points de repère qu’on croyait bien installés. Est-ce
conscient ?
J’avais d’abord écrit
le livre sans ce coup de théâtre, et puis je me suis dit que ce serait bien.
Dans ce que j’écris maintenant, j’y prends goût. Je trouve que ça redonne vie à
l’histoire. C’est un peu comme, en mangeant un plat, un nouveau goût, une
nouvelle saveur qui éclate sur le palais à la fin. Retourner l’omelette, comme
on dit en Espagne.
Peut-on dire que le
premier roman avait été écrit sans se poser de questions sur le fonctionnement
du récit, et qu’il y a une évolution sur ce plan dans le deuxième ?
Oui, avant j’écrivais
de manière linéaire, une chose en entraînant une autre comme dans le Fakir qui est une chaîne de rebondissements. A
présent, j’avance dans le travail de la structure.
Sans crainte de
perdre la spontanéité ?
Non. De toute façon,
les idées me viennent sans que je les cherche. Et j’écris vite : j’ai mis
deux semaines et demie pour celui-ci.
Sous une forme
poétique et drôle, vous abordez un sujet grave, la mucoviscidose. Comment
est-ce arrivé ?
Je ne sais pas du
tout, je me le demande parfois. On pourrait d’ailleurs remplacer la
mucoviscidose par n’importe quelle maladie, le cancer par exemple. Je voulais
aborder ce thème : quand on est malade, tant qu’on est vivant, il y a
toujours de l’espoir. Peut-être que j’ai vu un jour Grégory Lemarchal à la
télé. La fin de sa vie m’a beaucoup touché.
Le récit est mené à
un rythme soutenu, à travers notamment les dialogues. Est-ce volontaire ?
C’est peut-être mon
oreille musicale. J’ai été compositeur pendant des années et les mots me
viennent comme une musique et un rythme, ce qui me conduit quelquefois à
changer leur ordre.
Savez-vous combien
d’exemplaires du Fakir ont été
vendus ?
Dans le monde, un
demi-million, dont trois cent mille en France.
Avez-vous
l’explication de ce succès ?Non, cela a été une énorme surprise. Je ne me retrouve pas dans la littérature française d’aujourd’hui et je ne croyais pas que le livre pouvait marcher en France.
