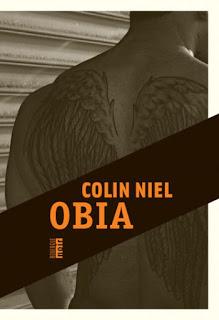 C'est le troisième polar que publie Colin Niel. C'est par celui ci que je découvre son écriture. Comme pour les deux premiers, Les hamacs de carton et Ceux qui restent en forêt, l’auteur a planté le décor d’Obia en Guyane. Avec des personnages récurrents, comme le lieutenant Vacaresse, qui a besoin d’enquêter pour exister, et oublier la tornade qui s'était abattue sur sa famille (p. 49), et le capitaine Anato, le ndjuka, qui y démêle cette fois les fils d’une affaire de trafic de drogue sur fond de mémoire de la guerre civile du Surinam dans les années 1975.
C'est le troisième polar que publie Colin Niel. C'est par celui ci que je découvre son écriture. Comme pour les deux premiers, Les hamacs de carton et Ceux qui restent en forêt, l’auteur a planté le décor d’Obia en Guyane. Avec des personnages récurrents, comme le lieutenant Vacaresse, qui a besoin d’enquêter pour exister, et oublier la tornade qui s'était abattue sur sa famille (p. 49), et le capitaine Anato, le ndjuka, qui y démêle cette fois les fils d’une affaire de trafic de drogue sur fond de mémoire de la guerre civile du Surinam dans les années 1975.Je ne connaissais pas du tout cet épisode tragique de l'histoire et je comprends qu’il ait pensé qu’il fallait mettre un coup de projecteur dessus. Il y consacre l’essentiel de la seconde partie du roman (p.191 et suivantes), alors que le lecteur commence à penser qu’il a enfin compris l’intrigue policière.
La Guyane néerlandaise a connu cent ans de guerre contre les esclaves évadés. Et ce sont près de 10 000 surinamiens qui sont arrivés sur le territoire français après 1986. La situation que connait actuellement la région de Calais prend soudainement un autre relief. On devine qu’aider les premiers réfugiés fut possible mais qu’ensuite tout le monde a été comme débordé. D’autant que dans le même temps la France adoptait des lois contre l’immigration clandestine.
En dehors du rappel historique, Colin Niel décrit la vie dans cette région où il a vécu et que nous connaissons très mal, si bien qu’on a pu qualifier son écriture d’ethnopolar. Des mots inhabituels fleurissent au fil des pages comme tchiper (claquer des lèvres), jober (vivre d’un petit boulot), carbet (hangar servant d’habitation), babylone (force de l’ordre), noir-marron (descendant direct des esclaves qui s’échappèrent des plantations de l’actuel Suriname, ancienne colonie hollandaise au temps de la traite négrière, et reconnus libres par traité de paix à partir de 1760), piaille (objet censé provoquer un envoutement), dolos (proverbes) qui surgissent, fort heureusement traduits. Par exemple Chans zwa à pas chans kanna. La chance de l'oie n'est pas celle du canard (p.28).
En toute logique plusieurs de ses personnages veulent une belle vie pour leur enfant, comme Clifton qui, à l’instar de nombre de guyanais voit dans le transport de la cocaïne la solution économique et radicale à ses soucis. Malheureusement la Guyane souffre de trop de maux, immigration, chômage, économie, démographie, et l’auteur brosse un triste tableau de la jeunesse (masculine) de cette région du Bas-Maroni.
Les croyances populaires sont vivaces. La magie et la religion exercent un poids colossal qui, ajouté aux trafics, laissent peu de place à la liberté de pensée telle qu’on la connait en métropole.
Colin Niel accorde une place particulière à l’obia, une plante qui est aussi bien utilisée en décoction pour baigner les jeunes enfants (p. 30 en guise de protection que pour les adultes dont elle assurerait l’invulnérabilité même contre les balles réelles. L’obia est aussi le nom du rituel et d’un esprit qui garantirait une chance absolue.
Il faut lire son livre pour comprendre qu’en Guyane il n’y a que la rumeur qui court, la forêt qui est vierge, le bois qui travaille et les miroirs qui réfléchissent (p.41).
Obia de Colin Niel, collection Noir aux éditions du Rouergue
Livre chroniqué dans le cadre du Prix 2016 des lecteurs d'Antony
 En compétition dans la catégorie Polars avec Prendre Lilyde Marie Neuser, Les enfants de l'eau noire de Joe R. Lansdale, Obia de Colin Niel, L'enfer de Church Street de Jake Hinkson, et Les brillants de Marcus Sakey.
En compétition dans la catégorie Polars avec Prendre Lilyde Marie Neuser, Les enfants de l'eau noire de Joe R. Lansdale, Obia de Colin Niel, L'enfer de Church Street de Jake Hinkson, et Les brillants de Marcus Sakey.Colin Niel est invité le samedi 6 février à 16h à l’Espace Vasarely d'Antony (92) avec deux autres auteurs de romans sélectionnés pour le Prix.

