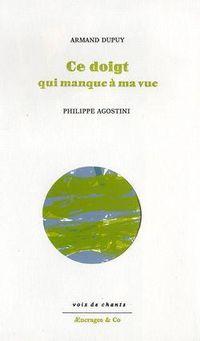 Armand Dupuy a jusqu’à présent beaucoup écrit « sur » la peinture (cf. ses textes sur Jérémy Liron et Jean-Marc Scanreigh, par exemple) et ses poèmes ont souvent accompagné des œuvres peints (on pourrait dire aussi l’inverse : le travail d’Aaron Clarke s’est souvent mêlé aux mots des poètes). Ici, il semble bien qu’il écrive « avec » la peinture (le livre se clôt sur « je touche avec »), ou même qu’il y plonge. Des premières pages (« ce faux bateau qu’on / habite // avec la tête encore / on flotte à peine ») aux dernières (« emballer ma tête / et sombrer »), de nombreux verbes évoquent en effet le vœu de « s’enfoncer mieux ».
Armand Dupuy a jusqu’à présent beaucoup écrit « sur » la peinture (cf. ses textes sur Jérémy Liron et Jean-Marc Scanreigh, par exemple) et ses poèmes ont souvent accompagné des œuvres peints (on pourrait dire aussi l’inverse : le travail d’Aaron Clarke s’est souvent mêlé aux mots des poètes). Ici, il semble bien qu’il écrive « avec » la peinture (le livre se clôt sur « je touche avec »), ou même qu’il y plonge. Des premières pages (« ce faux bateau qu’on / habite // avec la tête encore / on flotte à peine ») aux dernières (« emballer ma tête / et sombrer »), de nombreux verbes évoquent en effet le vœu de « s’enfoncer mieux ».
La première section du livre situe d’emblée l’enjeu : « tu poses du vert / pour salir pour exister ». Il s’agira dès lors de « march(er) vers ce vert // à travers la phrase », c’est-à-dire de faire des mots l’équivalent de la couleur pour le peintre, une matière qui se travaille, s’expérimente, et dans laquelle s’immerger. La prégnance des séries prosodiques, des multiples allitérations et assonances dans ces pages, comme par exemple : « je me tais / marchant sur l’herbe / ou les planches // nous mâchons d’une / seule bouche / muette » (je souligne les reprises consonantiques, mais il faudrait souligner tous les mots ici !) ou « avancer ça / sac sur les bras », constitue toute une matière sonore qui est une façon de rendre le « tu penses en pinceau » du peintre.
De même, ce long poème qu’est le livre entier (ou du moins « cette / phrase un peu longue » qu’est la première section), dans son rapport à la peinture, et singulièrement à celle de Philippe Agostini qui accompagne le texte, semble tenter de capter l’en-deçà ou l’au-delà de l’image. Car, plus que la forme décelable ou la figure peinte, compte pour lui ce moment où celles-ci lèvent ou s’évanouissent (« monter l’image // puis froisser les murs ») ; il faut « non pas voir // mais traverser ma figure (…) / comme si l’on / pouvait détacher / ces images ». Et, d’abord tenu comme à la lisière du rêve (« je ne dors pas / j’assiste à l’effondrement / des masses »), le poème n’hésite pas à « verser dans le sommeil ». C’est dire encore l’importance de l’immersion !
De plongée, il en est aussi question dans la seconde section, précisément intitulée « En mer » et dédiée au peintre Georges Badin. Ecrit à Sète (durant le festival de poésie), le poème rejoue à sa manière « Le cimetière marin ». Mais, là encore, il s’agit moins de contempler les eaux que d’aller « sous ce bleu / niais » (car « l’eau mime (…) // plus bas / répète » et « le bleu s’enfonce / en lui-même // (…) récite // cet enfoncement »), moins de « voir » la mer que de la « toucher », en somme moins de la dire que de la faire – et faire la mer (on y entend une forte paronomase !), c’est un beau programme pour un poème ! C’est pourquoi les « yeux » sont si souvent reliés à la « main » : dans le titre de l’ouvrage bien sûr, répété deux fois dans le corps du texte (une fois dans chaque section), mais également dans un passage comme « les mains / dans la vache / dans les yeux », ou encore, de manière implicite, dans : « une mer / les yeux touche / l’autre ». Voir, toucher, plonger, voilà les gestes du poème d’André Dupuy.
Au fond (comme ce connecteur tombe ici à propos !), s’il insiste autant sur le toucher, sur le contact physique, sur le rapport du corps à la matière et sur l’immersion (dans la peinture, dans la mer, dans le réel…), c’est qu’il veut mettre en avant l’expérience de dessaisissement que permettent les mots, et qu’il en va de la question du sujet dans et par le poème. Quand il affirme : « je m’évacue // tu / n’es pas toi ni moi », sans doute cherche-t-il ce « tu » insoupçonné du lecteur, cet autre que la lecture façonne et transforme, ce sujet qui donnera au « je » du poème d’être lui-même sujet – cette autre main chère à Paul Celan qui est un autre nom de « ce doigt qui manque à ma vue ».
Yann Miralles
Armand Dupuy, Ce doigt qui manque à ma vue, Dessins de Philippe Agostini, AEncrages & Co, non paginé, 18 €

