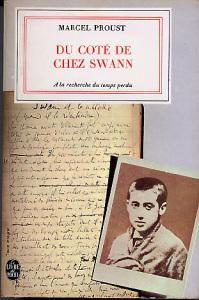 Ça doit faire pas loin de vingt ans que je me dis chaque année « Et si je me mettais enfin à lire Proust ? » et que je me réponds à chaque fois « Oh, non, je ne suis pas encore assez mûre ! ». Je ne sais pas trop ce qui me faisait si peur dans Proust, ce qui m’intimidait autant, mais je crois que sa réputation d’auteur aux « interminables phrases », au style excessivement subtil, et aux préoccupations exclusivement mondaines me donnait des boutons rien qu’à les imaginer.
Ça doit faire pas loin de vingt ans que je me dis chaque année « Et si je me mettais enfin à lire Proust ? » et que je me réponds à chaque fois « Oh, non, je ne suis pas encore assez mûre ! ». Je ne sais pas trop ce qui me faisait si peur dans Proust, ce qui m’intimidait autant, mais je crois que sa réputation d’auteur aux « interminables phrases », au style excessivement subtil, et aux préoccupations exclusivement mondaines me donnait des boutons rien qu’à les imaginer.
Finalement, 2016 aura été l’année propice pour sauter le pas et je m’en félicite car c’est une magnifique découverte qui, à mon avis, restera unique et inoubliable.
Déjà, je voudrais tordre le cou aux préjugés et aux clichés qui entourent l’œuvre proustienne : ses phrases sont assez longues, c’est vrai, mais pas interminables, et j’ai déjà lu des écrivains, anciens ou contemporains, aux phrases beaucoup plus longues que les siennes (Jérôme Ferrari par exemple, pour ne citer que lui). Par ailleurs, il m’a semblé que la phrase proustienne ne faisait pas d’excès de subtilités ou de raffinements abscons (comme je l’imaginais) mais qu’elle est au contraire précise et éclairante. Certes, la lecture de Proust demande du calme et de la concentration, mais je trouve qu’on entre assez facilement dans son monde, dans ses descriptions (qui sont toutes plus magnifiques les unes que les autres, et je le dis d’autant plus facilement que, d’habitude, je n’adore pas les longues descriptions), dans ses analyses psychologiques ou introspectives d’une intelligence remarquable et souvent teintées d’un humour irrésistible. Par ailleurs, je dois en être actuellement autour de la page 280 et je n’ai croisé jusqu’à présent qu’une seule duchesse (Madame de Guermantes) qui n’a d’ailleurs occupé que deux ou trois pages et qui a disparu bien vite : ce n’est donc pas, contrairement à ce que j’imaginais, une succession de tableaux mondains et de discussions de salons entre baronnes et comtesses, ce qui m’aurait grandement ennuyée !
Non, bien loin de ce que j’imaginais, ce sont des souvenirs d’enfance, une tante plus ou moins neurasthénique et hypocondriaque dans la maison de laquelle on découvre le monde et les caractères de quelques personnages marquants, certains provinciaux qui ne sont pas sans évoquer Balzac, certains qui appartiennent à la famille du narrateur et dont l’autorité est source de craintes et de souffrances – une maison dans laquelle on découvre aussi la littérature, le plaisir d’écrire, les premiers élans amoureux, les beautés de la nature.
Le narrateur découvre le monde et les caractères, c’est-à-dire, aussi, la mesquinerie et la cruauté, et même si l’auteur n’insiste pas excessivement sur ces aspects.
On découvre un narrateur sensible, introverti, désespérément attaché à sa mère, et qui se désole à l’idée qu’il ne deviendra jamais écrivain parce qu’il « n’a pas d’idées ». Il lit avec passion les romans d’un certain Bergotte, auteur qu’il admire et qu’il brûle de rencontrer pour connaître son avis sur toutes les questions qui le préoccupent.
C’est aussi une sorte d’ode à la sensualité : plaisirs de la vue dans les jardins d’aubépine, plaisirs de l’odorat dans la maison et la chambre de la tante, plaisirs du goût grâce à la cuisine raffinée de la bonne Françoise, si bien décrits que le lecteur en perçoit aussitôt les effluves et les nuances.
Ce roman est à la fois un plaisir pour l’esprit et pour tous les sens !
