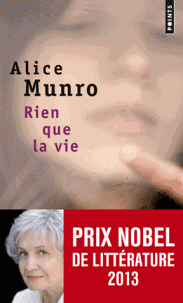 Un an avant son Nobel de littérature, Alice Munro avait
publié ce qui est, à ce jour, son dernier recueil de nouvelles. Il nous est
arrivé en français un an après sa consécration et vient d’être réédité au
format de poche. Rien que la vie
rassemble quatorze nouvelles dont les quatre dernières contrastent avec la
tonalité générale de son œuvre. On pourrait commencer par là.
« Je crois
qu’elles sont les premières et dernières choses – et aussi les plus
proches – que j’aie à dire de ma propre vie », écrit Alice Munro
dans quelques lignes de présentation. Elles se situent dans l’enfance et
l’adolescence. La complicité avec Sadie, qui aide sa mère, et la mort de la
jeune fille. Le démon de la haine qui lui donne envie de tuer sa sœur, et
comment son père l’en libère. Une séance de danse avortée, parce que sa mère ne
supporte pas la présence d’une ancienne prostituée. Et, dans la nouvelle qui
donne son titre au recueil, la sourde menace représentée par une voisine qui a
habité la maison de la narratrice, découverte faite plus tard.
Surgis du lointain, ces souvenirs ne procèdent pas des
constructions complexes mises en place habituellement par Alice Munro. Mais,
sans atteindre la densité, qui lui est coutumière, de romans brefs, ils ouvrent
des pistes de compréhension et des interrogations sur sa manière d’appréhender
le monde des humains.
Cette manière, toute de finesse, fait le lien entre le
« finale » de l’ouvrage et les dix premières nouvelles. Les êtres
trouvent leur place dans le jeu habile de la vie en société, comparable dans
certaines situations à la vie de couple. Par deux fois, dans « Jusqu’au
Japon » et dans « Dolly », un homme et une femme sont si
complices que toute explication entre eux est superflue. Elle leur semblerait
porter atteinte à la perfection de leurs liens. Pourtant, cela n’empêche pas
les dérapages, comme, précisément, dans une société où des failles discrètes
menacent de s’agrandir jusqu’à devenir des gouffres.
Plusieurs nouvelles sont situées pendant la Seconde Guerre
mondiale ou dans les années qui la suivent. L’époque est difficile, mais moins
qu’en Grande-Bretagne où une femme a essayé de s’installer sans réussir à s’y
acclimater.
C’est aussi le temps où on ne soigne la tuberculose que dans
un sanatorium, et par des interventions chirurgicales périlleuses. Vivien Cash,
engagée comme enseignante dans un sanatorium, ne tarde pas à être séduite par
le médecin de l’endroit. Qui lui laisse entrevoir un mariage, dès qu’il aura
deux jours de congé. Ils iront même jusqu’à la ville où doit se dérouler, avec
discrétion, la cérémonie officielle. Elle n’aura cependant pas lieu, comme
Vivien le comprend quelques instants plus tôt, lors d’une conversation, dans la
voiture, perturbée par un problème de parking, symbole minuscule d’un problème
plus profond.
Un an avant son Nobel de littérature, Alice Munro avait
publié ce qui est, à ce jour, son dernier recueil de nouvelles. Il nous est
arrivé en français un an après sa consécration et vient d’être réédité au
format de poche. Rien que la vie
rassemble quatorze nouvelles dont les quatre dernières contrastent avec la
tonalité générale de son œuvre. On pourrait commencer par là.
« Je crois
qu’elles sont les premières et dernières choses – et aussi les plus
proches – que j’aie à dire de ma propre vie », écrit Alice Munro
dans quelques lignes de présentation. Elles se situent dans l’enfance et
l’adolescence. La complicité avec Sadie, qui aide sa mère, et la mort de la
jeune fille. Le démon de la haine qui lui donne envie de tuer sa sœur, et
comment son père l’en libère. Une séance de danse avortée, parce que sa mère ne
supporte pas la présence d’une ancienne prostituée. Et, dans la nouvelle qui
donne son titre au recueil, la sourde menace représentée par une voisine qui a
habité la maison de la narratrice, découverte faite plus tard.
Surgis du lointain, ces souvenirs ne procèdent pas des
constructions complexes mises en place habituellement par Alice Munro. Mais,
sans atteindre la densité, qui lui est coutumière, de romans brefs, ils ouvrent
des pistes de compréhension et des interrogations sur sa manière d’appréhender
le monde des humains.
Cette manière, toute de finesse, fait le lien entre le
« finale » de l’ouvrage et les dix premières nouvelles. Les êtres
trouvent leur place dans le jeu habile de la vie en société, comparable dans
certaines situations à la vie de couple. Par deux fois, dans « Jusqu’au
Japon » et dans « Dolly », un homme et une femme sont si
complices que toute explication entre eux est superflue. Elle leur semblerait
porter atteinte à la perfection de leurs liens. Pourtant, cela n’empêche pas
les dérapages, comme, précisément, dans une société où des failles discrètes
menacent de s’agrandir jusqu’à devenir des gouffres.
Plusieurs nouvelles sont situées pendant la Seconde Guerre
mondiale ou dans les années qui la suivent. L’époque est difficile, mais moins
qu’en Grande-Bretagne où une femme a essayé de s’installer sans réussir à s’y
acclimater.
C’est aussi le temps où on ne soigne la tuberculose que dans
un sanatorium, et par des interventions chirurgicales périlleuses. Vivien Cash,
engagée comme enseignante dans un sanatorium, ne tarde pas à être séduite par
le médecin de l’endroit. Qui lui laisse entrevoir un mariage, dès qu’il aura
deux jours de congé. Ils iront même jusqu’à la ville où doit se dérouler, avec
discrétion, la cérémonie officielle. Elle n’aura cependant pas lieu, comme
Vivien le comprend quelques instants plus tôt, lors d’une conversation, dans la
voiture, perturbée par un problème de parking, symbole minuscule d’un problème
plus profond.Pour arriver au sanatorium, Vivian avait pris le train à Toronto. Le trajet, bref, l’avait fait changer d’univers. Si les trains canadiens n’ont pas, dans notre imaginaire collectif, la puissance évocatrice des grandes lignes européennes, Alice Munro en fait un espace aventureux qui déborde des parcours accomplis. A trois reprises, ce moyen de transport joue un rôle essentiel dans la vie de quelques personnages. Tout s’articule à la perfection chez Alice Munro.
