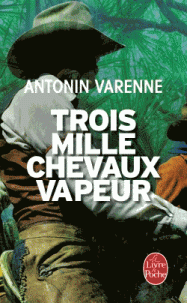 Les grands romans ont beau avoir pris, sous l’impulsion de
leurs auteurs, les formes les plus diverses, ils posent presque tous les
questions fondamentales qui nous taraudent sur la nature humaine. Ils se
gardent bien s’y répondre mais placent la lectrice ou le lecteur en face de
quelqu’un qui pourrait être son double, plus souvent effrayant que rassurant.
Renforçant par conséquent le malaise qui naît à chaque instant de nos
faiblesses, si semblables à celles des personnages que nous côtoyons. Antoine
Varenne a écrit un roman de ce genre, lorgnant du côté de Conrad, Kipling ou
Stevenson – des noms cités en quatrième de couverture et, c’est si rare qu’il
faut le signaler, très pertinents. Quand l’aventure qui fait vibrer la surface
des choses rejoint en profondeur les grands combats entre le bien et le mal,
cela peut donner Trois mille chevaux vapeur.
En Birmanie, Arthur Bowman est désigné pour une mission si secrète
qu’il n’en connaît guère les objectifs. Et que, au moment où il croira avoir
tout compris, il découvrira autre chose. Nous sommes en 1852, la Compagnie des
Indes orientales règne sur le commerce grâce à l’appui d’une armée qui est
moins au service d’un pays que de ses négociants. Dans cette armée, le sergent
Bowman est une tête dure, le type qui ne craint rien pour se faire obéir et est
prêt à aller encore beaucoup plus loin pour atteindre le seul but vraiment
fondamental : survivre.
« Survivre », c’est le mot que Bowman trouvera en
1858 inscrit, en lettres de sang, dans un égout londonien, à côté d’un cadavre
dont les blessures lui rappellent cruellement ce qu’il a vécu en Birmanie. Et
que les cicatrices couturant son torse ne lui permettent pas d’oublier. C’est
comme un cauchemar qui recommence. Il n’avait jamais vraiment cessé, bien
entendu. La dizaine d’hommes qui ont survécu à la mystérieuse mission, et dont
il ne sait ce qu’ils sont devenus, doivent avoir vécu leur retour à la vie
civile avec des difficultés du même genre. Son cas est réglé : dans la
police où il travaille, il passe pour fou et dangereux. Donc capable d’avoir
commis le crime. Puisque ce n’est pas lui, c’est un des autres, dans le délire
de ce qu’on n’appelait pas encore, à l’époque, un syndrome de stress
post-traumatique. Bowman ne prouvera son innocence qu’en trouvant le coupable.
La route est longue, elle le conduira aux Etats-Unis où ont
émigré deux, peut-être trois membres de la mission. La chasse est passionnante,
pleine de surprises, elle révèle l’état de deux pays au milieu du 19e
siècle et comment la société y fonctionne : plutôt mal et pas autrement,
en fait, qu’à l’époque de la Compagnie des Indes orientales. C’est-à-dire par
l’exploitation du plus grand nombre au profit de quelques privilégiés.
Les grands romans ont beau avoir pris, sous l’impulsion de
leurs auteurs, les formes les plus diverses, ils posent presque tous les
questions fondamentales qui nous taraudent sur la nature humaine. Ils se
gardent bien s’y répondre mais placent la lectrice ou le lecteur en face de
quelqu’un qui pourrait être son double, plus souvent effrayant que rassurant.
Renforçant par conséquent le malaise qui naît à chaque instant de nos
faiblesses, si semblables à celles des personnages que nous côtoyons. Antoine
Varenne a écrit un roman de ce genre, lorgnant du côté de Conrad, Kipling ou
Stevenson – des noms cités en quatrième de couverture et, c’est si rare qu’il
faut le signaler, très pertinents. Quand l’aventure qui fait vibrer la surface
des choses rejoint en profondeur les grands combats entre le bien et le mal,
cela peut donner Trois mille chevaux vapeur.
En Birmanie, Arthur Bowman est désigné pour une mission si secrète
qu’il n’en connaît guère les objectifs. Et que, au moment où il croira avoir
tout compris, il découvrira autre chose. Nous sommes en 1852, la Compagnie des
Indes orientales règne sur le commerce grâce à l’appui d’une armée qui est
moins au service d’un pays que de ses négociants. Dans cette armée, le sergent
Bowman est une tête dure, le type qui ne craint rien pour se faire obéir et est
prêt à aller encore beaucoup plus loin pour atteindre le seul but vraiment
fondamental : survivre.
« Survivre », c’est le mot que Bowman trouvera en
1858 inscrit, en lettres de sang, dans un égout londonien, à côté d’un cadavre
dont les blessures lui rappellent cruellement ce qu’il a vécu en Birmanie. Et
que les cicatrices couturant son torse ne lui permettent pas d’oublier. C’est
comme un cauchemar qui recommence. Il n’avait jamais vraiment cessé, bien
entendu. La dizaine d’hommes qui ont survécu à la mystérieuse mission, et dont
il ne sait ce qu’ils sont devenus, doivent avoir vécu leur retour à la vie
civile avec des difficultés du même genre. Son cas est réglé : dans la
police où il travaille, il passe pour fou et dangereux. Donc capable d’avoir
commis le crime. Puisque ce n’est pas lui, c’est un des autres, dans le délire
de ce qu’on n’appelait pas encore, à l’époque, un syndrome de stress
post-traumatique. Bowman ne prouvera son innocence qu’en trouvant le coupable.
La route est longue, elle le conduira aux Etats-Unis où ont
émigré deux, peut-être trois membres de la mission. La chasse est passionnante,
pleine de surprises, elle révèle l’état de deux pays au milieu du 19e
siècle et comment la société y fonctionne : plutôt mal et pas autrement,
en fait, qu’à l’époque de la Compagnie des Indes orientales. C’est-à-dire par
l’exploitation du plus grand nombre au profit de quelques privilégiés.La route est surtout le reflet d’une évolution personnelle qui fait progressivement de Bowman un homme différent. Celui qui menait ses troupes avec fermeté, voire brutalité, se met à lire Thoreau et son cheval s’appelle Walden. Une femme l’a aidé à chasser quelques-uns de ses démons les plus agressifs.
