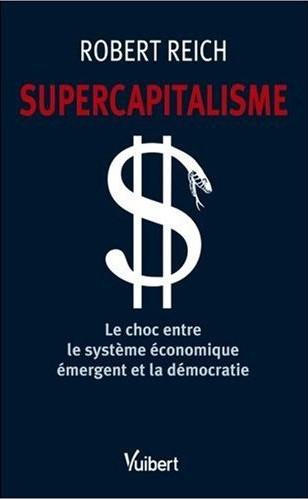 Début 2008 était publié aux éditions Vuibert, dans une excellente traduction et avec un appareil critique complet (index, notes), un livre dont je m’étonne qu’il n’ait pas rencontré plus d’écho. Professeur de politique publique à l’université de Californie à Berkley, ancien secrétaire d’Etat à l’emploi sous la présidence de Bill Clinton, Robert Reich s’attaque pourtant à une question fondamentale. « Et si le capitalisme d’aujourd’hui signait l’arrêt de mort à petit feu de la démocratie ?». A travers six chapitres (l’âge pas tout à fait d’or, le supercapitalisme en gestation, le grand écart, la démocratie malade, la politique détournée de sa vocation, guide du supercapitalisme à l’usage du citoyen) Reich décrit etanalyse comment le capitalisme du milieu du XIXesiècle s’est transformé en « capitalisme global » puis en « supercapitalisme ». Mais alors que ce supercapitalisme permet d’agrandir encore le gâteau économique, la démocratie, elle, qui se soucie de l’ensemble des citoyens est, sous son influence, de moins en moins effective.
Début 2008 était publié aux éditions Vuibert, dans une excellente traduction et avec un appareil critique complet (index, notes), un livre dont je m’étonne qu’il n’ait pas rencontré plus d’écho. Professeur de politique publique à l’université de Californie à Berkley, ancien secrétaire d’Etat à l’emploi sous la présidence de Bill Clinton, Robert Reich s’attaque pourtant à une question fondamentale. « Et si le capitalisme d’aujourd’hui signait l’arrêt de mort à petit feu de la démocratie ?». A travers six chapitres (l’âge pas tout à fait d’or, le supercapitalisme en gestation, le grand écart, la démocratie malade, la politique détournée de sa vocation, guide du supercapitalisme à l’usage du citoyen) Reich décrit etanalyse comment le capitalisme du milieu du XIXesiècle s’est transformé en « capitalisme global » puis en « supercapitalisme ». Mais alors que ce supercapitalisme permet d’agrandir encore le gâteau économique, la démocratie, elle, qui se soucie de l’ensemble des citoyens est, sous son influence, de moins en moins effective.
Approximativement entre 1945 et 1975, l’Amérique avait trouvé, selon Reich, un compromis remarquable entre capitalisme et démocratie. Il combinait un système économique très productif et un système politique qui répondait dans une grande mesure aux besoins des citoyens. Cette époque était caractérisée par une production de masse (avec économies d’échelle et entreprises géantes), un partage des profits entre les parties prenantes (entreprise, fournisseurs, distributeurs, salariés), et un gouvernement qui protégeait la capacité de négociation de ces parties prenantes et qui réglementait l’accès aux biens communs (chemins de fer, téléphone, gaz et électricité et plus largement énergie).
Depuis la fin des années 1970 un changement fondamental s’est produit dans le capitalisme démocratique américain. Ce changement s’est propagé par ondes successives au reste du monde. La structure de l’économie a évolué vers des marchés infiniment plus concurrentiels. « Le pouvoir est passé aux consommateurs et aux investisseurs ». Lesnouvelles technologies, issues de la guerre froides sont à l’origine de ce changement à travers :
- Le développement de la mondialisation avec la création de chaînes d’approvisionnement mondialiséesrendues possibles par l’utilisation des conteneurs, tankers et desnouvelles techniques d’informations et de communication). Cela a aussi permis à la grande distribution d’agréger le pouvoir de négociation des consommateurs et de pressurer les fabricants pour en obtenir des prix toujours plus bas. Enfin le lien entre performance des entreprises américaines (de plus en plus mondialisées) et le bien-être des citoyens américains s’est rompu.
- Le développement de nouveaux processus de production de plus en plus informatisés , avec la fin des économies d’échelles, l’apparition de vendeurs multiples et la concurrence des oligopoles par des producteurs spécialisés.
- Le développement de la déréglementation dans les domaines des télécommunications, du transport aérien, de l’énergie mettant fin aux péréquations et aux subventions croisées. Enfin la déréglementation financière s’est accompagnée de l’agrégation par les fonds de pension et mutuels des investisseurs individuels qui ont contraint les entreprises à des rendements de plus en plus importants.
L’économie américaine est maintenant caractérisée par ce que Reich appelle « le grand écart ». Avecune économie devenue de en plus productive (triplement du PIB, un Dow-Jones multiplié par 13) et un revenu médian qui a stagné (si il avait progressé au même rythme que la productivité, ce revenu serait supérieur de 20 000 dollars par an à celui constaté aujourd’hui).Avec un désengagement des entreprisesdans le domaine de la protection sociale (18% offrent une couverture sociale complète à leurs salariés en 2006 contre 74% en 1980) et de leurs retraités (un tiers des entreprises de plus de 200 salariés offrent une assurance sociale à leurs retraités en 2006 contre deux tiers en 1980). Avec une captation accrue de la richesse par les couches supérieures. En 2004, 16% du revenu intérieur bénéficie à 1% des contribuables (deux fois plus qu’en 1980) et 7% de ce même revenu à0,1% des contribuables (trois fois plus qu’en 1980). Enfin, là où un PDG d’une grande entreprise gagnait en 1980 40 fois le salaire moyen de ses salariés, il gagne en 2001 350 fois ce salaire moyen et même, en 2006, pour le PDG de General Motors 900 fois.
La démocratie américaine est elle malade. Les marchés répondent avec une efficacité redoutable aux désirs individuels, ils ne répondent pas aux objectifs collectifs. Les citoyens sont devenus inaudibles. Ne bénéficiant plus des institutions qui agrégeaient leurs pouvoirs de négociation, leur voix est couverte par le vacarme des entreprises et lobbies de toute sorte.Le processus politique est devenu une extension du champ de bataille qu’est le marché. Les entreprises sont entrées dans uneconcurrence de plus en plus farouche pour arracher des décisions politiques leur conférant un avantage concurrentiel conduisant à une véritable OPA du monde de l’entreprise sur celui de la politique. Avec un rôle croissant de l’argent des grandes entreprises dans la politique. Avec des entreprises et coalitions qui se présentent volontiers comme défenseurs de l’intérêt général, qui définissent ce que sont les “grands problèmes du moment” et qui financent des experts pour parer d’une apparence rationnelle des arrangements confortables (conduisant à une véritable « corruption du savoir »). Avec des politiques publiques jugéesà la seule aune d’un calcul utilitaire permettant de déterminer si elles sont susceptibles d’améliorer la productivité de l’économie. Avec des responsables politiques qui s’intéressent de moins en moins aux questions de justice et d’équité sociale, alors que les inégalités se creusent, qui “représentent” les consommateurs et investisseurs, et de moins en moins les citoyens.
Pour Reich il est devenu indispensable de séparer capitalisme et démocratie et de monter une garde attentive sur la frontière entre les deux. L’enjeu est d’établir de nouvelles règles susceptibles de protéger et promouvoir le bien commun et d’empêcher le supercapitalisme de prendre la politique en otage,établissant un juste équilibre entre les intérêts des consommateurs, des investisseurs, des citoyens, de la société. Pour lui, le supercapitalisme a définitivement rendu illusoirela promesse jamais tenue de la démocratie d’entreprise. L’entreprise résiste à tout ce qui pourrait avoir un impact négatif sur ses résultats, accorde peu de priorité à tout ce qui ne les conforte pas. L’entreprise ne peut pas faire de social sans imposer un coût supplémentaire aux consommateurs (prix)et investisseurs (rendements) qui iront voir ailleurs. L’entreprise a pour obsession de créer de la valeur pour l’actionnaire et non de pratiquer la vertu sociale. L’entreprise voit ses résultats attendus mesurés par le niveau du cours de l’actionalors qu’aucun étalon ne mesure la façon dont elle sert les autres parties prenantes.
Robert Reich conclut son livre par un « guide du supercapitalisme à l’usage du citoyen » et par une dernière phrase digne d’Hannah Arendt.«La première étape, et souvent la plus difficile, est de penser juste ».
Considérant que la concurrence débridée, mère du supercapitalisme, s’est propagée à la sphère politique et que les entreprises ne sont pas des personnes mais des « collections d’accords contractuels », Robert Reich préconise de mettre en place une cloison étanche entre le capitalisme, qui optimise la satisfaction du consommateur et de l’investisseur et la démocratie qui permet d’atteindre collectivement des objectifs inatteignables individuellement. Si on veut que les entreprises jouent autrement, il faut modifier le jeu qu’elles jouent en en changeant les règles. La démocratie est le meilleur outil pour changer ces règles et pallier aux conséquences sociales désastreuses : enrichissement des plus riches, appauvrissement des plus pauvres, précarisation de l’emploi et des communautés locales, dégradation de l’environnement, violation des droits de l’homme, produits et services flattant nos instincts les plus bas. Loin de l’angélisme des technocrates et politiques européens,Reich considère que les entreprises ne sont pas faites pour décider de ce qui est socialement vertueux, et qu’elles sont incapables de délivrer efficacement des services qui par leur nature même sont publics. Pour lui, les législations américaines et européennespeuvent contrôler une partie importante du comportement des entreprises mondiales, plus efficacement que les appels à la responsabilité sociale.

