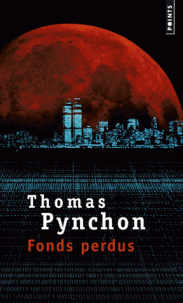 Nous avons une bonne nouvelle : oubliez les
antidépresseurs et toutes les autres substances plus ou moins légales absorbées
pour se sentir mieux. Il y a beaucoup plus efficace et moins nocif : le roman de Thomas Pynchon, Fonds perdus. En
revanche, des phénomènes d’accoutumance risquent de se produire, et de conduire vers les autres livres de cet écrivain discret, qui n’apparaît
pas en public pour faire la promotion de ses romans. Mais il n’y aurait qu’à
s’en réjouir.
Car Pynchon est un génie, voilà, c’est dit. Rien à voir avec
toute la cohorte d’écrivains prétentieux, souvent inspirés par sa manière, qui
tentent de traduire le monde d’aujourd’hui dans des constructions alambiquées,
tenant debout par l’effet d’un miracle provisoire car, si on souffle dessus, ce n’est que
châteaux de cartes. Un vieux fonds d’éducation nous interdit de citer des noms,
la délation n’est pas le genre de la maison.
Fonds perdus se
déroule à New York, du printemps 2001 au printemps 2002, entre deux éclosions
florales des poiriers de Chine de l’Upper West Side, le quartier où habite
Maxine avec ses deux fils, et parfois avec leur père. Maxine, inspectrice des
fraudes, a perdu sa licence officielle pour avoir traité avec des hommes
d’affaires peu scrupuleux. Elle a plongé avec eux mais conserve sa connaissance
des flux financiers et l’utilise comme un privé spécialisé capable de repérer
des anomalies dans une comptabilité. Elle a donc toujours la confiance d’un
certain nombre d’hommes d’affaires qui lui confient des missions discrètes. Menées
parfois à bien avec l’aide de spécialistes de spécialistes du Web Profond, des
hackers avides de découvrir des pans d’Internet où personne ne va jamais. Sinon
ceux qui s’en servent pour masquer des opérations douteuses.
Le décor est celui d’une ville qui a survécu au bug
imaginaire de l’an 2000 mais qui ignore encore vers quoi elle se dirige : « les désastres à venir dans la Grosse
Pomme, y compris le réchauffement climatique, mais pas uniquement. »
En réalité, un certain nombre de signes auraient pu laisser prévoir le 11
septembre. Ce décor est précis : dans une soirée où de grands écrans
passent des images en boucle, on aperçoit celles de l’entartage de Bill Gates
en Belgique…
Un homme aussi riche qu’inquiétant est au centre des
investigations de Maxine : Gabriel Ice, froid comme son nom, investit dans
de nombreuses sociétés, misant en particulier sur les tuyaux qui conduiront
l’information quand la bande passante du web sera devenue un important enjeu
économique. Autour de lui gravitent, comme dans un système planétaire parfois
animé de secousses, autant d’hommes de main que d’ingénieurs hyperdoués.
Quand la poussière des Twin Towers aura fini de retomber sur
la ville, quelques vérités troublantes auront surgi de l’incroyable fouillis
qui constitue le monde de la communication, de la politique et de l’argent. Vérités
romanesques, certes, mais portées par une écriture survitaminée qui leur font
toucher des cibles profondes chez le lecteur.
De cette écriture, il y aurait beaucoup à dire. Comment les
majuscules y ont une fonction ironique, semblant même se moquer des écrivains
qui les utilisent sans ironie. Comment, aussi, elle oblige le traducteur à des
contorsions qui débouchent parfois sur de belles trouvailles : « unhackable »
devient, en français, « inatthackable » ; ou le néologisme
« Meufia », qui désigne le syndicat du crime des nanas WASP…
Nous avons une bonne nouvelle : oubliez les
antidépresseurs et toutes les autres substances plus ou moins légales absorbées
pour se sentir mieux. Il y a beaucoup plus efficace et moins nocif : le roman de Thomas Pynchon, Fonds perdus. En
revanche, des phénomènes d’accoutumance risquent de se produire, et de conduire vers les autres livres de cet écrivain discret, qui n’apparaît
pas en public pour faire la promotion de ses romans. Mais il n’y aurait qu’à
s’en réjouir.
Car Pynchon est un génie, voilà, c’est dit. Rien à voir avec
toute la cohorte d’écrivains prétentieux, souvent inspirés par sa manière, qui
tentent de traduire le monde d’aujourd’hui dans des constructions alambiquées,
tenant debout par l’effet d’un miracle provisoire car, si on souffle dessus, ce n’est que
châteaux de cartes. Un vieux fonds d’éducation nous interdit de citer des noms,
la délation n’est pas le genre de la maison.
Fonds perdus se
déroule à New York, du printemps 2001 au printemps 2002, entre deux éclosions
florales des poiriers de Chine de l’Upper West Side, le quartier où habite
Maxine avec ses deux fils, et parfois avec leur père. Maxine, inspectrice des
fraudes, a perdu sa licence officielle pour avoir traité avec des hommes
d’affaires peu scrupuleux. Elle a plongé avec eux mais conserve sa connaissance
des flux financiers et l’utilise comme un privé spécialisé capable de repérer
des anomalies dans une comptabilité. Elle a donc toujours la confiance d’un
certain nombre d’hommes d’affaires qui lui confient des missions discrètes. Menées
parfois à bien avec l’aide de spécialistes de spécialistes du Web Profond, des
hackers avides de découvrir des pans d’Internet où personne ne va jamais. Sinon
ceux qui s’en servent pour masquer des opérations douteuses.
Le décor est celui d’une ville qui a survécu au bug
imaginaire de l’an 2000 mais qui ignore encore vers quoi elle se dirige : « les désastres à venir dans la Grosse
Pomme, y compris le réchauffement climatique, mais pas uniquement. »
En réalité, un certain nombre de signes auraient pu laisser prévoir le 11
septembre. Ce décor est précis : dans une soirée où de grands écrans
passent des images en boucle, on aperçoit celles de l’entartage de Bill Gates
en Belgique…
Un homme aussi riche qu’inquiétant est au centre des
investigations de Maxine : Gabriel Ice, froid comme son nom, investit dans
de nombreuses sociétés, misant en particulier sur les tuyaux qui conduiront
l’information quand la bande passante du web sera devenue un important enjeu
économique. Autour de lui gravitent, comme dans un système planétaire parfois
animé de secousses, autant d’hommes de main que d’ingénieurs hyperdoués.
Quand la poussière des Twin Towers aura fini de retomber sur
la ville, quelques vérités troublantes auront surgi de l’incroyable fouillis
qui constitue le monde de la communication, de la politique et de l’argent. Vérités
romanesques, certes, mais portées par une écriture survitaminée qui leur font
toucher des cibles profondes chez le lecteur.
De cette écriture, il y aurait beaucoup à dire. Comment les
majuscules y ont une fonction ironique, semblant même se moquer des écrivains
qui les utilisent sans ironie. Comment, aussi, elle oblige le traducteur à des
contorsions qui débouchent parfois sur de belles trouvailles : « unhackable »
devient, en français, « inatthackable » ; ou le néologisme
« Meufia », qui désigne le syndicat du crime des nanas WASP…Fonds perdus est un grand, un très grand livre de notre temps. Et probablement au-delà.
