 L’Escadre aux Dardanelles – La matinée avant le combat
L’Escadre aux Dardanelles – La matinée avant le combat
(De notre envoyé spécial.) À bord du… … août. — Il est cinq heures moins le quart ! J’ai, depuis la veille, embarqué sur le … C’est le canot-major de six heures quarante-cinq qui m’y conduisit. À sept heures, le lieutenant de vaisseau, président du carré, me présentait à la table des officiers où je prenais place. Ma première soirée fut de recueillement, j’allais vivre la vie de guerre du marin… Donc il est cinq heures moins le quart. Au bruit des machines qui, de la nuit, ne cessa, s’ajoute celui des pas qui courent sur les planchers cuirassés, celui de tôles que l’on traîne, celui des voix qui transmettent des ordres ou y répondent. Ce navire redevient le domaine des bielles, des marteaux et des courses de souliers cloutés. Trouant ce tintamarre, un clairon lance résolument quelques notes, plus loin un autre clairon les répète. C’est l’appareillage. Sortons de la chambre. Il faut prendre cent précautions pour éviter les pieds, les jambes, les bras qui pendent des hamacs : dédaignant le vacarme, les matelots qui ne sont pas de quart, sereins comme des anges et nus comme eux, dorment dans l’entrepont. Nous gagnons une passerelle. C’est juste au moment où l’on remonte l’ancre. Le soleil n’a pas encore dépassé les montagnes de Lemnos, il ne fait qu’en dorer les bords. Vers les Dardanelles À cinq heures, le navire quittera la baie. Pendant cinq jours il doit collaborer aux opérations des Dardanelles. Cet après-midi à quatre heures et demie il tirera. Car, depuis l’attaque du 18 mars, il y a toujours une marine dans ces parages. C’est une des amertumes de cette guerre de ténacité que l’héroïsme quotidien soit étouffé sous le poids d’une action plus éclatante. Cette journée d’il y a cinq mois semble avoir été la seule où l’escadre se soit aventurée. Pour beaucoup, elle se repose. Elle se repose en montant sans relâche des quarts exténuants, en allant lancer sans cesse de la mitraille sur la presqu’île, en parcourant un chemin de mer hanté par la torpille, par la torpille qui vise sept cents morts à la fois. L’ancre est levée. Les matelots enroulent rapidement la chaîne. Le navire commence à tourner sur lui-même. Les hommes ont presque cessé de courir. Chaque chose est préparée et chacun est à sa place. Les canonniers sont à leurs pièces, les mitrailleurs à leur bande. On peut glisser, on est paré. De ses orgueilleux coups de gorge un coq salue le départ. Il est là, sur le cuirassé dans une cage en lattes de bois, il s’égosille, il est heureux de repartir au feu. Pendant ce temps, ses poules, la tête entre les barreaux, picorent le grain que leur a jeté un matelot. Nous allons franchir le barrage de la baie. Le passage est étroit. Un transport militaire venant du large s’y engage. Le cuirassé siffle deux coups pour lui dire de prendre sa gauche. Le transport n’en fait rien. Le cuirassé redonne ses deux coups de sifflet, plus impérieusement. Le transport obéit. Les deux bateaux se croisent de près. Le transport baisse trois fois son pavillon pour saluer, le cuirassé une fois seulement. Le garde-corps du cuirassé Devant, loin encore de nous un petit navire fume et trépigne. C’est le torpilleur d’escadre qui doit nous servir de garde-corps. C’est le … À peine voit-il que nous allons quitter la baie, qu’il la quitte lui-même. Il va renifler le chemin que nous allons parcourir. Avec quel amour il nous protège ! Il est à droite, à gauche, il est devant, derrière. Nous marchons à quatorze nœuds, lui à dix-neuf et de ses cinq nœuds de vitesse supplémentaire il ne cesse de nous entourer. Nous zigzaguons. Le sous-marin est redouté. De plus en plus les chefs et l’équipage sont au poste de veille, le commandant est attentif autour du blockhaus, le commandant en second promène ses pas feutrés de bâbord à tribord, les officiers sont prêts à manier les canons, les mitrailleurs à tourner le moulin et tout autour du bâtiment, appuyés sur les rampes, de dix en dix pas, des marins, le menton dans la main, regardent l’eau. Ils examinent dans une attitude de contemplation la surface de la mer. Ce sont les guetteurs de périscope. Admirable métier qui permet de prendre ceux qui le pratiquent pour des hommes rêvant au lever du soleil ! C’est le combat contre l’invisible, contre l’impondérable, combat sans visée, sans émulation et souvent sans échange, combat dont tous ressentent la présence, mais dont personne, à aucun moment, ne parle jamais. Est-ce que quelqu’un aurait là-dessus quelque chose à apprendre à son voisin ? À voir le navire continuer sa manœuvre de protection autour de nous, on est pris d’une subite tendresse pour lui. Il agit tel un bon chien auquel on aurait dit : « Un ennemi est près de ton maître, cherche. » Il vire, se précipite, s’essouffle. On l’embrasserait. Ceux qui ne voient rien Ceci c’est le dessus, c’est ce qui est à la grande brise de la mer. Descendons, pendant ce trajet, dans les fournaises qui sont au-dessous le la ligne de flottaison. Quittons la passerelle, traversons l’entrepont et en compagnie du mécanicien, prenons cet escalier qui s’enfonce. D’abord gare à vos mains. Les rampes ici ne sont pas faites pour s’appuyer à moins que l’on ne veuille y laisser de sa peau après. Gare aussi à vos poumons si comme le navire ils ne sont pas cuirassés ; ce n’est plus de l’air, c’est du feu, du feu impur que vous engouffrez. Comment se nomme cet infernal escalier ? Ce doit être la descente aux enfers. Et nous nous sommes promenés des chambres des machines à celles des dynamos, des bouilleurs aux foyers, suffoquant sous des bouffées de flamme, sentant sous nos pieds le plancher comme une chaufferette, recevant sur les bras des gouttes d’eau bouillante et les hommes que nous rencontrions avaient tous des figures noires où coulait la sueur et pourtant l’un d’eux, près des rues de chauffe, dans un coin qui n’était pas une oasis, souriant, confectionnait un petit bateau, et de chambre en chambre, de compartiment en compartiment, c’étaient de grosses portes d’acier où on lisait : « Fermer pendant la combat. » Ils sont fermés pendant le combat dans leur charbon, dans leurs machines, dans leur huile. Ils ne connaissent rien de l’aventure où pourtant ils conduisent le bâtiment. Ils ne demandent d’ailleurs jamais où on en est. On les entend dire seulement quand, depuis plusieurs heures, ils marchent vers l’ennemi et qu’aucun bruit de canon n’a encore ébranlé le navire : « Qu’est-ce qu’ils f… donc là-haut ? » Là-haut nous y remontons. Nous avons fait du chemin. Le navire continue de plus en plus sa garde de page. Nous sommes en vue de la côte d’Asie. Mais nous tournons. Cela, c’est pour cet après-midi. Nous allons mouiller, en attendant, dans la baie… Nous y entrons. L’orchestre attaque Sambre et Meuse. Les vaisseaux rendent les honneurs. L’orchestre reprend le Tipperary. (À suivre.)
Le Petit Journal, 21 août 1915.
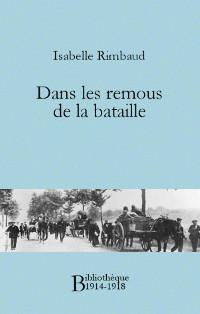 La Bibliothèque malgache édite une collection numérique "Bibliothèque 1914-1918". Au catalogue, pour l'instant, les 7 premiers volumes (d'une série de 17) du Journal d'un bourgeois de Paris pendant la guerre de 1914, par Georges Ohnet (1,99 € le volume). Une présentation, à lire ici.
Et le récit, par Isabelle Rimbaud, des deux premiers mois de la Grande Guerre comme elle les a vécus, Dans les remous de la bataille.
La Bibliothèque malgache édite une collection numérique "Bibliothèque 1914-1918". Au catalogue, pour l'instant, les 7 premiers volumes (d'une série de 17) du Journal d'un bourgeois de Paris pendant la guerre de 1914, par Georges Ohnet (1,99 € le volume). Une présentation, à lire ici.
Et le récit, par Isabelle Rimbaud, des deux premiers mois de la Grande Guerre comme elle les a vécus, Dans les remous de la bataille.
