(De notre envoyé spécial.) … juillet 1915. En politique, la Grèce est le pays du labyrinthe. Je suis entré dans ce labyrinthe, je n’en suis pas sorti. Ne croyez pas que je m’y étais aventuré seul. J’ai pris pour guides des ministres, un directeur des affaires politiques. M. Venizelos et des confrères. Ensemble, tour à tour, nous avons parcouru le dédale. Ils marchaient à côté de moi. Nous allâmes ainsi longtemps. Quand il s’est agi de marcher vers la sortie, que ce fût avec l’un, que ce fût avec l’autre, nous n’avons fait que nous heurter contre les glaces. Je ne me suis pas encore retrouvé. Permettez qu’en votre compagnie, je recommence la promenade, peut-être que, plus perspicaces que moi, vous arriverez à me débrouiller. Une scène royale Nous sommes au début, dans la première quinzaine de mars. La Grèce va partir. Venizelos le veut. S. M. la reine ne le veut pas. Il faut rapporter une scène royale qui s’est passée à cette heure. Il ne restait, au roi, plus qu’une nuit pour décider de la guerre ou de la démission de son premier ministre, de celui dont il disait : « Est-ce qu’enfin nous ne ferons rien sans que Venizelos soit de moitié avec nous ? » S. M. Sophie, reine de Grèce et sœur de l’empereur d’Allemagne, avait déclaré dans la journée : « Tant que je serai ici, ce pays ne sortira pas de la neutralité. » Le soir vint. La reine se présenta dans les appartements du roi. Le roi balançait encore intérieurement entre les deux décisions. La reine – et ce n’est pas moi, c’est la cour qui le raconte – se changea subitement en reine de tragédie. Il ne lui manquait qu’un péplum pour être un personnage d’Eschyle ou d’Euripide. Si la Grèce déclarait la guerre, elle irait jusqu’à lui enlever ses enfants ! Pour échapper aux imprécations de la souveraine, le roi sortit dans ses jardins, la nuit était froide – et cette fois ce n’est plus la cour, c’est le peuple qui le raconte – c’est là qu’il prit son mal. Ce n’est qu’une histoire de cette période, il y en a d’autres. Pour calmer le courroux de la reine et conjurer ses menaces, le roi accepta la démission de Venizelos. Et la Grèce dit alors : « Le peuple jugera. » On nomma un nouveau président du Conseil. On convoqua les électeurs. Et patiemment on attendit les urnes d’où la lumière devait sortir. Le peuple, dans certaines circonstances, pour des souverains ou pour un gouvernement, est ce qu’il a de mieux, comme ombre pour s’étendre, dormir et oublier. Après cette alerte, à son abri, la reine respira. Par contre, le roi faillit mourir. La politique est sans pitié. Pour le nouveau gouvernement grec, la maladie du roi allait devenir un excellent agent électoral. En Macédoine, en Épire, dans le Péloponèse, le gouvernement faisait dire : « Grecs ! vous aimez votre roi, n’est-ce pas ? Bien, mettez vos bulletins de vote dans les urnes vénizélistes, ce serait plonger vos doigts dans les plaies sanglantes de Constantin-le-Victorieux (on sait que les victoires grecques dans la guerre de 1913 ont rendu le roi très populaire dans son pays). Le peuple grec était perplexe. Il voulait de Venizelos, il ne désirait pas s’ensanglanter les doigts. Il cherchait un moyen de prouver à la fois son amour à son souverain et son attachement à son grand homme. Le moyen se présenta sous la forme d’une icône. Deuxième histoire Et voici la deuxième histoire de cette période. Le souverain était très mal. Où les docteurs allemands avaient échoué, seule la divinité pouvait réussir. À l’île de Tinos, il y a, célèbre dans toute l’Hellade, une icône de la Vierge qui guérit chaque année des milliers de Grecs – des Grecs seulement, la Vierge ne connaît pas d’autres nationalités, de sorte que si la reine Sophie avait été malade, l’icône n’aurait pas guéri la reine Sophie – la cour, le gouvernement, le clergé décidèrent d’envoyer chercher l’icône. Le peuple se dit : « C’est notre affaire, nous allons pouvoir prouver que tout en votant pour Venizelos, nous n’avons pas l’intention de fouiller dans les plaies du roi. » L’icône arriva au Pirée. Trente mille électeurs, derrière le métropolite, étaient venus la chercher. Ils l’accompagnèrent jusqu’au palais. Tout le reste d’Athènes était aux fenêtres. Publiquement, d’avance, la capitale se lavait les mains. Que je n’oublie pas de dire que l’icône fit son miracle. On l’apporta dans la chambre de l’auguste malade. Se réveillant et l’apercevant, il dit : « Qu’est ceci ? » On le lui apprit. Alors il voulut la baiser. Il se souleva et à cet instant précis, l’abcès qui devait l’emporter perça. S. M. était sauvée. Il n’y avait plus aucun doute : le roi de Grèce était marqué du doigt de Dieu. Sa popularité ne fit qu’augmenter. Enfin le jour des élections arriva. Le peuple parla. Je ne connais pas M. Gounaris, je ne crois cependant pas me tromper en affirmant qu’il est sourd : il n’entendit sa voix que trois jours après qu’elle eut résonné. Cette surdité a son explication – et c’est la troisième histoire de cette période. L’explication s’appelle le baron Schenck. Je dois vous présenter le baron Schenck. Le baron Schenck Mince, possédant un bon tailleur, cavalièrement hautain, il paraît, quand il regarde les gens, laisser choir de son œil à leurs pieds des pièces de cent marks, à la façon des élégants faisant glisser leur monocle. C’est le grand argentier de l’Allemagne en Grèce. À mes rapides passages à Athènes, je l’avais rencontré, dans les couloirs de l’hôtel, attendant sa clientèle. Il avait installé son bureau au rez-de-chaussée ; c’est là qu’il guettait les hommes qui se considéraient comme une marchandise. Une fois, je le vis en magnifique redingote : il allait chez la reine. Schenck, baron allemand, et S. M. la reine des Hellènes ne peuvent naturellement que s’entendre. Il suffit au palais que l’on annonce Schenck pour que S. M. s’empresse. Et quand S. M. est avec Schenck, personne au monde ne saurait déranger Schenck et S. M. C’est lui qui paya les élections en Macédoine. Malgré la Macédoine, Venizelos avait encore 184 députés. Alors Schenck, auquel son argent donne des idées, proposa de ne pas proclamer de suite les résultats. Il pensa que, la finance aidant, on pourrait changer la majorité. (Car on sait que les Allemands ne doutent de rien.) Il s’y occupa pendant trois jours. On ne dit pas s’il y récolta des gifles, mais les trois jours écoulés, les 184 formaient encore le bloc. Depuis, le baron a l’œil déconfit, surtout depuis hier : le patron de l’hôtel, pour des motifs qui ne s’impriment pas, l’a flanqué à la porte. Après le vote populaire Donc les élections sont terminées. On devait consulter le peuple, le peuple s’est prononcé. Venizelos est désigné pour reprendre le pouvoir. Le gouvernement le dit lui-même. Le 20 juillet, lors de la convocation de la Chambre, il passera la main. Mais quelques jours coulent et des traits circulent, M. Gounaris, prétend-on, veut retarder la réunion du Parlement. Les journaux libéraux s’émeuvent. Ils demandent : Est-ce vrai ? M. Gounaris déclare qu’il n’a jamais eu cette intention, que la situation de la Grèce est grave, que ce n’est pas l’heure de s’amuser à des petits jeux. Très bien ! Très bien ! crie-t-on. La Grèce n’attend plus que le 20 juillet. Cinq jours avant, les premiers bruits recommencent : la Chambre ne sera pas convoquée. Les gens disent : « Pensez-vous ? Ce n’est pas possible. » Le lendemain, subitement, Gounaris se dresse et crie : « Je ne veux pas tuer le roi ! » Qui vous accuse de vouloir tuer le roi, demande-t-on, effaré ? « Je ne veux pas tuer le roi, répète Gounaris ; réunir la Chambre le 20 serait l’assassiner. » Et rassemblant dans une phrase toutes les molles subtilités d’Orient, il proclame : « On me disait que le roi était encore malade, j’ai recommandé aux médecins avec insistance de ne pas exagérer les dangers par sollicitude démesurée pour la santé du souverain. Malgré mes recommandations, ils m’ont assuré par écrit que si je n’ajournais pas la Chambre, il y avait péril pour la vie de Sa Majesté, alors je n’ai plus hésité. » C’est une phrase qu’il faudra porter sur soi. On la relira dans ses moments de neurasthénie et dans les yeux renaîtra le sourire ! La rentrée de la Chambre est retardée. Le jeu consiste désormais à exploiter contre l’Entente les incidents qui naissent des visites de bateaux pris dans la mer Égée, à colporter de prétendus propos diplomatiques dont on se sert contre les puissances alliées, à méditer la façon dont le roi, dans son message aux représentants du peuple, pourrait, tout en reconnaissant que Venizelos a droit au pouvoir, faire entendre aux vénizélistes que servir présentement sa Patrie, c’est ajourner Venizelos. Si cela ne réussit pas, le roi usera-t-il de son droit de dissoudre la Chambre ? On ne le pense pas. Ce serait affronter trop gros. Venizelos sera-t-il premier ministre dans vingt jours ? Oui, et ses amis le croient. Alors, que se passera-t-il ? C’est à cet endroit qu’essayant de sortir du labyrinthe, nous n’en trouvons plus l’issue. Car… la reine voudra toujours être le roi…
Le Petit Journal, 30 juillet 1915.
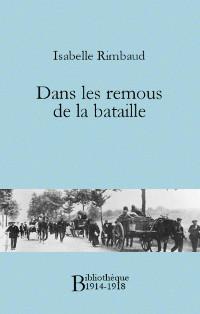 La Bibliothèque malgache édite une collection numérique "Bibliothèque 1914-1918". Au catalogue, pour l'instant, les 7 premiers volumes (d'une série de 17) du Journal d'un bourgeois de Paris pendant la guerre de 1914, par Georges Ohnet (1,99 € le volume). Une présentation, à lire ici.
Et le récit, par Isabelle Rimbaud, des deux premiers mois de la Grande Guerre comme elle les a vécus, Dans les remous de la bataille.
La Bibliothèque malgache édite une collection numérique "Bibliothèque 1914-1918". Au catalogue, pour l'instant, les 7 premiers volumes (d'une série de 17) du Journal d'un bourgeois de Paris pendant la guerre de 1914, par Georges Ohnet (1,99 € le volume). Une présentation, à lire ici.
Et le récit, par Isabelle Rimbaud, des deux premiers mois de la Grande Guerre comme elle les a vécus, Dans les remous de la bataille.
