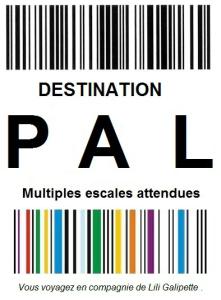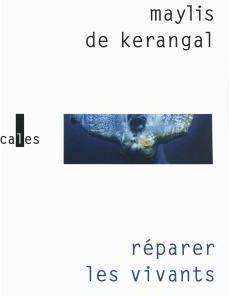 Ce livre m’a vraiment happée. Je sais que j’arrive après la musique, les louanges, les dix prix littéraires… Mais à quoi cela rimerait-il de contenir mon enthousiasme pour un bouquin, au prétexte de ne pas vouloir faire comme tout le monde ? J’essaie de plus en plus sur ce blog d’atteindre la pure sincérité (ce qui est un exercice difficile puisque forcément, face à un public, on choisit ses mots) et cette sincérité implique de crier son enthousiasme quand celui-ci est authentique, même si cela a déjà été fait cent fois.
Ce livre m’a vraiment happée. Je sais que j’arrive après la musique, les louanges, les dix prix littéraires… Mais à quoi cela rimerait-il de contenir mon enthousiasme pour un bouquin, au prétexte de ne pas vouloir faire comme tout le monde ? J’essaie de plus en plus sur ce blog d’atteindre la pure sincérité (ce qui est un exercice difficile puisque forcément, face à un public, on choisit ses mots) et cette sincérité implique de crier son enthousiasme quand celui-ci est authentique, même si cela a déjà été fait cent fois.
Il s’agit donc du roman d’une transplantation cardiaque. Curieux sujet, dont l’unité de temps ne dépasse pas les 24 heures, et l’action, les épicentres névralgiques que sont les hôpitaux du Havre et de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Simon Limbres, jeune Normand de 20 ans, revient d’une session de surf un glacial matin de février. Il est victime d’un accident de la route, il « meurt ». Il meurt entre guillemets, oui : bien que son cerveau soit irréversiblement touché par une hémorragie (« irréversible », un mot auquel Maylis de Kerangal a su donner toute sa puissance tragique), son corps, ses organes, notamment son cœur, continuent de fonctionner normalement grâce aux machines. On apprend que depuis 1959, la définition de la mort a changé pour la médecine : elle est considérée intervenir au moment de l’arrêt définitif des fonctions cognitives du cerveau, et non plus au dernier battement du cœur (ici, c’est le moment de faire le petit couplet sur l’époque qui privilégie la tête au cœur). Ce qui a pour effet de permettre le don des organes, dans l’intervalle – court – entre les arrêts différés des deux organes. Et c’est la question qui se pose aux parents de Simon. On se doute qu’il faut tout l’accompagnement à la fois professionnel et humain de l’équipe médicale pour leur permettre de prendre une décision aussi terrible que rapide.
Je n’ai pas la force d’analyser un tel livre. Il déborde de tous les côtés. Je me contenterai de soulever deux points qui m’ont parus fabuleux :
– Le premier c’est cette écriture lancinante, aux phrases à rallonges, martelantes de mots qui claquent, mêlant brillamment oralité et mots techniques, comme dans un concert de percussions, d’où fusent des trouvailles poétiques géniales pour exprimer les comparaisons (la voiture qui file, seule, sur la route vers l’hôpital, comme une bille de flipper lancée à toute allure en est une). Je craignais d’abord que cela me lassât. Mais point. Car ce n’est pas une écriture qui vise à l’artifice mais bien au contraire, qui cherche à exprimer et décrire les choses au plus ras des pâquerettes, et fait surgir des mondes d’une simple salle d’hôpital ou d’une rue grise du Havre. Et Maylis a le regard parfois surplombant (cf. la voiture-boule de flipper) qui permet de trouver des images étonnantes. Je n’ai pas le livre à portée de main, et la flemme d’insérer des citations, mais franchement, allez-le lire si ce n’est pas déjà fait, vous aurez toutes les citations que vous voudrez. ;-)
– Le second c’est la capacité de l’auteur à saisir la diffraction du monde, l’infinie variété des vies humaines qui pulsent côte à côte : les différents acteurs de la médecine qui jalonnent le parcours du cœur de Simon de son corps à un autre, avec leurs vies privées parfois marquées par le doute, la mélancolie, le désir, mais aussi les infortunés parents de Simon sur la tête de qui tombe le ciel, sa petite sœur, sa petite amie, et puis la receveuse du cœur, ses fils, tout ce petit monde continue de vivre, insérés dans la trame de l’univers, auquel appartiennent aussi ces supporters de foot qui se ruent gorgés de bière vers le stade de France pendant que le médecin coordinateur se rend à l’agence de biomédecine située à côté, pour effectuer sa garde et répartir les éventuels greffons du jour…
Voilà, j’ai dit. J’ai un nouvel auteur de qui veiller les futures œuvres et entreprendre l’exploration rétrospective de son oeuvre. Chouette !
Un dernier mot, parce que j’aime bien ça, les rapprochements insolites entre auteurs différents : en lisant Réparer les vivants, j’ai pensé à l’excellent Les pieds dans l’eau de Benoît Duteurtre, qui n’a pourtant pas grand chose à voir. Sauf que les deux histoires se passent dans le pays de Caux, les alentours du Havre, dont les deux auteurs proviennent. Que ces auteurs sont de la même génération. Plus obscurément peut-être, parce que tous les deux sont issus de familles catholiques (je sais, il faut se lever de bonne heure avec moi) : ce qui est présenté ouvertement, dans Les pieds dans l’eau (oeuvre autobiographique), je l’ai aussi senti dans Réparer les vivants (pourtant non autobiographique a priori), notamment à travers le personnage de la mère de Simon. J’ai mes antennes pour ce genre de choses ;-)
C’est le deuxième roman lu dans le cadre du challenge Destination PAL.