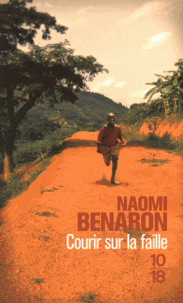 Le sport et la guerre. La
proximité des thèmes n’est pas nouvelle. Dans Courir sur la faille, son premier roman, Naomi Benaron
l’exploite avec intelligence sans en nier la complexité. C’est au Rwanda où,
avant le génocide, Jean-Patrick Nkuba caresse l’espoir de représenter son pays
aux Jeux olympiques. Il a toujours aimé courir. Tutsi, il ignorait cependant
qu’il deviendrait l’otage d’un régime avant de devenir, comme tant d’autres,
une cible à abattre. Champion ou non. Un symbole, en tout cas.
Vous souvenez-vous d’avril 1994 et des trois mois
qui suivirent ? Aviez-vous, à ce moment, des échos de ce qui se passait au
Rwanda ou bien est-ce venu plus tard ?
Oui, je m’en rappelle très bien. Le plus terrible,
pour moi, a été le désintérêt des médias après quelques semaines : le
génocide a fait l’objet d’une énorme couverture médiatique pendant un certain
temps, puis l’intérêt s’est tourné vers d’autres nouvelles comme le suicide de
Kurt Cobain et le meurtre de la femme d’O. J. Simpson, Nicole Brown Simpson. Je
me souviens d’avoir eu ce sentiment horrible de terreur mêlé à l’impuissance,
liée certainement à l’histoire de ma famille durant l’Holocauste. Je me sentais
coupable de ne rien pouvoir faire et j’imagine qu’écrire Courir sur la faille a été ma façon de gérer cette culpabilité.
Quand vous êtes allée au Rwanda en 2002,
aviez-vous déjà une idée en tête, ou bien s’agissait-il seulement, comme vous
le dites, de tourisme ?
Je savais pour le génocide et je m’étais préparée à
voir les traces de cette guerre, mais en aucun cas à voir des stigmates de la
guerre aussi frais, aussi visibles. Je n’étais pas prête à voir les maisons et
autres bâtiments recouverts d’impacts de balle et certainement pas à découvrir
des ossements éparpillés, dépassant du sable telles des racines, sur les rives
du lac Kivu. Mais je pense que quelle que soit l’idée qu’on s’en fait, on ne
peut jamais imaginer les blessures et les cicatrices laissées par un génocide.
Je partais pour découvrir… tout ce que ce que je pourrais trouver, mais le but
de mon voyage était d’assister au 90e anniversaire de Rosamond Carr.
Avant Courir
sur la faille, vous aviez publié un recueil de nouvelles, non traduit en
français, Love Letters from a Fat Man.
Il y était déjà question du Rwanda. Est-il possible, en écrivant, de se
détacher du drame de ce pays quand on en a côtoyé les conséquences ?
Dans mon cas, il était impossible de m’en détacher. J’ai
été élevée dans une famille où la justice sociale n’était pas qu’une idée, c’était
une part importante de ma vie, et ça l’est toujours aujourd’hui. Aussi, une
fois que je m’étais rapproché de Rwandais, que certains étaient devenus mes
amis, j’ai su que je devrais parler de leurs histoires, du génocide. Je savais
que le génocide du Rwanda allait être au cœur de mes écrits.
Vous citez Jean Hatzfeld en exergue de votre
roman. Savez-vous qu’il a aussi écrit un roman, Où en est la nuit, dans lequel il met en scène un coureur éthiopien
dans la guerre ? Quelles réflexions vous inspire cette coïncidence ?
Ah! Je ne savais pas ! C’est
incroyable ! [En
français dans le texte.] Ça m’intimide. Jean Hatzfed est l’un des écrivains
que j’admire le plus et j’espère un jour le rencontrer et lui parler en tête à
tête.
Le sport semble être, pour Jean-Patrick, un moyen
d’échapper aux tensions de son pays. Mais la haine est plus forte que le sport.
Plus forte que tout ?
Non.
Je ne peux pas croire ça. Au début, je me suis mis à écrireCourir
sur la faille pour faire « découvrir »
l’histoire du génocide à l’Occident, mais au fil de l’écriture et de mes
rencontres avec les Rwandais, j’ai commencé à comprendre que je n’écrivais pas
une histoire de haine mais d’amour, une histoire de courage, et je pressentais
qu’à la fin, ils l’emporteraient sur la haine. Même maintenant, avec tout ce qu’il
se passe en Syrie et en Egypte et même – oui – au sein du gouvernement
américain, je continue à croire que l’amour et la compassion l’emporteront.
Le sport et la guerre. La
proximité des thèmes n’est pas nouvelle. Dans Courir sur la faille, son premier roman, Naomi Benaron
l’exploite avec intelligence sans en nier la complexité. C’est au Rwanda où,
avant le génocide, Jean-Patrick Nkuba caresse l’espoir de représenter son pays
aux Jeux olympiques. Il a toujours aimé courir. Tutsi, il ignorait cependant
qu’il deviendrait l’otage d’un régime avant de devenir, comme tant d’autres,
une cible à abattre. Champion ou non. Un symbole, en tout cas.
Vous souvenez-vous d’avril 1994 et des trois mois
qui suivirent ? Aviez-vous, à ce moment, des échos de ce qui se passait au
Rwanda ou bien est-ce venu plus tard ?
Oui, je m’en rappelle très bien. Le plus terrible,
pour moi, a été le désintérêt des médias après quelques semaines : le
génocide a fait l’objet d’une énorme couverture médiatique pendant un certain
temps, puis l’intérêt s’est tourné vers d’autres nouvelles comme le suicide de
Kurt Cobain et le meurtre de la femme d’O. J. Simpson, Nicole Brown Simpson. Je
me souviens d’avoir eu ce sentiment horrible de terreur mêlé à l’impuissance,
liée certainement à l’histoire de ma famille durant l’Holocauste. Je me sentais
coupable de ne rien pouvoir faire et j’imagine qu’écrire Courir sur la faille a été ma façon de gérer cette culpabilité.
Quand vous êtes allée au Rwanda en 2002,
aviez-vous déjà une idée en tête, ou bien s’agissait-il seulement, comme vous
le dites, de tourisme ?
Je savais pour le génocide et je m’étais préparée à
voir les traces de cette guerre, mais en aucun cas à voir des stigmates de la
guerre aussi frais, aussi visibles. Je n’étais pas prête à voir les maisons et
autres bâtiments recouverts d’impacts de balle et certainement pas à découvrir
des ossements éparpillés, dépassant du sable telles des racines, sur les rives
du lac Kivu. Mais je pense que quelle que soit l’idée qu’on s’en fait, on ne
peut jamais imaginer les blessures et les cicatrices laissées par un génocide.
Je partais pour découvrir… tout ce que ce que je pourrais trouver, mais le but
de mon voyage était d’assister au 90e anniversaire de Rosamond Carr.
Avant Courir
sur la faille, vous aviez publié un recueil de nouvelles, non traduit en
français, Love Letters from a Fat Man.
Il y était déjà question du Rwanda. Est-il possible, en écrivant, de se
détacher du drame de ce pays quand on en a côtoyé les conséquences ?
Dans mon cas, il était impossible de m’en détacher. J’ai
été élevée dans une famille où la justice sociale n’était pas qu’une idée, c’était
une part importante de ma vie, et ça l’est toujours aujourd’hui. Aussi, une
fois que je m’étais rapproché de Rwandais, que certains étaient devenus mes
amis, j’ai su que je devrais parler de leurs histoires, du génocide. Je savais
que le génocide du Rwanda allait être au cœur de mes écrits.
Vous citez Jean Hatzfeld en exergue de votre
roman. Savez-vous qu’il a aussi écrit un roman, Où en est la nuit, dans lequel il met en scène un coureur éthiopien
dans la guerre ? Quelles réflexions vous inspire cette coïncidence ?
Ah! Je ne savais pas ! C’est
incroyable ! [En
français dans le texte.] Ça m’intimide. Jean Hatzfed est l’un des écrivains
que j’admire le plus et j’espère un jour le rencontrer et lui parler en tête à
tête.
Le sport semble être, pour Jean-Patrick, un moyen
d’échapper aux tensions de son pays. Mais la haine est plus forte que le sport.
Plus forte que tout ?
Non.
Je ne peux pas croire ça. Au début, je me suis mis à écrireCourir
sur la faille pour faire « découvrir »
l’histoire du génocide à l’Occident, mais au fil de l’écriture et de mes
rencontres avec les Rwandais, j’ai commencé à comprendre que je n’écrivais pas
une histoire de haine mais d’amour, une histoire de courage, et je pressentais
qu’à la fin, ils l’emporteraient sur la haine. Même maintenant, avec tout ce qu’il
se passe en Syrie et en Egypte et même – oui – au sein du gouvernement
américain, je continue à croire que l’amour et la compassion l’emporteront.
Magazine Culture
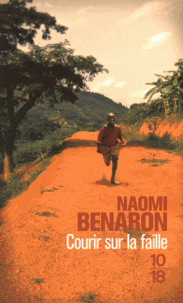 Le sport et la guerre. La
proximité des thèmes n’est pas nouvelle. Dans Courir sur la faille, son premier roman, Naomi Benaron
l’exploite avec intelligence sans en nier la complexité. C’est au Rwanda où,
avant le génocide, Jean-Patrick Nkuba caresse l’espoir de représenter son pays
aux Jeux olympiques. Il a toujours aimé courir. Tutsi, il ignorait cependant
qu’il deviendrait l’otage d’un régime avant de devenir, comme tant d’autres,
une cible à abattre. Champion ou non. Un symbole, en tout cas.
Vous souvenez-vous d’avril 1994 et des trois mois
qui suivirent ? Aviez-vous, à ce moment, des échos de ce qui se passait au
Rwanda ou bien est-ce venu plus tard ?
Oui, je m’en rappelle très bien. Le plus terrible,
pour moi, a été le désintérêt des médias après quelques semaines : le
génocide a fait l’objet d’une énorme couverture médiatique pendant un certain
temps, puis l’intérêt s’est tourné vers d’autres nouvelles comme le suicide de
Kurt Cobain et le meurtre de la femme d’O. J. Simpson, Nicole Brown Simpson. Je
me souviens d’avoir eu ce sentiment horrible de terreur mêlé à l’impuissance,
liée certainement à l’histoire de ma famille durant l’Holocauste. Je me sentais
coupable de ne rien pouvoir faire et j’imagine qu’écrire Courir sur la faille a été ma façon de gérer cette culpabilité.
Quand vous êtes allée au Rwanda en 2002,
aviez-vous déjà une idée en tête, ou bien s’agissait-il seulement, comme vous
le dites, de tourisme ?
Je savais pour le génocide et je m’étais préparée à
voir les traces de cette guerre, mais en aucun cas à voir des stigmates de la
guerre aussi frais, aussi visibles. Je n’étais pas prête à voir les maisons et
autres bâtiments recouverts d’impacts de balle et certainement pas à découvrir
des ossements éparpillés, dépassant du sable telles des racines, sur les rives
du lac Kivu. Mais je pense que quelle que soit l’idée qu’on s’en fait, on ne
peut jamais imaginer les blessures et les cicatrices laissées par un génocide.
Je partais pour découvrir… tout ce que ce que je pourrais trouver, mais le but
de mon voyage était d’assister au 90e anniversaire de Rosamond Carr.
Avant Courir
sur la faille, vous aviez publié un recueil de nouvelles, non traduit en
français, Love Letters from a Fat Man.
Il y était déjà question du Rwanda. Est-il possible, en écrivant, de se
détacher du drame de ce pays quand on en a côtoyé les conséquences ?
Dans mon cas, il était impossible de m’en détacher. J’ai
été élevée dans une famille où la justice sociale n’était pas qu’une idée, c’était
une part importante de ma vie, et ça l’est toujours aujourd’hui. Aussi, une
fois que je m’étais rapproché de Rwandais, que certains étaient devenus mes
amis, j’ai su que je devrais parler de leurs histoires, du génocide. Je savais
que le génocide du Rwanda allait être au cœur de mes écrits.
Vous citez Jean Hatzfeld en exergue de votre
roman. Savez-vous qu’il a aussi écrit un roman, Où en est la nuit, dans lequel il met en scène un coureur éthiopien
dans la guerre ? Quelles réflexions vous inspire cette coïncidence ?
Ah! Je ne savais pas ! C’est
incroyable ! [En
français dans le texte.] Ça m’intimide. Jean Hatzfed est l’un des écrivains
que j’admire le plus et j’espère un jour le rencontrer et lui parler en tête à
tête.
Le sport semble être, pour Jean-Patrick, un moyen
d’échapper aux tensions de son pays. Mais la haine est plus forte que le sport.
Plus forte que tout ?
Non.
Je ne peux pas croire ça. Au début, je me suis mis à écrireCourir
sur la faille pour faire « découvrir »
l’histoire du génocide à l’Occident, mais au fil de l’écriture et de mes
rencontres avec les Rwandais, j’ai commencé à comprendre que je n’écrivais pas
une histoire de haine mais d’amour, une histoire de courage, et je pressentais
qu’à la fin, ils l’emporteraient sur la haine. Même maintenant, avec tout ce qu’il
se passe en Syrie et en Egypte et même – oui – au sein du gouvernement
américain, je continue à croire que l’amour et la compassion l’emporteront.
Le sport et la guerre. La
proximité des thèmes n’est pas nouvelle. Dans Courir sur la faille, son premier roman, Naomi Benaron
l’exploite avec intelligence sans en nier la complexité. C’est au Rwanda où,
avant le génocide, Jean-Patrick Nkuba caresse l’espoir de représenter son pays
aux Jeux olympiques. Il a toujours aimé courir. Tutsi, il ignorait cependant
qu’il deviendrait l’otage d’un régime avant de devenir, comme tant d’autres,
une cible à abattre. Champion ou non. Un symbole, en tout cas.
Vous souvenez-vous d’avril 1994 et des trois mois
qui suivirent ? Aviez-vous, à ce moment, des échos de ce qui se passait au
Rwanda ou bien est-ce venu plus tard ?
Oui, je m’en rappelle très bien. Le plus terrible,
pour moi, a été le désintérêt des médias après quelques semaines : le
génocide a fait l’objet d’une énorme couverture médiatique pendant un certain
temps, puis l’intérêt s’est tourné vers d’autres nouvelles comme le suicide de
Kurt Cobain et le meurtre de la femme d’O. J. Simpson, Nicole Brown Simpson. Je
me souviens d’avoir eu ce sentiment horrible de terreur mêlé à l’impuissance,
liée certainement à l’histoire de ma famille durant l’Holocauste. Je me sentais
coupable de ne rien pouvoir faire et j’imagine qu’écrire Courir sur la faille a été ma façon de gérer cette culpabilité.
Quand vous êtes allée au Rwanda en 2002,
aviez-vous déjà une idée en tête, ou bien s’agissait-il seulement, comme vous
le dites, de tourisme ?
Je savais pour le génocide et je m’étais préparée à
voir les traces de cette guerre, mais en aucun cas à voir des stigmates de la
guerre aussi frais, aussi visibles. Je n’étais pas prête à voir les maisons et
autres bâtiments recouverts d’impacts de balle et certainement pas à découvrir
des ossements éparpillés, dépassant du sable telles des racines, sur les rives
du lac Kivu. Mais je pense que quelle que soit l’idée qu’on s’en fait, on ne
peut jamais imaginer les blessures et les cicatrices laissées par un génocide.
Je partais pour découvrir… tout ce que ce que je pourrais trouver, mais le but
de mon voyage était d’assister au 90e anniversaire de Rosamond Carr.
Avant Courir
sur la faille, vous aviez publié un recueil de nouvelles, non traduit en
français, Love Letters from a Fat Man.
Il y était déjà question du Rwanda. Est-il possible, en écrivant, de se
détacher du drame de ce pays quand on en a côtoyé les conséquences ?
Dans mon cas, il était impossible de m’en détacher. J’ai
été élevée dans une famille où la justice sociale n’était pas qu’une idée, c’était
une part importante de ma vie, et ça l’est toujours aujourd’hui. Aussi, une
fois que je m’étais rapproché de Rwandais, que certains étaient devenus mes
amis, j’ai su que je devrais parler de leurs histoires, du génocide. Je savais
que le génocide du Rwanda allait être au cœur de mes écrits.
Vous citez Jean Hatzfeld en exergue de votre
roman. Savez-vous qu’il a aussi écrit un roman, Où en est la nuit, dans lequel il met en scène un coureur éthiopien
dans la guerre ? Quelles réflexions vous inspire cette coïncidence ?
Ah! Je ne savais pas ! C’est
incroyable ! [En
français dans le texte.] Ça m’intimide. Jean Hatzfed est l’un des écrivains
que j’admire le plus et j’espère un jour le rencontrer et lui parler en tête à
tête.
Le sport semble être, pour Jean-Patrick, un moyen
d’échapper aux tensions de son pays. Mais la haine est plus forte que le sport.
Plus forte que tout ?
Non.
Je ne peux pas croire ça. Au début, je me suis mis à écrireCourir
sur la faille pour faire « découvrir »
l’histoire du génocide à l’Occident, mais au fil de l’écriture et de mes
rencontres avec les Rwandais, j’ai commencé à comprendre que je n’écrivais pas
une histoire de haine mais d’amour, une histoire de courage, et je pressentais
qu’à la fin, ils l’emporteraient sur la haine. Même maintenant, avec tout ce qu’il
se passe en Syrie et en Egypte et même – oui – au sein du gouvernement
américain, je continue à croire que l’amour et la compassion l’emporteront.
