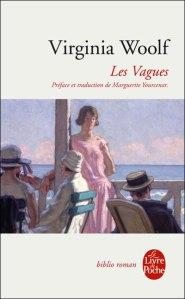 Les Vagues…
Les Vagues…
« Le vent se leva. Les vagues résonnèrent sur le rivage comme des tambours, semblables à des guerriers enturbannés, à des hommes enturbannés, qui brandissent leurs sagaies empoisonnées au-dessus de leur tête et se précipitent à la rencontre des moutons blancs. » (p. 80)
J’écris de justesse ce billet au terme d’un mois anglais qui m’aura apporté bien des envies de lectures nouvelles et un plaisir nouveau de partager ma passion livresque avec d’autres mordus.
Chaque matin ou presque, je cliquais plus ou moins fébrilement sur la page FB du mois anglais, pour voir qui avait posté son billet, de quels livres il s’agissait, s’il y en avait beaucoup ou peu, et je guettais les petites phrases rigolotes des uns et des autres. Tout cela m’a maintenue dans l’espèce de fog scintillant, très énergisant, que constitue une communauté d’affinités. Cela va me manquer, mais aussi me permettre de reprendre mon souffle, un rythme d’été plus alangui et m’éloigner pour un temps du rivage de l’Angleterre.
Mais revenons à nos moutons, les vagues ;-)
Je l’avoue, j’écris ce billet sans avoir terminé le livre, ce qui n’est « pas bien, pas bien » au vu des règles implicites gouvernant le petit monde de la blogosphère littéraire ! Mais je souhaitais à tout prix inclure cette dernière lecture, comme un point d’orgue à « mon » mois anglais, dont l’envie m’a été donnée par un très joli billet de Romanza.
C’est la première fois que je lis du Virginia Woolf, et je n’en avais pas tellement d’idées préconçues, à part une impression de littérature vaguement barbante qui ne m’incitait pas du tout à la découvrir. Heureusement, le petit cupidon des blogs littéraires a agi en m’envoyant sa flèche pleine de promesses, et j’ai plongé (que ceux qui en ont assez des métaphores marines lèvent la main !)
Et je ne le regrette pas ! Les Vagues, c’est un sextettes de six voix : celles de trois garçons, et trois filles qui se fréquentent, que l’on découvre à l’âge tendre de l’enfance et que l’on quitte, je le prévois, à l’orée de leur vie. Pour l’instant, j’en suis à leur âge d’entrée dans la vie adulte, p. 103 de l’édition poche très exactement.
C’est un procédé littéraire nouveau pour moi : c’est la voix intérieure des personnages qui parle, et chacune se succède à la manière des vagues, mêlant considérations triviales, comme les détails vestimentaires, pensées philosophiques, sentiments, émotions, sensations, retours sur soi, réminiscences, plus rarement l’action en train de se produire, réverbérée par la conscience du personnage. Comme ce voyage en train, où la conscience de Suzanne s’attarde entre les paysannes dehors, aperçues par la vitre, le contrôleur, son propre corps, et la conscience de l’organisme rugissant du train :
« Voici le contrôleur, et voici deux hommes, trois femmes, et un chat dans un panier ; me voici moi-même, le coude posé sur le rebord de la portière : tout cela fait partie de l’instant présent et du lieu où nous sommes. Nous avançons ; nous faisons route à travers des champs de blé murmurants et dorés. Les femmes occupées à sarcler les champs sont surprises, parce que nous les laissons derrière nous. Le train monte, maintenant, et sa marche se fait pesante, et sa respiration oppressée. Enfin, nous sommes tout en haut, sur la lande. Quelques moutons, quelques poneys aux crinières emmêlées vivent seuls ici à l’état sauvage ; et cependant, nous sommes entourés du plus grand confort ; nous avons des tables pour poser nos journaux, et des anneaux pour placer nos verres. Nous transportons ces objets avec nous à travers la lande. » (p. 70)
Les identités de chacun des six personnages se précisent peu à peu, mais leur individualité a tendance à s’estomper ou se recomposer comme un kaléidoscope, au gré de leur humeur, des moments partagés avec d’autres.
« Les voilà de retour, mes hôtes familiers. La brèche faite en moi par l’admirable coup d’épée de Neville est maintenant refermée. Je redeviens moi-même, et je mets joyeusement en jeu tout ce que Neville ignore en moi. » (p. 94)
Chaque âge de la vie est séparé par la description de la mer et d’un jardin balnéaire. J’ai mis un peu de temps à comprendre la signification de cette pause purement paysagère et je n’en livrerai pas ici la clé, laissant aux futurs potentiels lecteurs le plaisir de la découvrir.
Virginia a l’art de faire ressentir au lecteur la sensation mouvante de l’entrée dans le sommeil ou l’expérience existentielle d’une promenade matinale dans la nature :
« Je vais mettre mes bas, et sortir sans bruit. Je vais descendre à la cuisine, me glisser dans le jardin, dépasser la serre, et me promener dans les champs. il est encore très tôt. Des brouillards montent de la lande. L’air est raide et froid comme la toile d’un linceul. Mais tout va s’adoucir ; tout va se réchauffer. A cette heure si matinale, j’ai l’impression de ne faire qu’un avec les champs, avec la grange, avec les arbres. Tout est à moi : les oiseaux qui volent par bandes, et ce jeune lièvre qui saute, au moment précis où j’allais poser le pied sur lui. Tout est à moi : le héron qui étend paresseusement ses grandes ailes ; la vague qui tout en mangeant s’avance d’un pas lourd ; et l’hirondelle farouche qui fond du ciel ; et l’horizon rouge pâle, et la teinte verte où cette rougeur se perd. Et le silence ; et le bruit des cloches ; et le cri de l’ouvrier de ferme qui appelle les chevaux de trait épars dans les champs m’appartiennent aussi. » (p. 101)
On entre dans ce livre, que j’hésite à qualifier de roman, comme on ouvre une huître : il faut forcer un peu l’entrée, se montrer persévérant les (20) premières pages (pour moi), et ensuite on se délecte d’un plaisir délicat de lecture, concentré et intense, tout en récoltant quelques perles précieuses ici et là.
Certaines perles sont étonnantes de précision dans leur matérialité concrète : « Sur la table de cuisine Biddy gratte les écailles de poisson avec un couteau ébréché » (p. 20) (J’ai en tête Mrs Patmore, cuisinière de Downton Abbey !)
D’autres nous font dire « Mais bien sûr ! J’ai déjà ressenti cela. » Pour moi, plus particulièrement quand il s’agit de Bernard, sympathique et débonnaire, en constante représentation devant lui-même, peaufinant sa future biographie dans sa tête :
« Quand je murmure « Bernard, qui est-ce qui fait son apparition ? Un homme au coeur fidèle, désillusionné, sardonique, mais nullement aigri. Un homme sans âge, sans position sociale. Moi, tout simplement. C’est lui qui prend le tisonnier et remue en cet instant les cendres, pour les faire tomber en pluie à travers la grille. « Bon Dieu, quelle saleté », se dit-il lugubrement, mais en guise de consolation : « La mère Moffat va venir balayer tout ça. » Je crois que je me répéterai souvent cette phrase, au cours de ma promenade cahotée à travers la vie. C’est vrai, la mère Moffat va venir balayer tout ça. Ainsi donc, allons-nous coucher. » (p. 86).
et
« Il m’est impossible de lire en chemin de fer sans m’interrompre pour me demander si mon voisin est entrepreneur, si ma voisine est malheureuse. » (p. 81)
Il ne faut pas chercher à tout saisir avec la raison, mais ressentir à l’unisson des personnages. La traduction en français de Marguerite Yourcenar est suffisamment magnifique pour qu’on ne culpabilise pas de ne pas le lire en langue originale (ce qui vaut sûrement le coup d’être tenté).
C’est une littérature bien particulière que j’ai découverte là et vers laquelle je reviendrai à coup sûr, comme on goûte de la gastronomie fine, à petites bouchées longuement retournées en bouche.
C’était ma dernière participation au mois anglais 2015 : un big Thank You aux organisatrices Lou, Titine et Cryssilda !


