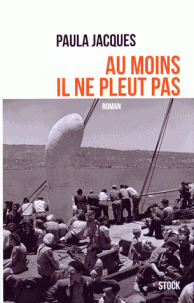 Dernier jour, déjà, du Festival Etonnants Voyageurs (essayez d'y aller voir, vous constaterez que le temps y passe à tout allure). Et rencontre avec Paula Jacques, parmi des centaines d'invités.
En dix romans, depuis Lumière
de l’œil, Paula Jacques a écrit une sorte d’autobiographie de biais. Dans
le plus récent, Au moins il ne pleut pas,
Lola et Solly Sasson, 15 et 14 ans, débarquent à Haïfa, dans le pays encore
neuf qu’est Israël en 1959. Ils ont quitté l’Egypte où leurs parents sont morts
dans un accident de voiture et craignent d’être séparés après leur prise en
charge par l’Agence juive. Ils ne connaissent rien du monde où ils arrivent.
Mais pressentent qu’ils vont devoir mentir pour rester ensemble et compter
aveuglément sur l’aide d’inconnus, au risque de tomber sur d’autres menteurs.
Une vie sur le fil de la précarité, avec la volonté de s’en sortir.
Vous vous défendez
souvent d’utiliser une inspiration autobiographique…
C’est situé le plus
souvent dans le même univers d’immigration de Juifs d’Egypte, mais mes romans
ne sont autobiographiques que sur le plan affectif. Les sentiments que
j’exprime, les situations que je peux inventer découlent d’un rapport
émotionnel à ces situations.
Dans cette mesure-là,
Lola est quand même un peu vous ?
C’est moi par
l’obsession de la lecture, par la propension à imaginer des secrets et des
mystères derrière les choses et les gens les plus banals en apparence. Mais je
n’ai pas été aussi empotée qu’elle peut le paraître dans le livre. Parce
qu’après un certain nombre d’expériences douloureuses dans mon enfance, j’ai
toujours eu un côté « survivante », j’ai su que plus jamais je ne
connaîtrais ça et que j’arriverais toujours à me sortir des pires situations en
ne comptant que sur moi-même. J’avais un peu le côté débrouillard et voyou du
petit frère.
Votre frère Victor, à
qui vous dédiez le livre, ressemblait-il à Solly ?
Je lui ai emprunté
beaucoup de choses, c’était un garçon un peu délinquant, parce que ne sachant
pas comment s’en sortir autrement. Jusqu’au jour où il a rencontré une Corse
dont il est tombé amoureux et qui l’a remis dans le droit chemin.
Quand vous racontez
les premiers temps de Lola et Solly en Israël, cherchez-vous à décrire leur
côté perdu ?
Oui, et c’est
exactement mon expérience. A peine étions-nous arrivés que nous avons été
séparés, le grand frère, le petit frère et moi. Nous ne nous sommes pas vus
pendant trois ans. Le sentiment d’être perdu et d’avoir été remis à une
autorité qui décide de tout, de votre destin, je l’ai éprouvé.
Ils arrivent sur une
terre où l’immigration est d’origine variée. Comment peuvent-ils comprendre ?
Lola ne vit que dans
ses livres et, quand elle ne lit pas, elle invente des histoires romanesques,
notamment à propos de la sexualité de Ruthie. On ne sait pas si c’est vrai,
mais c’est vraisemblable. Lola, en revanche, ne voit pas que le secret le plus
lourd se cache sous l’apparence rayonnante de Magda.
Vous n’expliquez pas
tout…
Non, ce n’est pas
utile. Ce qui est intéressant, c’est le renversement dans l’évolution
psychologique des personnages. Comment Ruthie, quand Magda tombe dans la
dépression, monte au créneau. La force de l’une passe dans l’autre, ce qui
permettra de maintenir la famille. J’ai voulu travailler là-dessus aussi, parce
que c’est aussi l’histoire universelle d’une recherche d’amour et de protection
dans un monde très dur, d’une famille qui se constitue avec deux orphelins et
deux femmes qui, ayant tout perdu, n’auront pas d’enfants.
Au-delà de la
famille, c’est aussi un pays qui se constitue ?
Dernier jour, déjà, du Festival Etonnants Voyageurs (essayez d'y aller voir, vous constaterez que le temps y passe à tout allure). Et rencontre avec Paula Jacques, parmi des centaines d'invités.
En dix romans, depuis Lumière
de l’œil, Paula Jacques a écrit une sorte d’autobiographie de biais. Dans
le plus récent, Au moins il ne pleut pas,
Lola et Solly Sasson, 15 et 14 ans, débarquent à Haïfa, dans le pays encore
neuf qu’est Israël en 1959. Ils ont quitté l’Egypte où leurs parents sont morts
dans un accident de voiture et craignent d’être séparés après leur prise en
charge par l’Agence juive. Ils ne connaissent rien du monde où ils arrivent.
Mais pressentent qu’ils vont devoir mentir pour rester ensemble et compter
aveuglément sur l’aide d’inconnus, au risque de tomber sur d’autres menteurs.
Une vie sur le fil de la précarité, avec la volonté de s’en sortir.
Vous vous défendez
souvent d’utiliser une inspiration autobiographique…
C’est situé le plus
souvent dans le même univers d’immigration de Juifs d’Egypte, mais mes romans
ne sont autobiographiques que sur le plan affectif. Les sentiments que
j’exprime, les situations que je peux inventer découlent d’un rapport
émotionnel à ces situations.
Dans cette mesure-là,
Lola est quand même un peu vous ?
C’est moi par
l’obsession de la lecture, par la propension à imaginer des secrets et des
mystères derrière les choses et les gens les plus banals en apparence. Mais je
n’ai pas été aussi empotée qu’elle peut le paraître dans le livre. Parce
qu’après un certain nombre d’expériences douloureuses dans mon enfance, j’ai
toujours eu un côté « survivante », j’ai su que plus jamais je ne
connaîtrais ça et que j’arriverais toujours à me sortir des pires situations en
ne comptant que sur moi-même. J’avais un peu le côté débrouillard et voyou du
petit frère.
Votre frère Victor, à
qui vous dédiez le livre, ressemblait-il à Solly ?
Je lui ai emprunté
beaucoup de choses, c’était un garçon un peu délinquant, parce que ne sachant
pas comment s’en sortir autrement. Jusqu’au jour où il a rencontré une Corse
dont il est tombé amoureux et qui l’a remis dans le droit chemin.
Quand vous racontez
les premiers temps de Lola et Solly en Israël, cherchez-vous à décrire leur
côté perdu ?
Oui, et c’est
exactement mon expérience. A peine étions-nous arrivés que nous avons été
séparés, le grand frère, le petit frère et moi. Nous ne nous sommes pas vus
pendant trois ans. Le sentiment d’être perdu et d’avoir été remis à une
autorité qui décide de tout, de votre destin, je l’ai éprouvé.
Ils arrivent sur une
terre où l’immigration est d’origine variée. Comment peuvent-ils comprendre ?
Lola ne vit que dans
ses livres et, quand elle ne lit pas, elle invente des histoires romanesques,
notamment à propos de la sexualité de Ruthie. On ne sait pas si c’est vrai,
mais c’est vraisemblable. Lola, en revanche, ne voit pas que le secret le plus
lourd se cache sous l’apparence rayonnante de Magda.
Vous n’expliquez pas
tout…
Non, ce n’est pas
utile. Ce qui est intéressant, c’est le renversement dans l’évolution
psychologique des personnages. Comment Ruthie, quand Magda tombe dans la
dépression, monte au créneau. La force de l’une passe dans l’autre, ce qui
permettra de maintenir la famille. J’ai voulu travailler là-dessus aussi, parce
que c’est aussi l’histoire universelle d’une recherche d’amour et de protection
dans un monde très dur, d’une famille qui se constitue avec deux orphelins et
deux femmes qui, ayant tout perdu, n’auront pas d’enfants.
Au-delà de la
famille, c’est aussi un pays qui se constitue ?
Oui, il doit accueillir des groupes de cultures et de traditions différentes et, à l’époque, il n’est pas du tout expansionniste. C’est un Israël qui ne ressemble pas du tout à ce qu’il est aujourd’hui.
