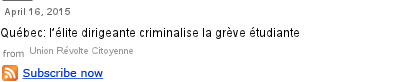Le premier ministre du Québec Philippe Couillard a personnellement contacté le recteur de l’UQAM Robert Proulx pour exiger le recours à la force afin d’écraser la contestation étudiante. Par cette répression sans précédent entre les murs d’un établissement d’enseignement public, le gouvernement libéral cherche, avec le plein soutien de toute l’élite dirigeante québécoise, à éradiquer toute forme de militantisme parmi les étudiants afin d’intimider la classe ouvrière et imposer un programme d’austérité qui va mener à la dévastation sociale.
La situation a débuté mercredi dernier lorsqu’une trentaine d’étudiants, qui tentaient de stopper la tenue de cours dans quelques pavillons de l’UQAM pour faire respecter un vote de grève, ont été interpellés puis bousculés par des agents de sécurité embauchés par la direction de l’université. Les étudiants ont obtempéré, puis quitté les lieux.
Quelques heures plus tard, cependant, les forces de l’ordre sont intervenues massivement, provoquant des échanges violents avec les manifestants. Des professeurs ont spontanément tenté de se placer entre la police et les étudiants afin d’empêcher les altercations. La police a finalement procédé à l’arrestation de 21 personnes, âgées de 18 à 36 ans, qui ont été accusées de méfait et d’attroupement illégal.
Le soir de l’événement, environ 200 étudiants ont décidé d’occuper l’entrée du pavillon J.-A.-DeSève pour protester contre les arrestations. Ils avaient barricadé les entrées avec des tables et des chaises alors que régnait une ambiance festive. Une poignée d’étudiants, certains cagoulés, auraient commis des actes de vandalisme, créant des tensions avec les étudiants qui occupaient l’édifice pacifiquement.
Peu après minuit, après avoir reçu d'un responsable de l'UQAM un avis pour mettre fin à l'occupation, les agents du service de police de Montréal ont défoncé une porte vitrée à coups de hache et pénétré dans l’établissement. Les étudiants se sont échappés par l’arrière de l’établissement et, au cours de la nuit, les policiers ont poursuivi les manifestants dans les rues, les dispersant avec des gaz lacrymogènes et procédant à cinq arrestations.
La brutalité policière de mercredi dernier a été cautionnée par le premier ministre. Les grands médias et tout l’establishment politique, y compris le Parti québécois, ont dénoncé en chœur les soi-disant actes de «violence» des étudiants. Mettant la réalité la tête en bas, ils présentent la répression étatique comme la conséquence des «comportements inacceptables» des manifestants. Face à cette campagne virulente, Québec Solidaire, supposément de gauche, s’est contenté d’appeler au dialogue pour «éviter des dérapages malheureux».
La cause de la colère étudiante est le programme d’austérité du gouvernement, qui prévoit des coupures de plusieurs milliards de dollars dans les services publics, les emplois, les salaires et l’ensemble des acquis sociaux gagnés de haute lutte par des générations de travailleurs. Les vrais intimidateurs sont assis sur les bancs de l’Assemblée nationale du Québec et dans les salles de rédaction des médias de la grande entreprise.
Tout au long du conflit, le recteur Robert Proulx a envenimé le climat. À la demande du gouvernement, il s’est muni d’une injonction émise par la Cour supérieure pour empêcher les étudiants de bloquer l’accès aux cours, et il a annoncé l’expulsion sans précédent de 9 étudiants impliqués dans des levées de cours et autres gestes de protestation au cours des deux dernières années. Le 7 avril, le recteur a envoyé un courriel annonçant que le calendrier ne serait pas changé et ordonnant aux professeurs de donner leurs cours même devant des salles vides. Le recteur a refusé à maintes reprises de dialoguer avec les étudiants malgré les nombreuses demandes en ce sens.
Si certains étudiants étaient masqués, c’est parce que la direction de l’UQAM a installé des caméras supplémentaires et embauché, au coût de 500.000 dollars, un nombre imposant d’agents de sécurité de la firme privée Gardium pour surveiller et pister les étudiants.
Les quelques actes de vandalisme commis à l’UQAM auraient été l’œuvre d’une poignée d’anarchistes – possiblement liés au Black Bloc – qui cherchent uniquement la confrontation avec la police. Il existe d’ailleurs une longue histoire d’infiltration policière de ces groupes anarchistes et de nombreux cas où des agents provocateurs ont incité des jeunes à commettre des actes illégaux. Le soir de l’occupation, des voitures du SPVM (service de police de la ville de Montréal) ont été abandonnées sans surveillance à la sortie de l’UQAM pour être vandalisées.
Le Parti québécois, la Fédération des cégeps, des associations étudiantes et des syndicats ont réagi aux événements survenus à l’UQAM en appelant à l’encadrement du droit de grève des étudiants – qui fait partie d’une longue tradition au Québec maintenant remise en cause. Une telle législation serait réactionnaire d’un bout à l’autre. Elle serait calquée sur les lois du travail qui encadrent les syndicats et limitent, voire suppriment, le droit de grève. Elle placerait une série d’obstacles à l’exercice de ce droit et serait invoquée à la première occasion pour justifier la répression des étudiants.
Mais cette proposition a été balayée du revers de la main par les libéraux. Tout au long du conflit, le gouvernement a refusé de reconnaître le droit de grève des étudiants. Lors d’un point de presse, le ministre de l’éducation, François Blais, a qualifié l’éducation publique de «don» et il a réitéré que son gouvernement ne reconnaissait que le «droit d’étudier».
La ligne dure du gouvernement représente un sérieux avertissement pour la classe ouvrière. Les mesures de répression dirigées contre les étudiants ne sont qu’un avant-goût de ce qui attend les travailleurs qui s’opposent au saccage de leurs conditions de vie – et en particulier le demi-million d’employés du secteur public qui font face à une offensive frontale du gouvernement libéral comprenant un gel des salaires, des suppressions massives de postes, et la destruction de leurs régimes de pensions.
Face à ce danger, les syndicats ne font rien pour mobiliser leurs membres et préparer une contre-offensive. Comme lors de la grève étudiante de 2012, les centrales syndicales ont refusé d’appuyer les étudiants, facilitant la répression et donnant de facto au gouvernement le feu vert pour l’imposition de son programme d’austérité. Ayant repoussé toute possibilité d’action jusqu’à l’automne ou l’an prochain, les syndicats ont déjà annoncé qu’ils n’ont aucune intention d’entrer en confrontation avec le gouvernement et de déclencher une grève, ce qu’ils appellent le moyen de pression «ultime».
Bien que la grève étudiante ait entraîné dans ses rangs, depuis un mois maintenant, des dizaines de milliers d’étudiants à travers la province – il en resterait plus de 20 000 répartis sur neuf campus – celle-ci montre des signes d’essoufflement. Il existe toujours une vaste opposition à l’austérité parmi les étudiants, et surtout au sein de la classe ouvrière, la cible principale du gouvernement. Toutefois, aucune des factions de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ), qui a mené les grèves étudiantes en 2012 et aujourd’hui, ne présente une perspective viable.
D’un côté, la faction plus «conservatrice» continue de se soumettre entièrement à la bureaucratie syndicale, laquelle a clairement annoncé qu’elle ne mènerait aucune action, y compris une soi-disant «grève sociale», aux côtés des étudiants. L’autre faction, apparemment plus «radicale», prône la poursuite de la grève mais ne fait aucun effort pour rallier les travailleurs à la lutte contre l’austérité, se limitant à des appels futiles dirigés vers l’élite dirigeante.
Les mesures draconiennes du gouvernement Couillard ne sont pas de nature purement «idéologique», mais sont dictées par la logique des contradictions du système capitaliste. Comme les élites dirigeantes à travers le monde, la bourgeoisie québécoise est déterminée à faire payer les travailleurs pour la pire crise économique depuis la Deuxième Guerre mondiale.
La seule option viable pour contrer l’austérité est un tournant vers la classe ouvrière internationale, la seule force sociale ayant intérêt à renverser le système de profit et à transformer la société sur la base des besoins humains. Le développement d’un mouvement indépendant de la classe ouvrière signifie une lutte intransigeante contre la bureaucratie syndicale, qui subordonne les travailleurs à la classe dirigeante et les enchaîne au capitalisme.
Source : WSWS