
Etrange et douloureuse journée.
Un prélude à l’été.
Puis l’annonce simultanée de la mort de deux êtres chers.
Deux écrivains.
Deux écrivains dont les textes m’accompagnent depuis si longtemps que j’ai aujourd’hui l’impression d’atteindre, en leur compagnie, à une sorte d’éternité.
Leur rassurante, leur édifiante compagnie.
Günter Grass.
Plus d’un demi-siècle déjà.
Ce que fut mon enthousiasme lorsque je lus « Le Tambour ».
Günter Grass que je n’ai jamais quitté, vers lequel je reviens si souvent, et qui ne cesse pas de me surprendre.
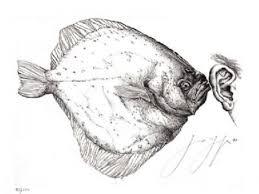
Mon vieux rêve jamais accompli : entamer une errance jusqu’aux confins de la Baltique, afin de tenter de percer quelques-uns des mystères enfouis dans ses romans.
Günter Grass qui jamais ne dissimula ses contradictions, qui les assuma à l’intérieur comme à l’extérieur de ce que d’autres ne conçoivent que comme un univers clos, celui de la création.
Günter Grass qui fut tout à la fois un écrivain majeur du siècle qui eut la décence de s’éteindre avant lui mais aussi un homme d’engagements au sein de ce que nous appelions autrefois « les forces de progrès ».
Günter Grass qui porta le lourd fardeau d’une adolescence vécue au cœur de l’abomination nazie, celle dont les cicatrices qu’elle laissa en lui ne se refermèrent jamais.
Un homme de bien.
Un homme qui tenta de surnager parmi les tempêtes et les ouragans qui abîmèrent l’autre siècle et s’amplifient dans celui qui vient de s’ouvrir.
Un homme dont l’œuvre témoigne qu’il n’est réductible à aucun des clichés et raccourcis dont s’accommodent ceux qui n’ont de cesse, eux, de courber l’échine et de patauger dans le magma des idées reçues.

François Maspero.
Editeur et écrivain.
Traducteur.
Libraire.
Le plus discret des passeurs de savoirs, d’idées, de réflexions, d’interrogations.
C’est dans sa librairie, « La Joie de Lire », que tout jeune homme, je découvris les écrits d’un certain Frantz Fanon.
C’est l’éditeur qui ensuite me tint en éveil, m’aidant à travers ses publications à ne point trop m’engluer dans mes certitudes, en particulier au cours des mois qui suivirent les jours du plus somptueux mois de mai qu’il m’ait été donné de vivre.
C’est le traducteur, celui qui me permit d’aborder à d’autres écrivains : Sepulveda, Ruiz Zafon, Perez Reverde…
C’est l’écrivain, depuis « Le sourire du chat » jusqu’à « Des saisons au bord de la mer ».

Dans une proximité intellectuelle et émotionnelle de quasi tous les instants.
Il existait comme une parenté entre ces deux hommes-là, l’Allemand et le Français.
Les exégètes me démontreront très certainement le contraire.
Je m’en contrefous.

En ce jour qui prélude à l’été, je m’arroge le droit de les inclure parmi les plus conséquentes de mes références.
Le reste, dont mon incommensurable tristesse, s’enclot dans mes espaces intimes.
