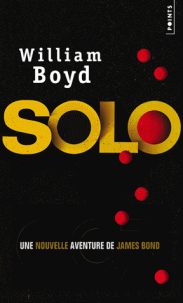 Ian Fleming, le créateur de James Bond, est mort en 1964,
après avoir écrit les aventures de son héros préféré en douze romans et neuf
nouvelles. Depuis, d’autres écrivains ont pris le relais, avec des bonheurs
divers. Kingsley Amis d’abord, puis Sebastian Faulks et Jeffery Deaver, avant
William Boyd l’an dernier, pour un Solo
réédité en poche.
Quand il est envoyé en mission au Zanzarim en 1969, James
Bond connaît peu l’Afrique occidentale : il n’y est allé qu’une fois. Il
prend soin d’emporter un ouvrage qui, espère-t-il, lui fournira quelques
lumières sur la région : Le fond du
problème, de Graham Greene. Le roman est paru vingt ans plus tôt, peu de
temps après une guerre pendant laquelle le romancier a servi en Sierra Leone,
décor d’un livre qui fournit, sans le dire, un clin d’œil au lecteur
curieux : dès les premiers paragraphes du Fond du problème, il est question d’une rue qui s’appelle… Bond
Street. On ne nous fera pas croire que c’est un hasard.
Le Zanzarim ne se trouve bien entendu sur aucune carte. Mais
les images d’une population affamée vues par James Bond ressemblent à celles
qui arrivaient du Biafra à cette époque et William Boyd, né au Ghana, a passé
une partie de son enfance au Nigeria – le pays que la guerre du Biafra aurait
pu mener à la partition. Voilà donc probablement le vague arrière-plan de
réalité sur lequel se fonde Solo, à
partir duquel tout devient possible selon la logique mise au point par Ian
Fleming dès les années 50. Son successeur le plus récent, qui prend le relais
d’autres auteurs, a pris soin de relire l’intégrale du créateur et conserve
l’esprit des origines sans rien perdre de ses propres qualités d’écrivain.
William Boyd précise d’ailleurs, à l’intention des
puristes : « Je m’en suis
remis, pour ce roman, aux détails de la vie et, plus généralement, à la
biographie de James Bond parus dans la “nécrologie” d’On ne vit que deux
fois, le dernier ouvrage de Ian Fleming
publié de son vivant. Il est raisonnable de supposer que ce sont là les faits
essentiels concernant Bond et son existence que l’auteur souhaitait voir
introduire dans le domaine public – et qui feraient litière des anomalies
et illogismes divers figurant dans les précédents romans. Par conséquent, en ce
qui concerne ce livre, et conformément à la décision de Ian Fleming, James Bond
est né en 1924. »
De la même manière que William Boyd revendique sa fidélité
au canon mis en place, malgré quelques hésitations en cours de route, par son
créateur, il reproduit les clichés souvent utilisés. Et devenus davantage que
des clichés : une sorte de marque de fabrique sans laquelle l’agent 007 ne
serait pas exactement ce qu’il est – et doit être dans l’esprit des lecteurs
(ou des spectateurs, au cinéma).
James Bond est donc un homme à femmes. Les 45 ans qu’il
affiche dans Solo n’ont pas endormi
la bête sexuelle qui sommeille en lui. « Il
était encore vert, le vieux ! », se félicite-t-il en constatant
qu’il est émoustillé par une jolie femme rencontrée à l’hôtel, elle-même
n’étant d’ailleurs pas insensible à son charme viril. Bryce Fitzjohn, actrice
sous le nom d’Astrid Ostergard, surgit au début du roman, elle fera d’autres
apparitions dont l’une est liée, par la bande, au récit. Mais elle ne joue
aucun rôle dans les activités de l’agent, au contraire d’Efua Grâce
Ogilvy-Grant, chef du poste britannique et son contact au Zanzarim. Enfin,
presque, car elle s’appelle aussi Aleesha Belem. Bond, après avoir cédé à sa
beauté, aura bien des raisons de se demander quel jeu elle joue et dans quel
camp elle se trouve.
Grâce/Aleesha est le cœur battant de l’Afrique à la
rencontre de laquelle James Bond a été envoyé. Avec une mission toute
simple : faire cesser une guerre qui dure depuis trop longtemps et dont
les conséquences sont tragiques pour la population mais aussi pour les compagnies
pétrolières désireuses d’exploiter tranquillement un sous-sol très riche. Sa
couverture ? Il est censé être le correspondant londonien d’une agence de
presse française a priori favorable au Dahum, le territoire qui a fait
sécession du Zanzarim. Quelques autres journalistes, des vrais ceux-là,
présents dans le pays se demandent quand même qui il est vraiment.
Lancé à corps perdu sur un terrain hostile, Bond est enlevé
par l’infâme Kobus Breed, un mercenaire qui encadre les troupes du Dahum, puis
réhabilité quand son expérience du combat permet d’enlever une victoire. Ce
qu’il appelle reculer pour mieux sauter : s’il redonne un peu de force à
l’armée sécessionniste alors que la politique britannique envisageait plutôt la
déroute de celle-ci, ses actes de bravoure lui permettent d’approcher Solomon
Adeka, le dirigeant du Dahum et l’objectif de sa mission : faire du
général Adeka « un soldat moins
efficace ».
L’efficacité de William Boyd, en tout cas, n’est pas
prise en défaut. De découverte en découverte, Bond brave la mort – il en a
l’habitude – pour mettre au jour une réalité très différente de celle qu’on lui
avait présentée. Et, tout à la fin d’un roman qui se lit en retenant sa
respiration, la porte est ouverte à une suite. Chic !
Ian Fleming, le créateur de James Bond, est mort en 1964,
après avoir écrit les aventures de son héros préféré en douze romans et neuf
nouvelles. Depuis, d’autres écrivains ont pris le relais, avec des bonheurs
divers. Kingsley Amis d’abord, puis Sebastian Faulks et Jeffery Deaver, avant
William Boyd l’an dernier, pour un Solo
réédité en poche.
Quand il est envoyé en mission au Zanzarim en 1969, James
Bond connaît peu l’Afrique occidentale : il n’y est allé qu’une fois. Il
prend soin d’emporter un ouvrage qui, espère-t-il, lui fournira quelques
lumières sur la région : Le fond du
problème, de Graham Greene. Le roman est paru vingt ans plus tôt, peu de
temps après une guerre pendant laquelle le romancier a servi en Sierra Leone,
décor d’un livre qui fournit, sans le dire, un clin d’œil au lecteur
curieux : dès les premiers paragraphes du Fond du problème, il est question d’une rue qui s’appelle… Bond
Street. On ne nous fera pas croire que c’est un hasard.
Le Zanzarim ne se trouve bien entendu sur aucune carte. Mais
les images d’une population affamée vues par James Bond ressemblent à celles
qui arrivaient du Biafra à cette époque et William Boyd, né au Ghana, a passé
une partie de son enfance au Nigeria – le pays que la guerre du Biafra aurait
pu mener à la partition. Voilà donc probablement le vague arrière-plan de
réalité sur lequel se fonde Solo, à
partir duquel tout devient possible selon la logique mise au point par Ian
Fleming dès les années 50. Son successeur le plus récent, qui prend le relais
d’autres auteurs, a pris soin de relire l’intégrale du créateur et conserve
l’esprit des origines sans rien perdre de ses propres qualités d’écrivain.
William Boyd précise d’ailleurs, à l’intention des
puristes : « Je m’en suis
remis, pour ce roman, aux détails de la vie et, plus généralement, à la
biographie de James Bond parus dans la “nécrologie” d’On ne vit que deux
fois, le dernier ouvrage de Ian Fleming
publié de son vivant. Il est raisonnable de supposer que ce sont là les faits
essentiels concernant Bond et son existence que l’auteur souhaitait voir
introduire dans le domaine public – et qui feraient litière des anomalies
et illogismes divers figurant dans les précédents romans. Par conséquent, en ce
qui concerne ce livre, et conformément à la décision de Ian Fleming, James Bond
est né en 1924. »
De la même manière que William Boyd revendique sa fidélité
au canon mis en place, malgré quelques hésitations en cours de route, par son
créateur, il reproduit les clichés souvent utilisés. Et devenus davantage que
des clichés : une sorte de marque de fabrique sans laquelle l’agent 007 ne
serait pas exactement ce qu’il est – et doit être dans l’esprit des lecteurs
(ou des spectateurs, au cinéma).
James Bond est donc un homme à femmes. Les 45 ans qu’il
affiche dans Solo n’ont pas endormi
la bête sexuelle qui sommeille en lui. « Il
était encore vert, le vieux ! », se félicite-t-il en constatant
qu’il est émoustillé par une jolie femme rencontrée à l’hôtel, elle-même
n’étant d’ailleurs pas insensible à son charme viril. Bryce Fitzjohn, actrice
sous le nom d’Astrid Ostergard, surgit au début du roman, elle fera d’autres
apparitions dont l’une est liée, par la bande, au récit. Mais elle ne joue
aucun rôle dans les activités de l’agent, au contraire d’Efua Grâce
Ogilvy-Grant, chef du poste britannique et son contact au Zanzarim. Enfin,
presque, car elle s’appelle aussi Aleesha Belem. Bond, après avoir cédé à sa
beauté, aura bien des raisons de se demander quel jeu elle joue et dans quel
camp elle se trouve.
Grâce/Aleesha est le cœur battant de l’Afrique à la
rencontre de laquelle James Bond a été envoyé. Avec une mission toute
simple : faire cesser une guerre qui dure depuis trop longtemps et dont
les conséquences sont tragiques pour la population mais aussi pour les compagnies
pétrolières désireuses d’exploiter tranquillement un sous-sol très riche. Sa
couverture ? Il est censé être le correspondant londonien d’une agence de
presse française a priori favorable au Dahum, le territoire qui a fait
sécession du Zanzarim. Quelques autres journalistes, des vrais ceux-là,
présents dans le pays se demandent quand même qui il est vraiment.
Lancé à corps perdu sur un terrain hostile, Bond est enlevé
par l’infâme Kobus Breed, un mercenaire qui encadre les troupes du Dahum, puis
réhabilité quand son expérience du combat permet d’enlever une victoire. Ce
qu’il appelle reculer pour mieux sauter : s’il redonne un peu de force à
l’armée sécessionniste alors que la politique britannique envisageait plutôt la
déroute de celle-ci, ses actes de bravoure lui permettent d’approcher Solomon
Adeka, le dirigeant du Dahum et l’objectif de sa mission : faire du
général Adeka « un soldat moins
efficace ».
L’efficacité de William Boyd, en tout cas, n’est pas
prise en défaut. De découverte en découverte, Bond brave la mort – il en a
l’habitude – pour mettre au jour une réalité très différente de celle qu’on lui
avait présentée. Et, tout à la fin d’un roman qui se lit en retenant sa
respiration, la porte est ouverte à une suite. Chic !
Magazine Culture
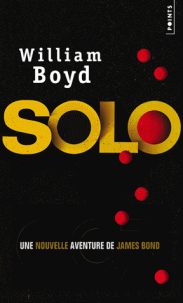 Ian Fleming, le créateur de James Bond, est mort en 1964,
après avoir écrit les aventures de son héros préféré en douze romans et neuf
nouvelles. Depuis, d’autres écrivains ont pris le relais, avec des bonheurs
divers. Kingsley Amis d’abord, puis Sebastian Faulks et Jeffery Deaver, avant
William Boyd l’an dernier, pour un Solo
réédité en poche.
Quand il est envoyé en mission au Zanzarim en 1969, James
Bond connaît peu l’Afrique occidentale : il n’y est allé qu’une fois. Il
prend soin d’emporter un ouvrage qui, espère-t-il, lui fournira quelques
lumières sur la région : Le fond du
problème, de Graham Greene. Le roman est paru vingt ans plus tôt, peu de
temps après une guerre pendant laquelle le romancier a servi en Sierra Leone,
décor d’un livre qui fournit, sans le dire, un clin d’œil au lecteur
curieux : dès les premiers paragraphes du Fond du problème, il est question d’une rue qui s’appelle… Bond
Street. On ne nous fera pas croire que c’est un hasard.
Le Zanzarim ne se trouve bien entendu sur aucune carte. Mais
les images d’une population affamée vues par James Bond ressemblent à celles
qui arrivaient du Biafra à cette époque et William Boyd, né au Ghana, a passé
une partie de son enfance au Nigeria – le pays que la guerre du Biafra aurait
pu mener à la partition. Voilà donc probablement le vague arrière-plan de
réalité sur lequel se fonde Solo, à
partir duquel tout devient possible selon la logique mise au point par Ian
Fleming dès les années 50. Son successeur le plus récent, qui prend le relais
d’autres auteurs, a pris soin de relire l’intégrale du créateur et conserve
l’esprit des origines sans rien perdre de ses propres qualités d’écrivain.
William Boyd précise d’ailleurs, à l’intention des
puristes : « Je m’en suis
remis, pour ce roman, aux détails de la vie et, plus généralement, à la
biographie de James Bond parus dans la “nécrologie” d’On ne vit que deux
fois, le dernier ouvrage de Ian Fleming
publié de son vivant. Il est raisonnable de supposer que ce sont là les faits
essentiels concernant Bond et son existence que l’auteur souhaitait voir
introduire dans le domaine public – et qui feraient litière des anomalies
et illogismes divers figurant dans les précédents romans. Par conséquent, en ce
qui concerne ce livre, et conformément à la décision de Ian Fleming, James Bond
est né en 1924. »
De la même manière que William Boyd revendique sa fidélité
au canon mis en place, malgré quelques hésitations en cours de route, par son
créateur, il reproduit les clichés souvent utilisés. Et devenus davantage que
des clichés : une sorte de marque de fabrique sans laquelle l’agent 007 ne
serait pas exactement ce qu’il est – et doit être dans l’esprit des lecteurs
(ou des spectateurs, au cinéma).
James Bond est donc un homme à femmes. Les 45 ans qu’il
affiche dans Solo n’ont pas endormi
la bête sexuelle qui sommeille en lui. « Il
était encore vert, le vieux ! », se félicite-t-il en constatant
qu’il est émoustillé par une jolie femme rencontrée à l’hôtel, elle-même
n’étant d’ailleurs pas insensible à son charme viril. Bryce Fitzjohn, actrice
sous le nom d’Astrid Ostergard, surgit au début du roman, elle fera d’autres
apparitions dont l’une est liée, par la bande, au récit. Mais elle ne joue
aucun rôle dans les activités de l’agent, au contraire d’Efua Grâce
Ogilvy-Grant, chef du poste britannique et son contact au Zanzarim. Enfin,
presque, car elle s’appelle aussi Aleesha Belem. Bond, après avoir cédé à sa
beauté, aura bien des raisons de se demander quel jeu elle joue et dans quel
camp elle se trouve.
Grâce/Aleesha est le cœur battant de l’Afrique à la
rencontre de laquelle James Bond a été envoyé. Avec une mission toute
simple : faire cesser une guerre qui dure depuis trop longtemps et dont
les conséquences sont tragiques pour la population mais aussi pour les compagnies
pétrolières désireuses d’exploiter tranquillement un sous-sol très riche. Sa
couverture ? Il est censé être le correspondant londonien d’une agence de
presse française a priori favorable au Dahum, le territoire qui a fait
sécession du Zanzarim. Quelques autres journalistes, des vrais ceux-là,
présents dans le pays se demandent quand même qui il est vraiment.
Lancé à corps perdu sur un terrain hostile, Bond est enlevé
par l’infâme Kobus Breed, un mercenaire qui encadre les troupes du Dahum, puis
réhabilité quand son expérience du combat permet d’enlever une victoire. Ce
qu’il appelle reculer pour mieux sauter : s’il redonne un peu de force à
l’armée sécessionniste alors que la politique britannique envisageait plutôt la
déroute de celle-ci, ses actes de bravoure lui permettent d’approcher Solomon
Adeka, le dirigeant du Dahum et l’objectif de sa mission : faire du
général Adeka « un soldat moins
efficace ».
L’efficacité de William Boyd, en tout cas, n’est pas
prise en défaut. De découverte en découverte, Bond brave la mort – il en a
l’habitude – pour mettre au jour une réalité très différente de celle qu’on lui
avait présentée. Et, tout à la fin d’un roman qui se lit en retenant sa
respiration, la porte est ouverte à une suite. Chic !
Ian Fleming, le créateur de James Bond, est mort en 1964,
après avoir écrit les aventures de son héros préféré en douze romans et neuf
nouvelles. Depuis, d’autres écrivains ont pris le relais, avec des bonheurs
divers. Kingsley Amis d’abord, puis Sebastian Faulks et Jeffery Deaver, avant
William Boyd l’an dernier, pour un Solo
réédité en poche.
Quand il est envoyé en mission au Zanzarim en 1969, James
Bond connaît peu l’Afrique occidentale : il n’y est allé qu’une fois. Il
prend soin d’emporter un ouvrage qui, espère-t-il, lui fournira quelques
lumières sur la région : Le fond du
problème, de Graham Greene. Le roman est paru vingt ans plus tôt, peu de
temps après une guerre pendant laquelle le romancier a servi en Sierra Leone,
décor d’un livre qui fournit, sans le dire, un clin d’œil au lecteur
curieux : dès les premiers paragraphes du Fond du problème, il est question d’une rue qui s’appelle… Bond
Street. On ne nous fera pas croire que c’est un hasard.
Le Zanzarim ne se trouve bien entendu sur aucune carte. Mais
les images d’une population affamée vues par James Bond ressemblent à celles
qui arrivaient du Biafra à cette époque et William Boyd, né au Ghana, a passé
une partie de son enfance au Nigeria – le pays que la guerre du Biafra aurait
pu mener à la partition. Voilà donc probablement le vague arrière-plan de
réalité sur lequel se fonde Solo, à
partir duquel tout devient possible selon la logique mise au point par Ian
Fleming dès les années 50. Son successeur le plus récent, qui prend le relais
d’autres auteurs, a pris soin de relire l’intégrale du créateur et conserve
l’esprit des origines sans rien perdre de ses propres qualités d’écrivain.
William Boyd précise d’ailleurs, à l’intention des
puristes : « Je m’en suis
remis, pour ce roman, aux détails de la vie et, plus généralement, à la
biographie de James Bond parus dans la “nécrologie” d’On ne vit que deux
fois, le dernier ouvrage de Ian Fleming
publié de son vivant. Il est raisonnable de supposer que ce sont là les faits
essentiels concernant Bond et son existence que l’auteur souhaitait voir
introduire dans le domaine public – et qui feraient litière des anomalies
et illogismes divers figurant dans les précédents romans. Par conséquent, en ce
qui concerne ce livre, et conformément à la décision de Ian Fleming, James Bond
est né en 1924. »
De la même manière que William Boyd revendique sa fidélité
au canon mis en place, malgré quelques hésitations en cours de route, par son
créateur, il reproduit les clichés souvent utilisés. Et devenus davantage que
des clichés : une sorte de marque de fabrique sans laquelle l’agent 007 ne
serait pas exactement ce qu’il est – et doit être dans l’esprit des lecteurs
(ou des spectateurs, au cinéma).
James Bond est donc un homme à femmes. Les 45 ans qu’il
affiche dans Solo n’ont pas endormi
la bête sexuelle qui sommeille en lui. « Il
était encore vert, le vieux ! », se félicite-t-il en constatant
qu’il est émoustillé par une jolie femme rencontrée à l’hôtel, elle-même
n’étant d’ailleurs pas insensible à son charme viril. Bryce Fitzjohn, actrice
sous le nom d’Astrid Ostergard, surgit au début du roman, elle fera d’autres
apparitions dont l’une est liée, par la bande, au récit. Mais elle ne joue
aucun rôle dans les activités de l’agent, au contraire d’Efua Grâce
Ogilvy-Grant, chef du poste britannique et son contact au Zanzarim. Enfin,
presque, car elle s’appelle aussi Aleesha Belem. Bond, après avoir cédé à sa
beauté, aura bien des raisons de se demander quel jeu elle joue et dans quel
camp elle se trouve.
Grâce/Aleesha est le cœur battant de l’Afrique à la
rencontre de laquelle James Bond a été envoyé. Avec une mission toute
simple : faire cesser une guerre qui dure depuis trop longtemps et dont
les conséquences sont tragiques pour la population mais aussi pour les compagnies
pétrolières désireuses d’exploiter tranquillement un sous-sol très riche. Sa
couverture ? Il est censé être le correspondant londonien d’une agence de
presse française a priori favorable au Dahum, le territoire qui a fait
sécession du Zanzarim. Quelques autres journalistes, des vrais ceux-là,
présents dans le pays se demandent quand même qui il est vraiment.
Lancé à corps perdu sur un terrain hostile, Bond est enlevé
par l’infâme Kobus Breed, un mercenaire qui encadre les troupes du Dahum, puis
réhabilité quand son expérience du combat permet d’enlever une victoire. Ce
qu’il appelle reculer pour mieux sauter : s’il redonne un peu de force à
l’armée sécessionniste alors que la politique britannique envisageait plutôt la
déroute de celle-ci, ses actes de bravoure lui permettent d’approcher Solomon
Adeka, le dirigeant du Dahum et l’objectif de sa mission : faire du
général Adeka « un soldat moins
efficace ».
L’efficacité de William Boyd, en tout cas, n’est pas
prise en défaut. De découverte en découverte, Bond brave la mort – il en a
l’habitude – pour mettre au jour une réalité très différente de celle qu’on lui
avait présentée. Et, tout à la fin d’un roman qui se lit en retenant sa
respiration, la porte est ouverte à une suite. Chic !
