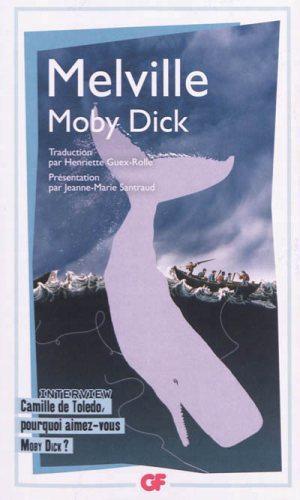 Relire Moby Dick constitue pour moi, en tout premier lieu, une plongée dans l’enfance. Je l’ai découvert à 10 ans, un âge où je lisais d’avantage pour le plaisir de décrypter des lettres et des mots que pour le contenu des ouvrages – il va sans dire que, si jeune, je n’ai pas compris grand chose à cette grande chasse à la baleine. Et pourtant, je me revoie encore expliquer à mon institutrice que j’avais du mal à lire le livre qu’elle nous conseillait parce qu’il se déroulait en mer tout comme un autre livre que j’étais en train de lire à la maison, le fameux Moby Dick. Une situation bien problématique parce que je confondais un peu les deux histoires. Curieusement, elle ne m’a pas demandé d’arrêter mes lectures dissidentes. Et 20 ans plus tard, je suis bien incapable de me remémorer le titre du « livre de la maîtresse ».
Relire Moby Dick constitue pour moi, en tout premier lieu, une plongée dans l’enfance. Je l’ai découvert à 10 ans, un âge où je lisais d’avantage pour le plaisir de décrypter des lettres et des mots que pour le contenu des ouvrages – il va sans dire que, si jeune, je n’ai pas compris grand chose à cette grande chasse à la baleine. Et pourtant, je me revoie encore expliquer à mon institutrice que j’avais du mal à lire le livre qu’elle nous conseillait parce qu’il se déroulait en mer tout comme un autre livre que j’étais en train de lire à la maison, le fameux Moby Dick. Une situation bien problématique parce que je confondais un peu les deux histoires. Curieusement, elle ne m’a pas demandé d’arrêter mes lectures dissidentes. Et 20 ans plus tard, je suis bien incapable de me remémorer le titre du « livre de la maîtresse ».
L’idée de redécouvrir ce monument littéraire me trottait dans la tête depuis plusieurs mois lorsque Aaliz a proposé d’en faire une lecture commune. Prétexte idéal ! Et j’en profite pour l’inclure dans le Challenge XIXème. A ma très grande surprise, j’ai relu les premières pages avec un fort sentiment de déjà vu – évidemment – fait notable si l’on prend en compte mes catastrophiques capacités mémorielles. Il semblerait que Moby Dick et Herman Melville m’aient travaillé inconsciemment le corps et l’esprit depuis toutes ces années – un peu à la manière de Victor Hugo que je redécouvrais il y a deux ans dans un émerveillement renouvelé. Mes souvenirs se brouillent lorsque le Pequod prend enfin la mer – parasités sans doute par cet inopportun autre livre, et plus certainement par la compréhension nécessairement limitée d’une enfant de 10 ans.
Passées ces réminiscences très personnelles, la richesse de la langue et du style ne peuvent passer inaperçus. Pour l’anecdote, je discutais avec un ami qui me soutenait qu’un bon écrivain devait pouvoir être reconnu à la lecture de n’importe quelle phrase prise au hasard dans l’un de ses livres. Un peu troublée par cette exigence, j’ai voulu lui démontrer que ces attentes étaient sans doute beaucoup trop hautes et j’ai saisi le volume de Melville à portée de main.
Sincèrement, je prend cette phrase au hasard :
« Âprement et régulièrement aiguillonnées par les sarcasmes de l’Allemand, les trois baleinières du Pequod avançaient maintenant presque de front et, dans cet ordre, le rattrapèrent momentanément. »
Pifomètre le plus pur ! Et je vous assure que n’importe quelle autre extrait du roman porte la marque de son auteur de manière indubitable. Cette simple découverte me fascine. Ces presque 600 pages m’ont tenu en haleine plusieurs jours, et par petites touches – Moby Dick est aussi une lecture éprouvante relevant d’avantage de l’effort que de la distraction. Mais quelle délice ! Il s’en est suivi – comme il se doit après la lecture d’un véritable chef d’œuvre – une bonne semaine de « deuil » littéraire où toute lecture me paraissait fade, voire grinçante ou vaine, y compris les essais.
J’ai pu lire ça et là des chroniques enthousiastes quant à la dimension métaphysique de Moby Dick. A la lecture pourtant, j’étais d’avantage en position de monter dans une baleinière en saisissant mon harpon, qu’absorbée par des méditations vastes et bienvenues sur l’humanité, la vengeance et autre quête initiatique. Aujourd’hui, en tentant laborieusement de rassembler mes impressions, je ré-ouvre les pages cornées le mois dernier et constate a posteriori tous ces énoncés – pourtant limpides – sur les doutes, les failles et les travers de l’Homme. La dimension métaphysique est à peine sous-jacente, elle est explicite tout au long du roman. Herman Melville réussit l’exploit de nous parler au plus profond, tout en nous offrant un roman d’aventure époustouflant.
Pour conclure ce billet, voici un extrait un peu moins choisi au hasard. On saluera au passage les prouesses de la traductrice, Henriette Guex-Rolle :
« Non seulement la mer est l’ennemie de cet homme qui lui est étranger mais encore elle est démoniaque envers ses propres enfants, plus fourbe que l’hôte persan qui assassine ses invités, n’épargnant pas ceux qu’elle a engendrés. Comme une tigresse sauvage étouffe en se retournant ses propres enfants, la mer jette aux rocher de la côte les plus puissantes baleines et les abandonne flanc à flanc avec les épaves des navires naufragés. Point de miséricorde, elle ne connait d’autres maîtres que sa propre puissance. Haletant et renâclant comme un destrier affolé qui a perdu son cavalier, le libre Océan galope autour du globe.
Songez à la ruse de la mer et à la manière dont ses créatures les plus redoutables glissent sous l’eau, à peu près invisibles, traîtreusement cachée par les plus suaves tons d’azur. Songez à la beauté et à l’éclat satanique de ses plus impitoyables tribus, à la forme exquise de certains requins. Songez au cannibalisme universel qui règne dans la mer où les créatures de proie s’entre-dévorent, menant une guerre éternelle depuis l’origine du monde.
Songez à tout cela et tournez alors vos regards vers cette terre aimable et verte infiniment docile, songez à l’Océan et à la terre, ne retrouvez-vous pas en vous-mêmes leurs pareils ? Car de même que cet Océan de terreur entoure les verts continents, de même l’âme de l’homme enferme une Tahiti, île de paix et de joie, cernée par les horreurs sans nombre d’une vie à demi inconnue. Que Dieu te garde ! Ne pousse pas au large de cette île, tu n’y pourrais jamais revenir ! »
Un jour – je l’espère – je saurai qualifier les sensations éprouvées à la lecture de telles lignes.
