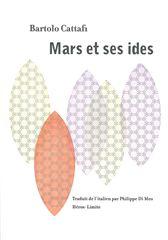 Philippe Di Meo est sans doute un des passeurs les plus fidèles, passionnés, talentueux de la poésie italienne en France. De plus, il a toujours montré une grande indépendance dans le choix des auteurs et des livres qui a décidé de traduire, sans respecter forcement les hiérarchies d’intérêts qui dominent la scène officielle de la poésie italienne, s’il est encore possible de parler d’une quelconque « scène officielle ». Depuis des années, la poésie italienne, et ce n’est pas plus mal, a dans son ensemble plongé dans une dimension underground, la bonne comme la mauvaise, la traditionnelle comme l’expérimentale, la plus naïve comme la plus sceptique, la plus autoréflexive. Cette situation pose certainement un problème évident de repères pour qui observe la poésie contemporaine depuis l’étranger. Cela n’empêche nullement la présence, y compris dans les générations les plus récentes, d’un bon nombre d’auteurs importants, de projets innovants. Qui plus est, il y a en encore beaucoup de territoires de la poésie italienne de la seconde moitié du siècle dernier qui restent à découvrir, en France comme ailleurs. Di Meo travaille dans cette direction, avec une prédilection pour les défis linguistiques : il s’est attaqué aux idiolectes littéraires de Gadda, Manganelli et Zanzotto, pour citer seulement quelques exemples.
Philippe Di Meo est sans doute un des passeurs les plus fidèles, passionnés, talentueux de la poésie italienne en France. De plus, il a toujours montré une grande indépendance dans le choix des auteurs et des livres qui a décidé de traduire, sans respecter forcement les hiérarchies d’intérêts qui dominent la scène officielle de la poésie italienne, s’il est encore possible de parler d’une quelconque « scène officielle ». Depuis des années, la poésie italienne, et ce n’est pas plus mal, a dans son ensemble plongé dans une dimension underground, la bonne comme la mauvaise, la traditionnelle comme l’expérimentale, la plus naïve comme la plus sceptique, la plus autoréflexive. Cette situation pose certainement un problème évident de repères pour qui observe la poésie contemporaine depuis l’étranger. Cela n’empêche nullement la présence, y compris dans les générations les plus récentes, d’un bon nombre d’auteurs importants, de projets innovants. Qui plus est, il y a en encore beaucoup de territoires de la poésie italienne de la seconde moitié du siècle dernier qui restent à découvrir, en France comme ailleurs. Di Meo travaille dans cette direction, avec une prédilection pour les défis linguistiques : il s’est attaqué aux idiolectes littéraires de Gadda, Manganelli et Zanzotto, pour citer seulement quelques exemples.
En 2014, Di Meo présent au public français la traduction d’un livre de Bartolo Cattafi de 1997, Mars et ses ides, dans la très belle édition réalisée par Héros-Limite, et c’est bien de ce livre et de cet auteur dont je voudrais parler. En 2010, Di Meo avait déjà traduit L’alouette d’octobre (Atelier la Feugraie), le dernier volume de poèmes publié par Cattafi de son vivant, en 1979. Dans sa postface de 2010, Di Meo écrivait : « Car si, à des rares exceptions près, l’œuvre poétique [de Cattafi] n’a pas obtenu l’attention de la critique qui lui revenait de droit, ses recueils ont constamment été réédités, réunis en anthologies, et même disponibles en éditions de poche. Fort heureusement, cette époque s’avère aujourd’hui révolue, et la poésie de cet irrégulier inclassable est désormais tenue pour l’une des plus originales du second après-guerre ».
En effet, Bartolo Cattafi est un poète qui semble n’avoir véritablement ni de famille ni une place bien établie dans le canon de la poésie italienne de la deuxième moitié du XXème siècle. Il est absent des anthologies les plus influentes qui ont contribué à dresser un état de la poésie italienne des trois premiers quarts du siècle dernier. Et cela en dépit d’une activité poétique importante, concentrée surtout sur deux décennies : au cours des années cinquante et des années soixante-dix. Durant toute cette période, Cattafi publie une dizaine de livres chez Mondadori, dans l’une des plus prestigieuses collections de poésie italienne, Lo Specchio. En dépit de cette production importante, après sa mort survenue en 1979, Cattafi disparaît du débat critique et ne semble pas même susciter un intérêt particulier chez les poètes de la nouvelle génération comme Valerio Magrelli ou Milo De Angelis. Cette situation va changer sensiblement par la suite. Les poètes qui, comme moi, font leur apprentissage au début des années quatre-vingt-dix commencent à être beaucoup plus curieux envers cette auteur, à cause aussi, probablement, de son positionnement oblique dans le champ de la poésie italienne.
Cattafi ne se présentait pas, bien évidemment, comme un compagnon de route du courant le plus expérimental de la poésie italienne (neoavanguardia et alentours), mais on ne pouvait pas non plus le ranger à la légère dans la famille des poètes lyriques. Au centre de sa poésie, comme il arrive à beaucoup d’autres auteurs du siècle dernier, nous retrouvons un lien entre le psychisme individuel et le paysage naturel et historique. On sait que le cadre de l’expression lyrique surinvestit cette relation et sa possibilité de produire, par la friction entre l’esprit et le monde, un surcroît de sens, une expression verbale à même de dépasser les expressions déjà disponibles dans la langue ordinaire pour nous procurer de nouvelles, plus sublimes, significations. Toute la poésie de Cattafi s’inscrit aussi dans ce cadre, mais le résultat de la friction si ardemment recherchée est d’un point de vue sémantique égale à zéro. L’esprit du poète n’est en rien différent de l’esprit du philosophe, du scientifique ou même de celui de l’homme ordinaire : voir le monde, vouloir le comprendre et le connaître n’est rien d’autre qu’un geste défensif, un exorcisme de la raison, une tentative plus ou moins sophistiquée de domestication. Mais si l’étrangeté originaire du monde en regard de l’esprit n’est jamais vraiment annulée, dans l’expérience humaine nous assistons à un perpétuel renversement : l’opacité est aussi bien dans le dedans que dans le dehors, autant à l’intérieur de la psyché que dans les choses inertes du dehors. Alors, notre quotidien consiste seulement en cet étroit lambeau de terre à l’équilibre éphémère, d’une clarté apparente, d’un calme provisoire. Alors, pour Cattafi, la poésie ne constitue pas un laissez-passer commode pour des escapades dans les royaumes privilégiés du sens, là où surgissent les « grandes significations ». L’occasion poétique par excellence est, au contraire, le moment petit ou grand de la catastrophe, le moment qui enregistre l’intrusion violente des évènements imprévisibles du monde, ou de nos fantasmes profonds dans le cercle paisible de la vie ordinaire. Autour de ces tremblements, de ces secousses, s’organise aussi le rythme dépouillé et énergique de son vers. Le commencement du discours correspond toujours à une sorte de choc, et cela rend l’incipit des textes de Cattafi particulièrement mémorable et incisif (« Je ne sais que faire / de ces bras » ; « On ramasse des choses / on les pend au mur » ; « La liste des pouvoirs / que mes mains possèdent » ; « Depuis les brèches / l’eau entrait partout » ; « La voici c’est une chose / à laquelle on s’agrippe », etc.).
On pourrait alors tenir Mars et ses ides comme une sorte de collection de proverbes individuels, des proverbes qui n’expriment nullement la sagesse collective, celle qui a, au fond, comme but d’étrangler la pensée, son inquiétude critique à l’égard du monde social ; les proverbes de Cattafi sont des proverbes métaphysiques, mais ils expriment une sagesse toute particulière, qui ne vise pas à accepter, comme dans les proverbes, la nature humaine et l’ordre social qu’elle s’impose. C’est le chaos profond que nos catégories sociales et individuelles de pensée s’efforcent de cacher et neutraliser chaque jour de notre vie. C’est bien cette réalité-là que les proverbes de Cattafi veulent accepter. Mais ce n’est pas en mode philosophique que Cattafi se penche sur le chaos psychique et historique. Notre auteur est bien conscient que la philosophie est le plus subtil, le plus sophistiqué des exorcismes, n’entendrait-elle pas toujours conquérir un point stable et protégé, à partir duquel célébrer l’instabilité et le désordre. C’est justement ce que le poète ne veut pas faire : son désordre à lui n’est pas contemplé à travers le regard panoramique du philosophe, mais toujours à ras de terre, à partir des micro-événements du quotidien. Cet aspect central dans l’œuvre de Cattafi a été d’ailleurs bien saisi par Di Meo, qui dans sa postfacé écrit : « Chez Bartolo Cattafi philosophie et poésie demeurent indissociables, inhérentes ». Di Meo évoque aussi pertinemment « une ascendance lucrétienne », mais il est surtout important de souligner que la « densité » philosophique de Cattafi « est obtenue par la poésie et avec les moyens de la poésie », comme il doit en aller pour tout poète moderne. Et de ce point de vue, envisager une proximité avec Francis Ponge et son dégout des idées ne serait pas excessif : « Les opinions les mieux fondées, les systèmes philosophiques les plus harmonieux (les mieux constitués) m’ont toujours paru absolument fragiles, causé un certain écœurement, vague à l’âme, un sentiment pénible d’inconsistance » (Méthodes, Gallimard, 1961).
Je pourrais alors corriger ma formulation précédente. En réalité, chez Cattafi, on se retrouve à mi-chemin entre le proverbe, d’une part, comme sédimentation d’une expérience populaire, bien ancrée dans les choses concrètes de la vie, ses rythmes et ses évidences idiotes, et, d’autre part, face à l’aphorisme au caractère fulgurant, ambigu, énigmatique, qui essaye de bouleverser le sens commun, les certitudes collectives et individuelles. C’est peut-être justement une des raisons du charme de Cattafi, cette désinvolture entre le haut et le bas, entre le désarroi métaphysique et l’ancrage animal, érotique, ce scepticisme radical à l’égard des grands constructions de l’esprit humain et cet amour pour le coté fragile, chaotique, illusoire des apparences.
Faux acacias
Un bloc de faux acacias
droits en apparence
d’âme au contraire oblique
pêchent dans une mer d’ombre
produisent un vert de sous l’eau
des supports de rossignols et de silence
tendent des bras solides
défendent quelque chose
potager clos infini
beau réservoir de ce qui point n’apparaît.
Di Meo arrive à rendre de manière efficace le martèlement initial, avec un objet qui s’impose dans son apparente solidité, son apparente évidence (le bloc d’acacias droits, leurs bras solides), mais qui révèle immédiatement un dérangement (le mensonge, le caractère oblique), et aussi un échange troublant entre le sec et l’humide, entre l’aridité et la profondeur de la mer. Et toute promesse de transcendance, d’un regard qui puisse saisir au-delà des apparences est démentie par le vers final : « beau réservoir de ce qui ne se manifeste pas » et qui ne présente qu’un profil fuyant, ambigu, où l’oxymoron domine : « potager clos infini », pour étrangler toute volonté de appréhender le monde à l’aide de la seule raison.
[Andrea Inglese]
Bartolo Cattafi, Mars et ses ides, traduit de l’italien par Philippe Di Meo, éditions Héros-limite, 2014, 144 p. 16€

