La critique de Claude :
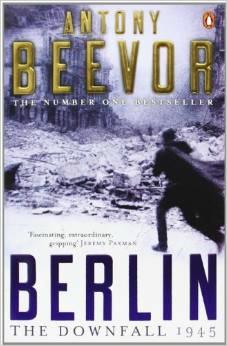
C’est un récit tragique de la bataille de Berlin, en 490 pages serrées (en édition anglaise Penguin) par Antony Beevor, l’un des spécialistes mondiaux de l’histoire militaire contemporaine.
Il commence à Noël 1944, par un recensement des forces en présence : les 3 millions de Berlinois, dont beaucoup sont là contre leur gré (prisonniers de guerre, travailleurs forcés), vivent dans les ruines laissées depuis 3 ans par les bombardements anglo-américains. Au milieu d’eux, enseveli dans le bunker profond de la Chancellerie du Reich, se tient leur Fuhrer, décidé à tenir quoi qu’il en coûte. Dans les rues, les immeubles, le métro, les caves, tout ce qui peut être transformé en piège pour l’ennemi l’a été.
Encore les effectifs allemands sont-ils en partie composés de la Volkssturm, (la « levée du peuple ») qui recrute des garçons de 16 et même 13-14 ans, et des vétérans de la Première guerre mondiale. Quant aux unités de l’Armée ou de la SS, elles restent redoutables compte tenu de leur expérience du combat, et la plupart de leurs soldats vont se battre jusqu’au bout, parce qu’ils craignent la captivité à vie ou l’exécution.
De l’autre coté de l’Oder, à 80 km à l’est de Berlin, l’URSS a massé 11 fois plus de soldats, 7 fois plus de chars, et 20 fois plus de canons qu’il n’en reste au Reich nazi après 3 ans et demi de guerre en Russie. Du côté soviétique, la densité de combattants marchant vers l’ouest est telle que l’artillerie russe fera souvent feu sur ses propres troupes, notamment sur l’axe principal de l’offensive, les hauteurs de Seelow. Ces soldats ont souvent vu leur famille détruite par les nazis, quand ils n’ont pas, comme leurs camarades américains ou anglais, vu de leurs yeux les indicibles horreurs des camps.
Le courage des soldats, la pression formidable exercée par les chefs, leur absence évidente d’humanité, les vengeances inévitables à la fin du conflit, tout se ligue pour produire la tragédie la plus cruelle.
Terrible est la situation des populations civiles, et d’abord des femmes qui subissent, à Berlin comme en Prusse orientale, en Silésie et en Poméranie, des viols systématiques, qui n’épargnent pas les Polonaises ou les ouvrières étrangères.
Staline, en tout cas, atteindra tous ses objectifs : se tailler un glacis soviétique de la Pologne à la Roumanie, et mettre la main sur les scientifiques qui, sans grand succès heureusement, travaillaient à l’arme atomique allemande dans un immeuble tranquille (c’est à dire jamais bombardé) de Berlin Dalhem. Ils seront efficaces (quoique lents) au service de leur nouvel employeur, permettant la première explosion soviétique en 1949.
Les Alliés occidentaux, eux, accompliront leur plus noble dessein, gagner la guerre en limitant autant que possible leurs pertes humaines. Au fil des semaines, ils seront soumis à la tentation d’avancer vers Berlin, certains Allemands pensant qu’il vaudrait mieux être prisonnier des Américains que des Soviétiques. Le sage Eisenhower ne cèdera pas et maintiendra la solidarité entre les Alliés, en s’arrêtant sur l’Elbe.
Beevor raconte tout cela en s’appuyant sur les archives ouvertes depuis la Perestroïka (mais pour combien de temps encore ?) et sur des témoignages directs de gens qui étaient dans le chaudron des fronts, dans les caves surpeuplées, sans eau ni nourriture, ou dans les rues battues par l’artillerie.
Il offre donc une riche contribution à l’histoire de cette période où l’humanité a découvert qu’elle n’a pas de limite dans le crime.
La chute de Berlin 1945, par Antony Beevor, édition française traduite par Jean Bourdier, aux éditions de Fallois (2002)
