
Librement divagué à partir : Jean-Paul Demoule, Mais où sont passés les indo-européeens ? Le mythe d’origine de l’Occident. Seuil, 2015 – Une résurgence de Tristan und Isolde, Wagner, version de Sir Georg Solti – toiles de Vija Celmins – Vue de Harlem de Jacob van Ruisdael – Un palace – Pline l’Ancien, Histoires Naturelles. Vertus médicinales des plantes potagères – Un céleri rave – Une montée d’ivresse …

C’est toujours là que la montée s’est produite. À mille lieux des rythmes effrénés que l’on associe généralement à la transe. Plutôt une coulée sonore s’annonçant de loin, d’un point indistinct et dont les fumeroles déchirent imperceptiblement les culs-de-sac quotidiens, laissant poindre une éclaircie, un courant d’air craquelant le confinement ordinaire. Il reconnaît toujours, en annonce de ces instants, l’écho d’une météorite orchestrale dérivant de Tristan und Isolde, depuis une très lointaine première écoute fiévreuse. Peut-être cet écho n’a-t-il plus aucune ressemblance avec l’original et n’est que la sédimentation des premières émotions ressenties à l’écoute de l’opéra. L’impression première, de plus en plus lointaine et diffuse, se transformant avec le temps en résonances intérieures innées, allant du vrombissement des univers oniriques aux ondes mugissantes légèrement discordantes, vestiges acoustiques cellulaires des premiers instants matriciels, fossiles symphoniques. Une sorte de musique originelle hantant ses profondeurs neuronales, à la manière d’une fabuleuse baleine blanche, cosmique, réapparaissant à des instants précis autant que mystérieux. Toujours il la guette. Une rengaine d’ouverture qui, à chacun de ses passages, fluidifie les limites et, une fois évaporée, laisse derrière elle un poignant sillage de mélancolie. Elle surgit charriée par la dramaturgie des amours impossibles et des amants maudits, l’amour plus fort que tout, fugue conquérante d’étreintes célestes et diaboliques entre principes mâles et femelles, mais, à l’instant de la montée, ce n’est qu’un fragile augure elliptique, une éclaircie aurorale par-dessus la métaphysique délirante du culte wagnérien. Ne retenant que les sons plus légers qui s’élèvent, bois éthérés, archets au bord du mièvre, ce qui ressemble à de subtils attouchements entre matière et esprit, juste des prémisses, comme en amour ces caresses hésitantes qui cherchent la scansion vertébrale autant que fantomale du plaisir. Ce qu’épousent bien ces traînées de cordes symphoniques qui diluent, étirent et émiettent les thèmes soudain friables et irrésolus, perdant toute assurance homogène et évoquant alors des cieux fuyants, draperies célestes agitées. Avançant puis rechignant, dominatrice puis pusillanime, colonisant l’esprit mais toujours tentée par la volupté des échouages, une musique qui dessine un passage et cherche à séparer les eaux pour permettre de migrer indemne de l’autre côté. Au fond, presque pas une musique, ou alors, en creux. À l’intérieur de l’opéra, c’est un gué fluide sous-jacent, crépuscule par où la musique autant que l’histoire s’échappent, refluent vers le non musical et le non narratif. Et au cœur de l’auditeur – ce qui l’excite précisément -, ce passage exacerbe la masse sensible. Puis, toute la chair physique et mentale, humectée, innervée, avide d’épouser le mouvement musical et narratif impulsé par un maître, soudain, sous l’effet d’un magnétisme instrumental irrésistible, reflue, emportée en amont du musical ou plutôt, au centre de la musique, sourd et silencieux, un centre aussi effroyablement atone que l’œil du cyclone. Et le vacarme vierge s’installe en lui. Un roulis et un grand déséquilibre de même griserie que ses abandons dans la houle du littoral atlantique, par exemple, entre la vague qui vient de le transpercer dans son agonie vers le rivage et la suivante, immense et éternelle, emportant le ciel et qui l’aspire vers le large avant de s’abattre sur lui, l’agonir d’écume. Presque rien d’aquatique ni même d’aqueux, mais un choc minéral le criblant de ses myriades de grains de sels, mitraille cristalline, le laissant étourdi, hébété et exalté. Ce crible extatique éprouvé vague après vague, jusqu’à perdre la notion du temps qui passe, ivresse marine, chant de la houle autant répétitif qu’irrégulier, lui fait un effet de même famille que cette nuée orchestrale wagnérienne s’éventrant aux pics d’une montagne, s’effilochant, s’emplissant de soleil levant et couchant avant de crever en lui. Précisément, le frappe la symétrie entre cette musique et l’expérience physique d’atteindre un col après des heures de pédalage, quand, la tête près du ciel, il s’identifie avec le passage vers les autres versants de la chaîne montagneuse couverte de forêts. Au moment du relâchement, l’adrénaline pompée cesse d’être absorbée par les muscles bandés, et monte à la tête, inonde les limbes du symbolique, bonheur aussi improbable que le sentiment d’invincibilité, hilarité d’altitude. Le regard plonge du sommet unique vers la multiplicité de ruissellements dans la vallée, la vie est fourmillement mais raccordée en sa seule focale cardiaque, subjective. Plus rien ne semble hors de portée. Et toujours, dans les derniers mètres d’ascension, ses oreilles bruissent de cette partition tapie dans les palpitations de sa pression sanguine, la montée. Et la même bande originale, archaïque car enfouie dans les plis et conques de sa corporéité sans âge, résonne quand un coucher de soleil le dépouille de toute rigidité et qu’il déclame certains vers baudelairiens, non plus comme fantaisie poétique, mais comme réalité tangible, là, durant un instant magique exceptionnel. Car, pressent-il, l’action conjuguée de cette lumière et de la musique intérieure revenue, irrigue la connaissance et ouvre une lucarne dans l’espace-temps, dépouille l’existence terrestre de ses carcans. Ce n’est plus une image naïve, il est vraiment possible de courir, atteindre l’horizon et capturer une particule tangible des rayons solaires. Voici l’élan qui va changer sa vie. « Courons vers l’horizon, il est tard, courons vite/ Pour attraper au moins un oblique rayon ! » (C. Baudelaire, « Le coucher du soleil romantique »)
Tout se dégage, les fichiers du savoir s’ouvrent sans restriction. Le palimpseste du cerveau tel qu’évoqué par Thomas De Quincey dans Le mangeur d’opium, devient transparent, illuminé à tous les étages, en ses plus infimes replis superposés, une vraie maison de verre. Ce n’est plus un mandala obscur plein de chicanes contre lesquelles se débattre pour avancer et extraire une dérisoire particule de vie, mais un puits lumineux de textes superposés au fond duquel il va déchiffrer la vérité, l’origine et la fin. « Des couches innombrables d’idées, d’images, de sentiments sont tombées successivement sur votre cerveau, aussi doucement que la lumière. Il a semblé que chacune ensevelissait la précédente. Mais aucune en réalité n’a péri. Toutefois, entre le palimpseste qui porte, superposées l’une sur l’autre, une tragédie grecque, une légende monacale, et une histoire de chevalerie, et le palimpseste divin créé par Dieu, qui est notre incommensurable mémoire, se présente cette différence, que dans le premier il y a comme un chaos fantastique, grossier, une collision entre des éléments hétérogènes ; tandis que dans le second la fatalité du tempérament met forcément une harmonie parmi les éléments les plus disparates. Quelque incohérente que soit une existence, l’unité humaine n’est pas troublée. Tous les échos de la mémoire, si on pouvait les réveiller simultanément, formeraient un concert, agréable ou douloureux, mais logique et sans dissonance. »* C’est un chœur de cette sorte, lustral, qui le souleva, polyphonie de tous les échos de la mémoire, dès la première écoute de Tristan und Isolde et, depuis, chaque fois que la réplique de cette écoute le secoue (déclenchée, dupliquée par des mécanismes mystérieux, comme si elle tournait dans l’éther et redevenait corps audible selon des calendriers cachés, des mobiles invisibles, des éphémérides métaphysiques). Le palimpseste de toutes ses expériences personnelles, augmentées de celles des proches vivants et morts avec lesquelles son esprit s’est élaboré par sédimentation, les strates labyrinthiques de son activité épigénètique interconnectées avec celles de « Dieu », de la « Nature », en une belle continuité et sans plus rien d’abscons ni d’ésotérique. Gorgé par cette musique qui le phagocyte émotionnellement et l’emplit des brumes immortelles du pangermanisme wagnérien, il retrouve l’émerveillement face au monde à découvrir, la crédulité et l’avidité de s’inscrire poussière dans une glorieuse épopée. Le palimpseste du monde est soudain un diamant sonore de la plus belle eau au fond duquel il entend, en ligne directe, le murmure du commencement. Pour lui, rien que pour lui. L’écheveau des cultures de l’homme et de celles des plantes et des animaux, à travers les millénaires, aboutissant à ce qu’il est, lui, aujourd’hui, il va pouvoir en un clin d’œil jouissif l’organiser en arbre généalogique, limpide et unique. Il croit entendre la « voyelle primitive » tout en sachant qu’il transgresse la raison. Il partage l’ébriété démente des savants égarés avec constance depuis le XIXe siècle dans la paléontologie linguistique, inventant contre toute vraisemblance le mythe d’un peuple premier, d’une langue initiale originelle et homogène, d’un berceau géographique circonscrit, bref, construisant le pedigree historique d’une pureté raciale supérieure, même si, avec le temps, la revendication raciale s’émoussera, se déguisera. Oui, l’excitation irrationnelle d’appartenir à la mythique lignée indo-européenne, d’être partie organique de ce prodigieux imaginaire immémorial, se remet à vibrer en lui au fur et à mesure que le puissant appareil orchestral chamboule son espace intime. Il se revoit jeune adulte fantasque, enivré par ces fadaises, frissonnant, convaincu d’affinités génétiques et spirituelles avec un lointain groupe d’élites entamant la conquête du monde, sans coup férir, par les armes et la culture. Et lui, dès lors, continuant cette conquête par d’autres voies, sur d’autres terrains, sa maigre fiction biographique, tissée jour après jour, convergeant avec celle des grands récits qui biaisent le discours des lumières, comme en un même sang. Toujours et encore le sang ! Et s’il ne peut plus adhérer à la fable indo-européenne, la musique réactive en lui les vertiges qui y étaient liés, mais vidés de leur idéologie, troublant pathos qui exprime le besoin d’échapper un instant à la délibération objective, de réentendre sans réserve l’opéra initial des amours, les premiers sons articulés. « Il en va de même pour les voyelles de la langue primordiale. Le XIXe siècle finit par s’accorder, après bien des discussions, sur trois voyelles primordiales : a, e, o. Puis on tendit à partir des années 1930 à vouloir les réduire à une seule, la voyelle primitive dont toutes les autres seraient issues. On ne peut s’empêcher, devant ces pulsions réductionnistes, de penseur justement à l’Inde, où la liturgie brahmanique considère parfois l’onomatopée sacrée Om ! comme la résonance du Verbe créateur, résumant à elle seule, non seulement tous les textes liturgiques du Veda, mais le cosmos lui-même. Cette voyelle primordiale renvoie aux débuts de la grammaire comparée, lorsque l’histoire des langues était aussi celle de l’Esprit humain. La voyelle unique offre un autre avantage, celui de simplifier les problèmes de correspondances phonétiques. Elle est le point-origine idéal, d’où n’importe quelle voyelle peut être librement déduite. »**
[Et c’est, en quelque sorte, dans un temple luxueux et fantasmatique de ce genre de croyance – appartenir à un peuple élu ligué par une seule langue homogène depuis les premiers balbutiements consonantiques – qu’il pénètre en foulant les épais tapis moelleux d’un palace, sous les dorures archétypiques des lustres majestueux. Multitude de points lumineux qui déséquilibrent. Palace où vaquent à leur désoeuvrement mystérieux, détachés des impératifs de la réalité et sans plus se préoccuper de ce qui se passe à la surface des choses qu’ils surveillent néanmoins sur l’écran de leurs tablettes, quelques héritiers fortunés, entourés de leur famille, dépensant l’argent sans compter, mêlés à quelques profanes. Ici, coule l’argent mythique s’engendrant sans travail. Errant dans les couloirs feutrés et les escaliers monumentaux, attentif aux corps et maintiens, aux toilettes et accents, il respire les relents d’une noblesse de sang ou financière, confit dans la mémoire cabalistique d’une lignée première, primordiale, prenant le pas sur toutes les autres. Dans cette caverne fastueuse dont les sols et les parois reflètent d’anciennes splendeurs coloniales, les possédants du monde se reposent, se délassent, entre bar et saunas, champagne et massage, exhibant leur nostalgie des anciens triomphes. Il s’infiltre là en intrus, inévitablement voyeur. Il marche et il entend résonner plutôt le thème des cors, leitmotiv de chasse. Et, dans la chambre capitonnée, caisson douillet loin de tout, jamais l’extérieur ne lui a semblé si amorti et le corps féminin enlacé à lui dans un tel vide silencieux, immaculé. Pourtant, il s’agit probablement de la chambre la plus modeste de l’hôtel, de celles rendues accessibles par promotion d’agence de voyage pour favoriser un peu de mixité sociale. Sur le lit extra large aux draps fins, parmi les élans de tendresse, sa main se faufile sous les vêtements soyeux, touche le ventre nu et les boucles de la toison, et il bascule. Ses doigts effleurent à peine la crête vulvaire que tout son être est comme englouti dans une montagne s’ouvrant sous ses pieds. Il touche un timbre musical très lointain dans l’atmosphère, il glisse dans le feutre feuilleté des violons, cette phrase limpide et simplissime qui ouvre l’opéra, évoquant une réconciliation. Le choc érotique réactive, très loin dans l’inconscient la vibration de la fameuse voyelle initiale. Dans ce genre d’instant, il pourrait y croire. Les lèvres s’entrebâillent, mouillent et dansent, bassin ondoyant décrivant des courbes, des orbes, des pétales, se frottant délicatement contre son doigt introduit, devenant pétales immenses, souples et soyeux. Elles tissent sous ses paupières closes et par transmission des ondulations de plus en plus hypnotisant à la manière d’une navette qui saoule, à même la lave de son désir irradiant, toute une végétation foisonnante de motifs Paisley, miroir des grands tapis recouvrant le sol des salons, des balcons et les marches de l’escalier monumental. Une danse intime, accueillante, qui, de ses cuisses largement ouvertes, le reconnaît comme un ultime élu et qui fait qu’à chaque fois, il n’y a plus qu’elle et lui susceptibles de continuer la lignée. Il s’enfouit dans le ventre, il sent et entend, par le biais de la magie fusionnelle et par l’impact flatteur du décorum riche et cossu, la sécrétion des sucs séminaux et vaginaux participer à la machinerie romantique qui entretient l’illusion de corps destinés à procréer les êtres les plus raffinés. Comme si ça venait aussi de lui, ce genre de connerie, empêtré qu’il est dans la traîne somptuaire, louvoyant indéfectiblement dans son pathos à la manière d’un serpent fourbe, traînées vocales et instrumentales laissées par l’écoute de son premier opéra wagnérien. La compromission est partout dans l’imaginaire et ses jouissances. Et alors, se rebeller contre ça, devenir un amant à l’argot vulgaire, aux caresses crapuleuses.]
Accueillant la musique en lui, cette musique qu’il génère en ces cellules à partir de souvenirs de Tristan und Isolde qui le sillonnent, un remixe concocté à partir de bribes, il se retrouve connecté avec le point-origine. Le silence porté par la musique, c’est cela, se retrouver dans son vacarme silencieux, de la même manière que l’on dit être protégé sous l’œil du cyclone. Et l’effet que lui fait cette musique, depuis qu’elle s’est imprimée, impressionnée dans sa chair neuronale encore fraîche, est aussi rappelé, reproduit et dévié, au fur et à mesure que se constitue sa culture musicale, par d’autres occurrences de factures complètement différentes. Plutôt de celles qui diffractent et révèlent la dimension multipolaire de la voyelle primale, mais qui par ce fait même, par ce jeu de vis-à-vis acoustique, en avive le fantasme, la nostalgie. Le violoncelle de Tom Cora au début de State of Schock, avec le groupe The Ex, quand l’envolée mélodique écharpée jaillit presque improbable, bravache et tremblante, nue, et qu’un instant il croit entendre qu’elle se casse, se désolidarise, et qu’il n’y aura plus rien après l’archet, désintégration en plein vol des sons à peine formés et organisés. Même chose avec les Variations Goldberg, juste après l’exposition du thème bref, nacelle inouïe de sons en suspension et qui, comme les polyphonies pygmées semblent réverbérer les premières cellules du monde. Avant que l’interprète attaque les variations, il y a un suspens, l’auditeur est jeté par-dessus un abîme, dans une immense inspiration qui lui semble gober et évanouir toute la suite, et il se dit qu’il ne pourra, à l’avenir, uniquement entendre le reste de l’œuvre dans son souvenir. La première variation démarre alors, miraculeuse, exultante. Dans les errances, aussi, de Mischa Mengelberg au piano, les sautes d’humeurs erratiques, les changements de ton, de vitesse, de volume, avec chaque fois l’irruption de précipices, d’iceberg mutique, jeu haletant du chat et de la souris entre musique et non musique. Ou encore, dans ce rare dispositif de concert atypique, assis dans la pénombre d’une salle d’exposition dont les murs sont ornés de grands formats photographiques sombres, formes indistinctes, cramées, où il se retrouve en train de regarder avant de l’entendre, un jeune homme accroché à sa vielle à roue – ou celle-ci agrippée au corps du jeune homme à la manière d’une bête fantastique. Il y voit un personnage de Panamarenko actionnant un engin loufoque, poétique, les seuls qui permettent de réellement voler ou d’explorer les fonds marins (ou autres dimensions inaccessibles), à la force du bras moulinant avec une rigueur métronomique, inhumaine, la manivelle de l’engin. Tournis hypnotique. Regardant avant d’entendre et, quand le son lui parvient à l’oreille sans qu’il ne puisse plus rien faire pour l’en empêcher, c’est avec un effet de retard grisant, comme s’il y avait, dans le temps, quelque chose à rattraper par l’abandon de l’ouïe au phénomène extérieur. La rotation du bras, absolument régulière, subjugue, puissante machine folle que rien n’arrêtera. Mais dans quel sens tourne-t-elle ? N’est-ce pas à rebours, aspirant dans son délire giratoire, tous les sons du monde, les agrégeant, les broyant indistincts en un seul drone universel où tout s’entend, où, littéralement, l’exhaustivité du sonore palpite, crépite, les plus belles langues et musiques retournées au bouillon de culture initial, sidéral, galaxie de bactéries qui couinent, trucident, copulent, chantent, frottent, frottent, percutent ? Et, en même temps qu’elle aimante tous les sons, la manivelle n’actionne-t-elle pas un autre prodige qui extrait la luminosité des grandes photos exposées autour d’elle, les conduisant ainsi à laisser remonter à la surface les lumières noires qui phosphorent sous la surface des images ? Par là, rejoignant son intuition en entendant Tristan und Isolde la première fois : « Au fond, presque pas une musique, ou alors, en creux. À l’intérieur de l’opéra, c’est un gué fluide sous-jacent, crépuscule par où la musique autant que l’histoire s’échappent, refluent vers le non musical et le non narratif. » Et dans le corps du bourdon, dragon immuable et protéiforme, comme jaillissant du chalumeau d’un soudeur, des étincelles de petites notes aiguës ou graves, nettes ou mal dégrossies, éblouissantes, communiquent une impression extatique de petits pans de voûte céleste ouvrant soudain quelques-uns des mystères les plus hauts. Illumination comparable à celle éprouvée le soir au jardin quand, se redressant du sillon où il vient de disperser des graines, il regarde le ciel et aperçoit comme par inadvertance et comme un signe destiné qu’à lui à cet instant précis, une escadrille franc-tireur de mouettes, très haut, presque indiscernable et dont la blancheur d’ange est exhaussée par les rayons du couchant. Ce déploiement pointilliste qui chante, mutique, dans le poudroiement stellaire lui rappelle l’inframince sentier de crêtes, incandescent, que son imagination a tracé dans le corps de l’opéra. Et il en retrouve encore l’effet d’exaltation, exactement, dans le groupe subliminal de volatiles, oiseaux marins et rapaces se chamaillant, au sein du paysage de Jacob van Ruisdael, Vue d’Harlem, ponctuation mate et dérangée à même les draperies nuageuses, presque au-delà des nuages. Une figure nous indiquant de manière détournée d’où a été prise cette vue d’Harlem. Et ces quelques points aériens minuscules expliquent le vertige délicieux qui est la contemplation la toile, se rendant compte que son œil s’élargit en une liberté inégalée jusqu’ici et survole cette campagne sans aucune contrainte, planant avec le rapace. Éblouissement jubilatoire, ivresse panoramique à détailler les champs et les travailleurs affairés sur le chaume, les haies et les bosquets, le hameau rural, ses toits d’ardoises scintillants ou de tuiles moussues, les draps étendus au fil et mollement gonflés par le vent, la lointaine falaise urbaine surmontée d’une cathédrale. Dans la chevauchée onirique de Tristan und Isold, il avait atteint pour la première fois cette sensation de regarder la vie de très haut, d’en distinguer et d’en relier les moindres détails paysagers à travers la longue durée de l’histoire.
[Étincelles de notes musicales, piqûres perlées surfilant un sentier de crêtes dans l’opéra, sève nacrée de chatte effleurée, points ornithologiques dans les nuages, tout cela est de la matière et de la texture de l’immensité étoilée des cieux nocturnes de l’été. Des échantillons, des échancrures. En vacances, dans les montagnes, où les lumières terrestres altèrent le moins les lueurs des ailleurs cosmiques, quelle jouissance de regarder vers le haut, de sentir son corps s’alléger et lentement s’élever dans des rideaux ascendants de bulles d’argent, comme précisément le Tristan de Bill Viola. Ce sentiment d’être si microscopique, insignifiant et pourtant, aspiré dans l’infini, au diapason de l’absolue légèreté et du total abandon de soi et juste ce cordon ombilical immatériel le reliant à l’inconnue et l’absente, quelque part, dans les froufrous d’étoiles (selon la bohème de Rimbaud). La sœur jumelle évaporée dans l’espace. L’impression produite par la contemplation astrologique des nuits chaudes ou celles plus craquantes, très froides, d’hiver, il la retrouve devant les toiles de Vija Celmins. Pas tellement devant l’image peinte globale. Mais se représentant le travail qui consiste à reproduire cette vision sur une toile avec un pinceau, le nombre incalculable de petits gestes attentifs. C’est cela, cette gestuelle méticuleuse et dépouillée qui l’émeut. Il y trouve une ressemblance avec son travail d’écriture quotidien, quelconque, banal, mais persévérant et fondamental pour qu’il continue à se sentir ancrer dans la vie. C’est aussi quelque chose de cet ordre qui le fait fondre de grâce devant les paysages des peintres hollandais. Pas tellement la réussite mimétique de la peinture, sa perfection photographique. Mais, devant la résurgence de paysages premiers, tels que vus pour la première fois – et renouant alors avec un regard neuf, naïf, vierge – sentir dans ses tripes l’attention aux choses que cela demande et la maîtrise tant spirituelle que corporelle d’une technique pour saisir cela avec des pinceaux, de la peinture, une toile. La patience de l’observation et des coups de main, l’amour que ça représente, pour les choses, pour l’activité humaine. Et quand il fouille ainsi la voûte céleste, en vrai ou devant une peinture, toujours au bord de l’ivresse, il n’est plus qu’une sorte de racine, de poulpe végétale qui creuse le sol, la nuit terreuse striée d’éclairs jusqu’au point de jonction où le tellurique n’est que marée se déversant dans le vide, de l’autre côté, s’éparpillant en constellations minérales, rejoignant les voies lactées, le palimpseste laiteux du big-bang. Son être – l’organisme interne/externe par lequel il sent et fait sentir, explore l’animé et l’inanimé, voyage dans toutes les dimensions de l’expérience , –cette chose ressemble alors, de manière saisissante, à l’envers d’un céleri rave tel qu’il le découvre quand il vient, au potager, de l’arracher du sol. Animal insolite, cœur tentaculaire, cervelle à trompes, sonde spatiale parcourant les matières ténébreuses, l’opacité absolue. Et quand il tranche de son canif les racines et radicelles, il garde en main une sorte de satellite archaïque dont la surface est marquée de points de jonction à nu, humide de sève, tandis que le grouillement de petites antennes finissent de vibrer, tombées au bord du cratère de terre.]
Cette musique envolée a gravé en lui une ascension chronique qui ouvre les portes d’une compréhension totale de l’univers. À tel point que, lorsqu’elle le reprend, il retrouve peu à peu en lui le murmure de l’omniscience, il sent bouger en lui, comme une fermentation millénaire, les innombrables gestes et expériences transmis de génération en génération qui aboutissent au catalogue enivrant de connaissances consignées par Pline l’Ancien, grimoire rêvé. « Les bettes de l’une et l’autre sorte ne sont pas non plus sans procurer des remèdes. On dit que la racine de bette blanche ou noire, fraîche, mouillée et suspendue à une ficelle, est efficace contre les morsures de serpent, que la bette blanche, cuite et prise avec de l’ail cru, l’est contre les ténias. Les racines de la bette noire, cuites dans l’eau, éliminent la teigne, et dans l’ensemble on rapporte que la noire est plus efficace. Son suc calme les maux de tête invétérés et les vertiges, ainsi que les bourdonnements d’oreille quand il est versé dedans. »*** Et cette emprise musicale n’est ni vestiges inertes ni archives passives. Elle est l’ombre portée de corps célestes qui sont autant d’extensions de son être caché, dont il ne peut élucider les itinéraires mais qui courent dans l’infini selon des trajectoires précises, tellement loin qu’il perd le contact conscient, n’en perçoit plus que de faibles signaux intermittents. Un contrepoint à sa vie lucide, rationnelle. Mais de temps à autre, elle resurgit, l’enveloppe, se blottit en lui et l’aspire en une nouvelle montée. Mieux comprendre ce qui en régit la révolution dans l’espace fait partie de ses études quotidiennes. Est-il, lui, le satellite de cette comète sonore ou est-ce elle, étoile filante musicale, qui est le satellite de sa trajectoire concentrique ? Ce jeu d’apparition et disparition, l’impact de cette non-matière musicale fusionnant ponctuellement avec son organisme et dont il ne peut élucider les lois, place son existence et son inconscient dans la peau d’un surfeur guettant l’arrivée de la bonne vague sonore, l’oreille toujours aux aguets, toujours déjà percevant, transi, le sillage orchestral de la fabuleuse baleine blanche immergée en ses profondeurs neuronales. Et souvent, rien ne vient, ce n’est qu’hallucination, pense-t-il alors. Mais quand ça revient, que le miracle de la montée se reproduit, resplendissante, alors c’est l’allégresse sans pareille, la parousie païenne (pour peu que cela veuille dire quelque chose !). Après, oui, il sent que la déconvenue est inévitable, et il cède à l’accélération dionysiaque. C’est le déferlement tribal des sons, des rythmes, l’autre versant de l’ivresse, inchoative, vers les ténèbres et leur tombée de rideaux. Retour au sillage mélancolique. (Pierre Hemptinne – Selon une commande pour une revue à paraître aux Presses du Réel, sur le thème de l’ivresse.)
* Thomas De Quincey, Le mangeur d’opium (Œuvres complètes de Charles Baudelaire, page 506, Gallimard/ La Pléiade).
** Jean-Paul Demoule, Mais où sont passés les indo-européens ? page 509
*** Pline l’Ancien, Histoire naturelle. Vertus médicinales des plantes potagères, p.973, Gallimard, La Pléiade























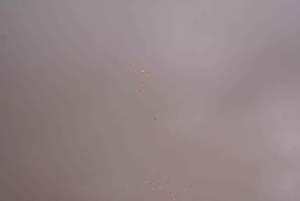
Tagged: écriture et nature, L'origine du monde, les mythes revus par l'art contemporain, mélancolie, opéra, origines, paysage, penser sous forme de paysages, potager, racines du blues, sentiment amoureux, travail de a terre
