« "Pleure ! Criait Uzo. Pleure, car ton père qui est parti pour l’hôpital il y a quelques semaines est maintenant de retour. Il est de retour ! Il est revenu ! Notre père est de retour ! Ma Blakie, viens accueillir ton mari qui est parti pour l’hôpital il y a quelques semaines, car il est de retour pour t’adresser son dernier adieu."
Alors, les enfants comprirent. On avait ramené le corps de leur père. »
Il y a quelques années j’ai découvert « La Dot » de l’auteure nigériane Buchi Emecheta et je ne me rendais pas compte à quel point ce livre serait une illumination pour le lecteur que je suis, mais de façon totalement personnel. La force du roman.
Commençons pas le commencement. « La Dot ».
De ce roman, dont on peut tirer d’innombrables leçons, toutes aussi intéressantes les unes que les autres, soulignons juste le fait qu’il mette en scène l’imposante et forte « Ma Blackie », femme qui devra faire tous les sacrifices, notamment celui de céder au du Levirat, afin d’élever, en veuve, ses deux enfants Nna-Ndo et Aku-Nna. Je mets de côté toutes les péripéties que devra affronter cette famille ; les humiliations, les renoncements, les concessions de Ma Blackie, pour me focaliser sur le destin de Aku-Nna.
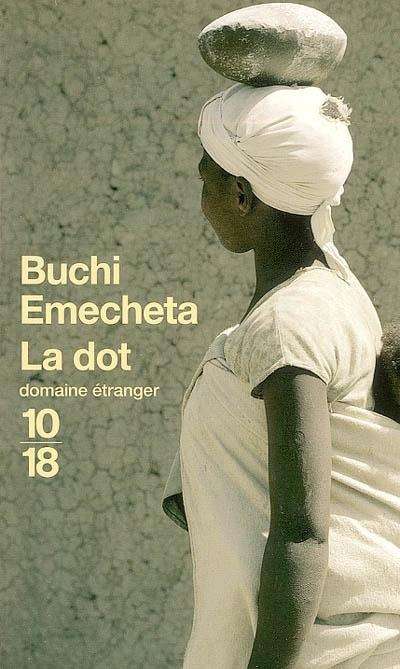
Cette famille de Lagos, grande ville plongée dans la modernité, va devoir déménager pour Ibuza, village reculé du Nigéria et va devoir vivre, subir, une belle-famille engoncée dans ses traditions, machiste et superstitueuse. La jeune fille, Aku-Nna, brillante et jolie, va tomber des les nasses amoureuses de Chiké, ‘instituteur du village. Là, on se dit que l’on tombe sur une amourette banale d’une fille issue d’une famille noble que la famille refuse catégoriquement à un homme, bien qu’intellectuel, bien que fils de commerçant riche, descendant d’une lignée d’anciens esclaves.
Ce qui m’avait frappé, à l’époque de ma lecture, c’était la manière dont le clan de Ezechiel Odia, le défunt mari, c’était retrouvé déclassé par rapport à la société nigériane. Le clan, issu de l’ethnie Ibo, n’est plus fait que d’analphabètes, de poivrots conservateurs et totalement rétrogrades. Et Chiké, fils d’ancien esclave, représente ceux qui dans la société nigériane sont les nouveaux tenant du pouvoir. C’est cette dichotomie qui m’avait marqué. L’irruption des blancs dans les sociétés nigérianes a provoqué le changement de paradigme car les père-blancs catholiques, en obligeant à la conversion au christianisme, ont également poussé les parents à envoyer leurs enfants à l’école missionnaire. Mais contrairement à La Grande Royale, tante de Samba Diallo personnage principale de l’immense « Aventure Ambigüe » de Cheikh Amidou Kané, les nobles Ibos refusèrent d’envoyer leurs fils à l’école de blancs. Là où le chef des Diallobés écoute sa sœur et envoi son fils, futur chef de clan, en Europe afin « d’apprendre cet art de vaincre sans avoir raison », les parents et grand-parents de Okonkwo et Ezechiel Odia ont choisi d’envoyer les fils d’esclave à l’école, ceux qui, selon eux, ne servent à rien et ont le sang assez impure pour perdre le temps à apprendre des choses qui ne servent à rien.
Deux générations plus tard, les Ibos se retrouvent dans une société sans dessus dessous où ceux qui détiennent le pouvoir ancestral, l’autorité culturelle, ne sont plus aux manettes du pouvoir administratif, politique et économique. Et l’on a la situation, que l’on retrouve aujourd’hui encore, au Mali par exemple, où une famille de cul-terreux interdit formellement une union avec un prétendant fortuné car « issu d’une caste basse ».
L’été dernier je suis allé en vacance au Congo. Le petit, pas le grand. Ma famille du Grand Congo est psychologiquement moins « stressée ». Quoi que. J’étais donc à Brazzaville et pour la première fois depuis longtemps j’ai eu l’occasion de discuter de l’héritage ethnique Téké dont j’aurai largement préféré garder dans les oubliettes de mon futur – un jour je vous raconterai pourquoi c’est digne d’une saga mode « La vengeance aux deux visages ».
Je savais déjà l’hécatombe qui s’était abattue sur la famille maternelle de mon paternel : mère, sœur, différents oncles morts alcooliques et quasiment SDF. Je savais l’héritage noble de cette branche familiale descendant direct de la reine Ngalifuru, qui fut inhumée assise avec deux de ses esclaves à ses côtés, signes de la grande noblesse de la dame. Je savais le gâchis des terres fait par les deux générations précédant la mienne, à savoir, avoir vendu quasiment tout le territoire de Brazzaville, par petits bouts, au grès des soirées bitures ou des maitresses à honorer, même si là j’ai eu un niveau de détails inédits et que je vous épargne. Je savais pas mal d’autres choses encore, mais au final si peu car, je l’avoue sans aucune restriction, ça ne m’intéressais absolument pas d’en savoir plus. Ça ne m’intéresse toujours pas tant que ça d’ailleurs, mais par la force des choses j’ai su de nouvelles choses.

J’ai su, par exemple, que l’arrière-grand oncle était celui à qui le grand roi Makoko a attribué la responsabilité de gérer la partie de son territoire qui correspond aujourd’hui à tout le Nord de la ville – jusqu’à, paraît-il, presque cent kilomètres – et qui fut l’interlocuteur de l’ex président Massamba-Débat qui demanda des terres aux Tékés pour les congolais qui furent expulsés, en 1964, de Kinshasa. J’ai appris cet été que le quartier, fameux, de Talangaï, fut ainsi nommé par ce grand oncle, et que le marché du quartier porte d’ailleurs son nom. Bref, j’ai saisi, plus que jamais auparavant, à quel point je suis, même marginalement, issu de Mfumu ya Toto, de propriétaires terriens, rois de Brazzaville, la capitale du pays. Et là, le lien Téké-Ibos m’est apparu dans toute sa crudité.
Les Tékés, plus que les Ibos, ont perdu avec le changement de pardigme colonial le pouvoir culturel. Les descendants des anciens chefs, les Mfumu ya Toto d’aujourd’hui, sont un ramassis de prolétaires vivant de miettes qui leur sont cédés par un cousin, issu d’une branche moins directe, et sont, au mieux locataires, au pire, SDF, sur la terre de leur ancêtre. L’aïeul à qui Makoko a donné le pouvoir sur la terre il y a quelques décennies n’a vu aucun intérêt à envoyer ses descendants à l’école. C’était pour les enfants de pauvres et d’esclaves… ma vérité a rattrapé la fiction ( ?) de Buchi Eméchéta.

Pire.
Le seul, cousin pourtant non héritier direct, qui a bénéficier d’une scolarité minimum, et qui porte donc les galons de « l’intellectuel » restant dans la famille a spolié et roulé dans la farine tous les ayant droit direct. Les vrais fils du chef. Résultats, par une cruelle moquerie, si vraie, les gens disent à Brazzaville « connaissez vous un Téké millionnaire dans cette ville ? ». Le pouvoir économique a été perdu, le pouvoir politique a été perdu ; les descendants vivent sur les cendres d’une grandeur culturelle passée. Ils n’ont même pas su préserver le semblant d’honneur de garder le nom de leur village. Mfoa est devenu Brazzaville, du nom du colon à qui, le premier aïeul, vendit le territoire. Celui qui a aujourd’hui un musée qui trône majestueusement dans la ville quant, les Tékés, n’ont même pas une stèle pour se souvenir de leur grandeur passé.
La « Dot » de Buchi Eméchéta m’est revenue au cerveau comme une révélation, vous disais-je, car elle souligne encore plus ce que, intuitivement, j’ai toujours ressenti ; le roman est un puissant vecteur de connaissance de l’autre. Au travers de ce récit de vie, que l’on croirait banal, d’une gamine Ibos, nigériane, aux antipodes de chez moi, j’ai découvert qu’il y avait un lien. Je vois les mêmes chocs civilisationnels qui ont frappé les deux ces deux groupes ethniques, je vois les unités culturelles, au-delà des langues, des religions importées – le Levirat, la peur des albinos, les superstitions sur les jumeaux, les femmes qui, encore et toujours, subissent et se battent pour leurs enfants… – et je découvre l’autre bien mieux que je ne l’aurai fait via un imposant traité éthologique, que je n’aurai sans doute pas lu jusqu’au bout d’ailleurs.
Le roman, totalement fictionnel ou auto-fiction, est un outil formidable que l’on devrait arrêter de regarder de haut. Il apporte, connaissance, ouverture d’esprit, horizons nouveaux et, ce qui est le principal, l’acte de lecture c’est fun.
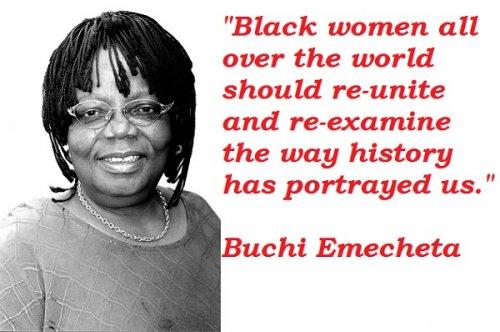
La dot, Buchi Emecheta
Editions gaïa (Collection 10-18)
1ère parution 1976
Traduction de l’anglais par Maurice Pagnoux

