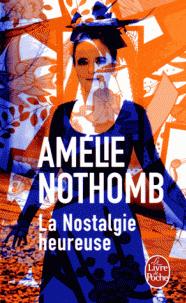 Un état proche du
bonheur : voilà comment nous nous sentions à la dernière page du
vingt-deuxième roman d’Amélie Nothomb, La nostalgie heureuse. Un état en harmonie avec le titre, qui ne nous est pas
familier au moment de découvrir, millésime après millésime, la production
régulière de l’écrivaine belge la plus populaire aujourd’hui. Nous n’avons en
effet pas souvent partagé l’enthousiasme des quelques centaines de milliers de
lecteurs et de lectrices qui lui font fête à chaque publication, au mois d’août
pour l’édition originale, un an et demi plus tard pour la sortie au format de
poche.
Entendons-nous bien,
puisque ceci mérite une explication : depuis 1992, le talent de la
romancière est une évidence difficilement contestable. Elle possède le don de
la formule, du dialogue, du trait vif – bien d’autres se contenteraient d’une
partie de ce qu’elle a reçu. Mais, car il y a un « mais », il nous a
trop souvent semblé qu’elle gâchait ce don, en enfant capricieux qui se
détourne très vite de ses plus beaux jouets : un vague sujet lui sert de
prétexte à filer un récit bref, qu’on lit en une heure et dont on oublie tout
très vite, sauf l’anecdote de point de départ. Une nouvelle aurait suffi, nous
sommes-nous dit à de multiples reprises…
Et pourtant, chaque
année, nous revenons vers Amélie Nothomb avec la certitude qu’elle réussira
bien, un jour ou l’autre, à nous séduire de nouveau. La patience est toujours
récompensée : c’est fait ! Et dès les premières lignes qui sont une
promesse cette fois tenue :
« Tout ce que l’on aime devient une fiction.
La première des miennes fut le Japon. A l’âge de cinq ans, quand on m’en
arracha, je commençai à me le raconter. Très vite, les lacunes de mon récit me
gênèrent. Que pouvais-je dire du pays que j’avais cru connaître et qui, au fil
des années, s’éloignait de mon corps et de ma tête ? »
On ne peut plus croire à
la coïncidence : quand Amélie Nothomb est à son meilleur, comme ce fut le
cas dans Stupeur et tremblements ou
dans Ni d’Eve ni d’Adam, c’est du
Japon qu’elle nous parle, c’est-à-dire d’elle-même dans ses fractures les plus
intimes. Elle utilise bien le détournement d’autobiographie dans d’autres
romans, mais sans nous toucher de la même manière, comme si c’était bien là, et
nulle part ailleurs, que se trouvait sa vérité de femme et de romancière.
L’anecdote : la
romancière accepte de partir au Japon avec une petite équipe de télévision pour
tourner un reportage sur les traces de son enfance. Elle a accepté d’autant
plus facilement qu’elle pensait que le sujet serait refusé. Et puis, non, le
projet se monte et il faut bien y aller, même à reculons. Quinze ans après son
dernier séjour, elle donne deux coups de téléphone pour préparer
celui-ci : au fiancé de Ni d’Eve ni
d’Adam et à la gouvernante de sa petite enfance, qui a gardé la voix
qu’elle avait autrefois.
Sur place, pendant neuf
jours, les contraintes parfois absurdes d’un tournage pour la télévision ne
parviennent pas à contenir ses émotions. Ainsi quand elle tombe en pâmoison
devant un caniveau où elle reconnaît celui de son enfance, sans le moindre
changement. Elle le fait remarquer à ses accompagnateurs, pour lesquels ce
détail n’a bien sûr aucun intérêt. Ce décalage, elle le vit à plein, tout le
temps, et jusque dans les rencontres. Cela pourrait être vain. Au
contraire : c’est plein. Bien que parfois indicibles, les moments sont
dits, écrits, jusqu’à faire ressentir le vide parfait et le kenshō : « Une épiphanie de cet état espéré, où l’on est de plain-pied avec
le présent absolu, l’extase perpétuelle, la joie exhaustive. »
Amélie Nothomb à son meilleur, c’est excellent.
Un état proche du
bonheur : voilà comment nous nous sentions à la dernière page du
vingt-deuxième roman d’Amélie Nothomb, La nostalgie heureuse. Un état en harmonie avec le titre, qui ne nous est pas
familier au moment de découvrir, millésime après millésime, la production
régulière de l’écrivaine belge la plus populaire aujourd’hui. Nous n’avons en
effet pas souvent partagé l’enthousiasme des quelques centaines de milliers de
lecteurs et de lectrices qui lui font fête à chaque publication, au mois d’août
pour l’édition originale, un an et demi plus tard pour la sortie au format de
poche.
Entendons-nous bien,
puisque ceci mérite une explication : depuis 1992, le talent de la
romancière est une évidence difficilement contestable. Elle possède le don de
la formule, du dialogue, du trait vif – bien d’autres se contenteraient d’une
partie de ce qu’elle a reçu. Mais, car il y a un « mais », il nous a
trop souvent semblé qu’elle gâchait ce don, en enfant capricieux qui se
détourne très vite de ses plus beaux jouets : un vague sujet lui sert de
prétexte à filer un récit bref, qu’on lit en une heure et dont on oublie tout
très vite, sauf l’anecdote de point de départ. Une nouvelle aurait suffi, nous
sommes-nous dit à de multiples reprises…
Et pourtant, chaque
année, nous revenons vers Amélie Nothomb avec la certitude qu’elle réussira
bien, un jour ou l’autre, à nous séduire de nouveau. La patience est toujours
récompensée : c’est fait ! Et dès les premières lignes qui sont une
promesse cette fois tenue :
« Tout ce que l’on aime devient une fiction.
La première des miennes fut le Japon. A l’âge de cinq ans, quand on m’en
arracha, je commençai à me le raconter. Très vite, les lacunes de mon récit me
gênèrent. Que pouvais-je dire du pays que j’avais cru connaître et qui, au fil
des années, s’éloignait de mon corps et de ma tête ? »
On ne peut plus croire à
la coïncidence : quand Amélie Nothomb est à son meilleur, comme ce fut le
cas dans Stupeur et tremblements ou
dans Ni d’Eve ni d’Adam, c’est du
Japon qu’elle nous parle, c’est-à-dire d’elle-même dans ses fractures les plus
intimes. Elle utilise bien le détournement d’autobiographie dans d’autres
romans, mais sans nous toucher de la même manière, comme si c’était bien là, et
nulle part ailleurs, que se trouvait sa vérité de femme et de romancière.
L’anecdote : la
romancière accepte de partir au Japon avec une petite équipe de télévision pour
tourner un reportage sur les traces de son enfance. Elle a accepté d’autant
plus facilement qu’elle pensait que le sujet serait refusé. Et puis, non, le
projet se monte et il faut bien y aller, même à reculons. Quinze ans après son
dernier séjour, elle donne deux coups de téléphone pour préparer
celui-ci : au fiancé de Ni d’Eve ni
d’Adam et à la gouvernante de sa petite enfance, qui a gardé la voix
qu’elle avait autrefois.
Sur place, pendant neuf
jours, les contraintes parfois absurdes d’un tournage pour la télévision ne
parviennent pas à contenir ses émotions. Ainsi quand elle tombe en pâmoison
devant un caniveau où elle reconnaît celui de son enfance, sans le moindre
changement. Elle le fait remarquer à ses accompagnateurs, pour lesquels ce
détail n’a bien sûr aucun intérêt. Ce décalage, elle le vit à plein, tout le
temps, et jusque dans les rencontres. Cela pourrait être vain. Au
contraire : c’est plein. Bien que parfois indicibles, les moments sont
dits, écrits, jusqu’à faire ressentir le vide parfait et le kenshō : « Une épiphanie de cet état espéré, où l’on est de plain-pied avec
le présent absolu, l’extase perpétuelle, la joie exhaustive. »
Amélie Nothomb à son meilleur, c’est excellent.
Magazine Culture
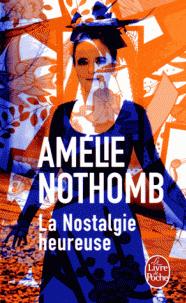 Un état proche du
bonheur : voilà comment nous nous sentions à la dernière page du
vingt-deuxième roman d’Amélie Nothomb, La nostalgie heureuse. Un état en harmonie avec le titre, qui ne nous est pas
familier au moment de découvrir, millésime après millésime, la production
régulière de l’écrivaine belge la plus populaire aujourd’hui. Nous n’avons en
effet pas souvent partagé l’enthousiasme des quelques centaines de milliers de
lecteurs et de lectrices qui lui font fête à chaque publication, au mois d’août
pour l’édition originale, un an et demi plus tard pour la sortie au format de
poche.
Entendons-nous bien,
puisque ceci mérite une explication : depuis 1992, le talent de la
romancière est une évidence difficilement contestable. Elle possède le don de
la formule, du dialogue, du trait vif – bien d’autres se contenteraient d’une
partie de ce qu’elle a reçu. Mais, car il y a un « mais », il nous a
trop souvent semblé qu’elle gâchait ce don, en enfant capricieux qui se
détourne très vite de ses plus beaux jouets : un vague sujet lui sert de
prétexte à filer un récit bref, qu’on lit en une heure et dont on oublie tout
très vite, sauf l’anecdote de point de départ. Une nouvelle aurait suffi, nous
sommes-nous dit à de multiples reprises…
Et pourtant, chaque
année, nous revenons vers Amélie Nothomb avec la certitude qu’elle réussira
bien, un jour ou l’autre, à nous séduire de nouveau. La patience est toujours
récompensée : c’est fait ! Et dès les premières lignes qui sont une
promesse cette fois tenue :
« Tout ce que l’on aime devient une fiction.
La première des miennes fut le Japon. A l’âge de cinq ans, quand on m’en
arracha, je commençai à me le raconter. Très vite, les lacunes de mon récit me
gênèrent. Que pouvais-je dire du pays que j’avais cru connaître et qui, au fil
des années, s’éloignait de mon corps et de ma tête ? »
On ne peut plus croire à
la coïncidence : quand Amélie Nothomb est à son meilleur, comme ce fut le
cas dans Stupeur et tremblements ou
dans Ni d’Eve ni d’Adam, c’est du
Japon qu’elle nous parle, c’est-à-dire d’elle-même dans ses fractures les plus
intimes. Elle utilise bien le détournement d’autobiographie dans d’autres
romans, mais sans nous toucher de la même manière, comme si c’était bien là, et
nulle part ailleurs, que se trouvait sa vérité de femme et de romancière.
L’anecdote : la
romancière accepte de partir au Japon avec une petite équipe de télévision pour
tourner un reportage sur les traces de son enfance. Elle a accepté d’autant
plus facilement qu’elle pensait que le sujet serait refusé. Et puis, non, le
projet se monte et il faut bien y aller, même à reculons. Quinze ans après son
dernier séjour, elle donne deux coups de téléphone pour préparer
celui-ci : au fiancé de Ni d’Eve ni
d’Adam et à la gouvernante de sa petite enfance, qui a gardé la voix
qu’elle avait autrefois.
Sur place, pendant neuf
jours, les contraintes parfois absurdes d’un tournage pour la télévision ne
parviennent pas à contenir ses émotions. Ainsi quand elle tombe en pâmoison
devant un caniveau où elle reconnaît celui de son enfance, sans le moindre
changement. Elle le fait remarquer à ses accompagnateurs, pour lesquels ce
détail n’a bien sûr aucun intérêt. Ce décalage, elle le vit à plein, tout le
temps, et jusque dans les rencontres. Cela pourrait être vain. Au
contraire : c’est plein. Bien que parfois indicibles, les moments sont
dits, écrits, jusqu’à faire ressentir le vide parfait et le kenshō : « Une épiphanie de cet état espéré, où l’on est de plain-pied avec
le présent absolu, l’extase perpétuelle, la joie exhaustive. »
Amélie Nothomb à son meilleur, c’est excellent.
Un état proche du
bonheur : voilà comment nous nous sentions à la dernière page du
vingt-deuxième roman d’Amélie Nothomb, La nostalgie heureuse. Un état en harmonie avec le titre, qui ne nous est pas
familier au moment de découvrir, millésime après millésime, la production
régulière de l’écrivaine belge la plus populaire aujourd’hui. Nous n’avons en
effet pas souvent partagé l’enthousiasme des quelques centaines de milliers de
lecteurs et de lectrices qui lui font fête à chaque publication, au mois d’août
pour l’édition originale, un an et demi plus tard pour la sortie au format de
poche.
Entendons-nous bien,
puisque ceci mérite une explication : depuis 1992, le talent de la
romancière est une évidence difficilement contestable. Elle possède le don de
la formule, du dialogue, du trait vif – bien d’autres se contenteraient d’une
partie de ce qu’elle a reçu. Mais, car il y a un « mais », il nous a
trop souvent semblé qu’elle gâchait ce don, en enfant capricieux qui se
détourne très vite de ses plus beaux jouets : un vague sujet lui sert de
prétexte à filer un récit bref, qu’on lit en une heure et dont on oublie tout
très vite, sauf l’anecdote de point de départ. Une nouvelle aurait suffi, nous
sommes-nous dit à de multiples reprises…
Et pourtant, chaque
année, nous revenons vers Amélie Nothomb avec la certitude qu’elle réussira
bien, un jour ou l’autre, à nous séduire de nouveau. La patience est toujours
récompensée : c’est fait ! Et dès les premières lignes qui sont une
promesse cette fois tenue :
« Tout ce que l’on aime devient une fiction.
La première des miennes fut le Japon. A l’âge de cinq ans, quand on m’en
arracha, je commençai à me le raconter. Très vite, les lacunes de mon récit me
gênèrent. Que pouvais-je dire du pays que j’avais cru connaître et qui, au fil
des années, s’éloignait de mon corps et de ma tête ? »
On ne peut plus croire à
la coïncidence : quand Amélie Nothomb est à son meilleur, comme ce fut le
cas dans Stupeur et tremblements ou
dans Ni d’Eve ni d’Adam, c’est du
Japon qu’elle nous parle, c’est-à-dire d’elle-même dans ses fractures les plus
intimes. Elle utilise bien le détournement d’autobiographie dans d’autres
romans, mais sans nous toucher de la même manière, comme si c’était bien là, et
nulle part ailleurs, que se trouvait sa vérité de femme et de romancière.
L’anecdote : la
romancière accepte de partir au Japon avec une petite équipe de télévision pour
tourner un reportage sur les traces de son enfance. Elle a accepté d’autant
plus facilement qu’elle pensait que le sujet serait refusé. Et puis, non, le
projet se monte et il faut bien y aller, même à reculons. Quinze ans après son
dernier séjour, elle donne deux coups de téléphone pour préparer
celui-ci : au fiancé de Ni d’Eve ni
d’Adam et à la gouvernante de sa petite enfance, qui a gardé la voix
qu’elle avait autrefois.
Sur place, pendant neuf
jours, les contraintes parfois absurdes d’un tournage pour la télévision ne
parviennent pas à contenir ses émotions. Ainsi quand elle tombe en pâmoison
devant un caniveau où elle reconnaît celui de son enfance, sans le moindre
changement. Elle le fait remarquer à ses accompagnateurs, pour lesquels ce
détail n’a bien sûr aucun intérêt. Ce décalage, elle le vit à plein, tout le
temps, et jusque dans les rencontres. Cela pourrait être vain. Au
contraire : c’est plein. Bien que parfois indicibles, les moments sont
dits, écrits, jusqu’à faire ressentir le vide parfait et le kenshō : « Une épiphanie de cet état espéré, où l’on est de plain-pied avec
le présent absolu, l’extase perpétuelle, la joie exhaustive. »
Amélie Nothomb à son meilleur, c’est excellent.
