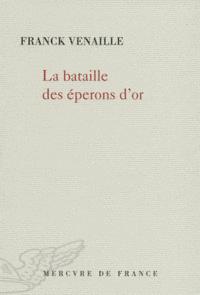 Malgré son allure martiale, chevaleresque, épique, ce titre est à prendre avec toute la suspicion ironique nécessaire. Cette bataille, dite aussi de Courtrai, a eu lieu en 1362, entre l’armée de Philippe le Bel et les rebelles flamands. Déroute totale des Français dont les chevaliers, stupidement embourbés avec leurs montures dans les marécages, se sont fait exterminer par les fantassins flamands, qui leur ôtaient leurs éperons dorés en guise de trophées. Cet événement historique n’a qu’un rôle marginal dans le livre, pour faire écho à la guerre d’Algérie qui, elle, hante. Même enlisement dans le bourbier, même défaite humiliante : « Nous sommes tous des stratèges de chambre froide. » (p.81) Sur un mode farcesque noir, « un péquenaud local, brave homme sans doute, va, d’un corps à l’autre, (pour rigoler) couper systématiquement les moustaches de l’élite de la Chevalerie française », tout comme les drapiers-soldats flamands collectaient les éperons. Aucun épique guerrier, les souvenirs du poète nous entraînent plutôt du côté de l’hôpital avec ces blessés qui « n’ont plus de bras. Il leur reste quelque chose qui ressemble à un corps. » (p.80). Venaille ne montre pas les combats mais leurs effets désastreux. Face à l’absurdité et l’horreur grandit l’envie de suicide ou de désertion lorsque le train vous emmène en permission (pp.52-54). Cette guerre semble une immense vague de bêtise mortifère et sans gloire : « la quincaillerie des médaillés à large poitrine de bœuf. Monstres divers, à la foire de guerre exposés » (p.44). La guerre est faite par ceux qui n’en veulent pas, et ceux qui la veulent ne la font pas : « marraines de guerre » (p.47), « Dame de la Croix-Rouge et des comités de Ceci et Cela »(p.39)… Le soldat est engagé dans un conflit qui n’est pas le sien : « il fallait continuer à se battre. Pour demeurer fidèle à la charte signée autrefois par nos pères. » (p.84)
Malgré son allure martiale, chevaleresque, épique, ce titre est à prendre avec toute la suspicion ironique nécessaire. Cette bataille, dite aussi de Courtrai, a eu lieu en 1362, entre l’armée de Philippe le Bel et les rebelles flamands. Déroute totale des Français dont les chevaliers, stupidement embourbés avec leurs montures dans les marécages, se sont fait exterminer par les fantassins flamands, qui leur ôtaient leurs éperons dorés en guise de trophées. Cet événement historique n’a qu’un rôle marginal dans le livre, pour faire écho à la guerre d’Algérie qui, elle, hante. Même enlisement dans le bourbier, même défaite humiliante : « Nous sommes tous des stratèges de chambre froide. » (p.81) Sur un mode farcesque noir, « un péquenaud local, brave homme sans doute, va, d’un corps à l’autre, (pour rigoler) couper systématiquement les moustaches de l’élite de la Chevalerie française », tout comme les drapiers-soldats flamands collectaient les éperons. Aucun épique guerrier, les souvenirs du poète nous entraînent plutôt du côté de l’hôpital avec ces blessés qui « n’ont plus de bras. Il leur reste quelque chose qui ressemble à un corps. » (p.80). Venaille ne montre pas les combats mais leurs effets désastreux. Face à l’absurdité et l’horreur grandit l’envie de suicide ou de désertion lorsque le train vous emmène en permission (pp.52-54). Cette guerre semble une immense vague de bêtise mortifère et sans gloire : « la quincaillerie des médaillés à large poitrine de bœuf. Monstres divers, à la foire de guerre exposés » (p.44). La guerre est faite par ceux qui n’en veulent pas, et ceux qui la veulent ne la font pas : « marraines de guerre » (p.47), « Dame de la Croix-Rouge et des comités de Ceci et Cela »(p.39)… Le soldat est engagé dans un conflit qui n’est pas le sien : « il fallait continuer à se battre. Pour demeurer fidèle à la charte signée autrefois par nos pères. » (p.84)
Guerre absurde, aux effets durables, obsédants : « Je ne pose que des questions auxquelles il est impossible de répondre. Cinquante ans ont passé. Ordre formel : enjamber les cadavres. » (p.25) Mais ce désir de dépasser le traumatisme se heurte au fait qu’il est ravivé par le monde tel qu’il tourne aujourd’hui : « « L’état de guerre n’en finit pas. » (p.9) L’Histoire ressemble à un vaste marécage où l’on s’enlise, on s’embourbe, on se perd ; et le paysage peut glisser à celui, plat, saturé d’eau et de décomposition des tourbières des Hautes-Fagnes, l’autre versant mémoriel du livre.
Sans tenir compte de l’emploi ou non des majuscules, de la disposition ou non en strophes, de la présence ou pas de ponctuation, on peut distinguer neuf formes d’écriture différentes qui alternent vite au travers des séquences, passant de la prose au verset au vers libre, et à leurs variations. C’est sans doute le côté virtuose de Venaille, « joueur de violon d’asphalte » : « il y a seulement à jouer vite si l’on veut vite retrouver l’atmosphère des années passées trop vite sans que l’on puisse les arrêter » (p.15). A travers le livre, on retrouve cette rapidité des enchaînements, glissements, sauts et passages en une sorte de flux continu et chaotique de mémoire. Mais le poète joue surtout sur trois strates nettes de temps : l’enfance, l’Algérie, maintenant. Et un seul questionnement existentiel, entre douleur et sarcasme, ironie et distance, nausée qui perdure ou désespoir qui noie. Au détour d’une page, Venaille serre cela en deux phrases : « Il redevenait l’enfant des Hautes-Fagnes. Fantassin parmi d’autres fantassins, tentant de répondre à la seule question qui vaille : « Qui suis-je ? » » (p.83)
Pour aller vite, l’enfance, la relation au père et à la figure maternelle sont aussi ambivalentes et complexes que ce paysage des Hautes-Fagnes entre forêt et tourbières, à la fois aimé et inhospitalier. « Je suis un ancien enfant » (p.64) : mais les souvenirs qui reviennent sont aussi bien ceux de « l’enfance mauvaise » (p.63) et de « la crainte enfantine des monstres » (p.92), que ceux du « Mien cheval de bois fabriqué par mon père » (p.43) ou du « pain d’épices / pour oiseaux ». Passé contrasté donc, mais mélancolie tenace, même si « pleurer semble trivial » (p.87). Lorsque la mort bouclera la boucle, elle permettra le retour vers ce pays, comme un apaisement : « Nous partirons. Nous retrouverons nos lieux d’enfance. Et la forêt des Hautes-Fagnes demeurera ce qu’elle fut pour nous tous. Le lieu de rencontre des cloches annonçant notre mort, avec celle du glas qui résonnera, plus tard, afin que chacun se souvienne. » (p.77)
Cette proximité de la fin n’affaiblit en rien l’énergie du questionnement sur vivre. Et Venaille n’y répond pas plus qu’il ne se plaint, c’est une des forces de ce livre. Dès la première page : « Que s’est-il passé, autrefois que je n’ai pas compris, jamais admis. (…) Que peut l’art dans tout cela ? » (p.9) Le poète se heurte à l’énigme de sa vie : il l’a dirigée sans pour autant la comprendre (p.83). « Dans une sorte de solitude amère. (…) Tout devient plus opaque. Vivre ! Car il s’agit bien de cela, n’est-ce pas ! Vivre ! » (p.47) On est sans doute là au cœur du livre, dans une contradiction souffrante entre une foi réitérée dans la poésie, l’élan de l’écriture, et la butée sur une question sans fin « je veux savoir pourquoi ! » (p.49)
Pour conclure, deux figures de femmes, aussi marginales qu’émouvantes, claire/sombre, blonde/brune. Dans leurs apparitions incidentes et insistantes à la fois, elles sont représentatives du travail de Venaille sur l’écriture du souvenir et sa façon de le disséminer dans le livre. « L’été est une jeune fille blonde » (p.24) ; « « Je ne peux pas vivre sans mes livres de philosophie », dira-t-elle, lui disait-elle, dit-elle. Sous un ciel métamorphosé en linceul. » (p.45) ; « « Je ne peux pas vivre éloignée de mes livres », disait-elle. (…) Et la neige sous nos pas crissait. Nue. Comme elle le serait bientôt. Elle aussi. » (p.64) ; « Alors elle glissa ses doigts sur mes poignets. « Ce sont ceux d’un artiste. Un violoniste. Il me semble. » Et leurs mains, désormais l’une contre l’autre se dévoilent et se serrent. Voilà de quoi, quelques dizaines d’années plus tard, il souhaitait se souvenir. » (p.66)
Citer suffit. Pour la brune, la sombre et pourtant belle : « La dernière fois que j’ai croisé la douleur elle portait voilette et gants noirs. C’était sur un quai de gare. Belle. Inaccessible. Sourire las toutefois. » (p.31) « Je reconnus cette silhouette aperçue sur un quai de gare. Celle qui, depuis tant d’années, de bouges en palaces, me précède. Voilà ce qu’au cœur des Hautes-Fagnes elle dit : “Je suis l’expression de la douleur ! J’ai toujours pensé que c’était à vos côtés que je trouverais ma place.” » (p.94)
Ce sont les dernières lignes de ce beau livre, aussi puissant dans son écriture que dans ses enjeux.
[Antoine Emaz]
Franck Venaille, La bataille des éperons d’or, Mercure de France, 100 pages, 12,90 €

