« Une patrie portative pour les sans patrie », Sanpatri de Sylvie Durbec
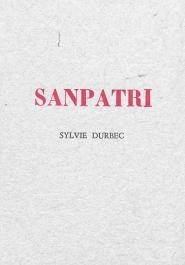
Mais qu'on ne s'y trompe pas : si le poème emprunte à l'autobiographie, au roman familial, il n'est pas, pour autant, le lieu d'une recherche mythifiée des origines, car la poète (employons, comme Sylvie Durbec, indifféremment le masculin ou le féminin, puisque, selon elle, « Poète est un nom épicène », p. 17 ! ) dit « préférer la demeure à la terre natale » (p. 27) et avoue même un moment, comme un pied de nez : « je n'ai ni sœur ni jumelle ni père ni mère ni frère » (p. 37). Le poème ne sera donc pas l'outil de l'archéologue qui déterre les traces enfouies ; il sera bien plutôt un salut aux « fantôme[s] » (p. 47), et ce qui du passé permet une relance indéfinie. Non l'adjuvant d'une quête originelle, mais une force germinative – la chance offerte aux commencements : « je veux que ça commence / je veux le commencement / je ne veux pas l'origine / je veux initier le verger / commencer à écrire » (p. 12). L'ouverture-dédicace du livre (« Une patrie portative pour les sans patrie »), reprise ici et là, se comprend ainsi comme la force qui porte les mots du poème. On sait que de nombreux biblistes voient dans la destruction du Temple de Jérusalem et dans la déportation du peuple hébreu à Babylone la raison de la valorisation de la Bible (de ce que notre tradition occidentale appelle la Bible), du Livre devenu, en l'absence de patrie réelle, la « patrie portative ». Sylvie Durbec reprend donc à son compte cette riche référence : faute de centre originaire, il y aura un texte – pour elle le poème qui s'écrit – qui nous permettra d'être des « voyageur[s] accompagné[s] » (p. 11).
Le chiffre 5, qui structure tout le livre, est sans doute à entendre dans ce sens. Il se peut que quelque symbolisme s'y attache (« y aller de mon 5 / comme d'autres de leur 7 », p. 12 ; « pourtant le chiffre 4 est banni en Asie / si le 5 est celui de la patrie portative », p. 48) ; mais ce qui importe plus encore ici, c'est que ce chiffre se retrouve significativement au début et à la fin du livre. Il en est aussi le principe d'organisation, puisque les poèmes sont regroupés en « LIVRE[S] UN, DEUX, TROIS, QUATRE, CINQ ». Et la référence à la Bible, dans le deuxième livre, est précisément liée à ce que la traduction issue du grec nomme « le Pentateuque » et qui donne à chaque poème leur titre : « Genèse », « Exode », « Lévitique », « Nombres », « Deutéronome ».
Il en va de même pour l'importance accordée à l'initiale – donc au commencement – des mots. Souvent, le poète emploie l'énumération ou l'effet de liste ; et cela semble régi, en maints endroits, par le principe d'une répétition de la première lettre ou du premier phonème des mots : « fonds perdus faillites et fraudes », « pertes et profits / patrie portative » (p. 14), « épeler éplucher écailler » (p. 17), « De bordilles à bordures en broderies on aborde en terre. » (p. 31) jusqu'au « nom d'Heinrich Heine » (p. 14)... C'est d'ailleurs surtout le [d] qui est mis en valeur. « [I]l va falloir briser le comptoir des mots et faire banqueroute de toute l'épargne que la langue recèle derrière la barrière des dents D comme dépense délit douleur », dit la poète, avant de poursuivre sur « tous ces deuils et ces dons ces dettes et ces dits et redits » (p. 17). C'est que ce phonème permet de centrer l'écriture sur ce qui fait le versant plus sombre de ces poèmes (« la douleur » et « le mont Dol / le menhir du Champ Dolent / et Dol de Bretagne », p. 34, ainsi que le mot éloquent de « décédé » (p. 20), qu'il faudrait souligner entièrement ! ) et l'attention portée au nom propre : « on continue à se battre contre certains mots […] alors pour nous clore le bec on nous dit […] et peu à peu la langue maternelle dans la bouche ne tourne plus rond et se retourne net en son usage […] poètes nous n'en avons plus l'usage traverse des durbecs » (p. 19).
Voici donc une écriture qui, tout à la fois, porte et est portée par le souci du/des commencement(s). Mais on ne s'étonnera pas non plus de voir qu'une certaine horizontalité prévaut sur une verticalité. À rebours d'un poème tragique ou métaphysique qui questionnerait un fondement ou qui déplorerait la perte d'une origine, Sylvie Durbec propose une écriture de la marche et de l'en-avant. D'emblée, « il faut mettre dans la besace du pèlerin de quoi nourrir son voyage » (p. 11) et il s'agit, par le poème, de « devenir piéton de l'air » (p. 35). D'où l'intérêt porté aux destinations autres (Chine, Portugal, Finlande, Russie...), aux lieux limitrophes (une bonne partie de l'ouvrage a été écrite en Bretagne !), à « tout ça ouvert entre terre et ciel » (p. 4). D'où aussi les références au religieux, jamais pesantes, mais prises dans le quotidien le plus banal (« ALMA MATER […] voilà j'écris en latin à cause que je connais pas le breton et que je veux écrire hic et nunc ici et maintenant en haut de la page du livre », p. 36) ou emportées par le mouvement horizontal de « jésus marchant / sur la mer » (p. 35). D'où enfin les nombreux passages qui parlent d'oiseaux, car « cette patrie ne peut être que portative volatile même obstinée à voler plutôt qu'à s'accrocher à la terre l'origine et la racine sont au futur dans cette patrie à venir » (p.19).
Un des « cinquante rêves » du « LIVRE CINQ » est à ce titre particulièrement éclairant : « J'ai rêvé de la colombe qui se posa sur ma tête quand j'avais dix ans lorsque j'étais en colonie de vacances chez des religieuses en Isère. » (p. 44). On y retrouve un rappel de la descente de l'Esprit-Saint, sous l'apparence d'une colombe, au baptême du Christ – référence solennelle et mouvement vertical. Mais cette mémoire est comme allégée par la grâce et le réalisme d'un souvenir d'enfance – par une sorte de verticalité. Alors, loin de l'esprit de sérieux que pourrait comporter le récit d'une scène originaire, la parole de Sylvie Durbec se fait ici légère comme un vol d'oiseau... Simplicité des mots et parfois maladresse voulue des tournures, légèreté de poèmes proches des contes et comptines, cette parole évoque même, bien souvent, l'« enfer et paradis de la marelle » (p. 44) ; elle possède en tout cas toujours une saveur enfantine.
C'est que, face à une vision de l'origine qui serait du ressort d'une sexualisation exclusive, la poète préfère aller « greffant du féminin sur du masculin / sans le secours du singulier ni du pluriel » (p. 39), par quoi elle veut réveiller le lecteur : « plus personne ne connaît l'usage d'un bottin / masculin de bottine entendons-nous bien c'est comme cette patrie portative dont nous vous rebattons les oreilles » (p. 19).
C'est aussi que, face au poème de la quête identitaire, la poète préfère l'altérité, c'est-à-dire la « langue de l'étranger » (p. 13) tout comme l'étrangeté à soi – ce qu'elle nomme en maints endroits « l'heimatlos », la personne dépourvue de nationalité légale, et qu'elle rend par le mot-calque (et la belle invention) du « sanpatri ». On ne s'étonnera pas, alors, de lire sous sa plume des mots italiens, germaniques, latins, catalans (« J'ai rêvé que la nouvelle langue parlée dans la patrie portative serait un mélange de portugais, de finnois, de russe, avec un peu de syntaxe française. », p. 44), non plus que de rencontrer des tournures inventées (« nécrire », p. 38 à 40, « Nonzom », p. 47, « Je me quinze à vous le dire », p. 35, etc.). Le mélange des registres (comique, pathétique...), des formes (passage des vers à la prose, et vice-versa) et même des écritures (Sylvie Durbec n'hésite pas à citer d'autres textes, et les poèmes des pages 29-30 et 41 mêlent son écriture propre à celle d'Edith Azam) vont dans le même sens : celui d'un passage et d'un partage des voix.
C'est enfin que, face au poème autarcique, la poète préfère donner la parole – ce qu'elle fait par ailleurs avec sa Petite Librairie des Champs ! –, c'est-à-dire émet le vœu que le poème soit « le moment le lieu de » (p. 12) « mettre ensemble » (p. 22). La belle finale de ce livre le dit bien – et le fait, à sa manière, par l'entrelacement des [tor] et [ort], des [a], des [ã], des [v] et des [j] – : le poème est ce qui « fait aller ensemble l'oiseau et la charrue / la main et le torrent / la morte et les vivants / la colère sur le visage / avec celle des orages » (p. 48). C'est pourquoi le livre se clôt sur ce mot en italique – « ensemble » –, qui porte sans doute au plus haut le faire du poème, sa valeur à la fois sublime et banale.
Face aux paroles qui séparent, face aussi à une quête des origines qui n'est qu'un prétexte aux divisions, il est bon qu'un poème des commencements insiste sur un tel mot.
[Yann Miralles]
Sylvie Durbec, Sanpatri, Jacques Brémond, 2014, 48 p., 16€
Une lecture d’extraits de Sanpatri par Sylvie Durbec

