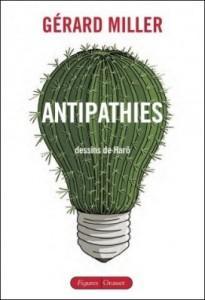 En 1866, Emile Zola publia un recueil d’articles sous le titre, surprenant tant sa connotation paraît négative pour un lecteur contemporain, Mes Haines. Récemment, est sorti en librairies un essai du psychanalyste médiatique Gérard Miller, intitulé Antipathies (Grasset, 224 pages, 18 €). La comparaison s’arrête là.
En 1866, Emile Zola publia un recueil d’articles sous le titre, surprenant tant sa connotation paraît négative pour un lecteur contemporain, Mes Haines. Récemment, est sorti en librairies un essai du psychanalyste médiatique Gérard Miller, intitulé Antipathies (Grasset, 224 pages, 18 €). La comparaison s’arrête là.
L’ouvrage de Zola rassemblait de longs textes de critique très étayés dans lesquels il attaquait ou défendait peintres et écrivains autour d’idées solidement construites. A l’opposé, le livre de Gérard Miller se présente comme un catalogue d’allergies éparpillées, en d’autres termes exposées sans ordre alphabétique, thématique ni chronologique, dont l’argumentation se réduit le plus souvent à quelques lignes ou paragraphes.
Bien entendu, on suit l’auteur dans certaines de ses aversions, comme on approuve en souriant l’éternelle litanie des finalistes du concours de Miss France avouant naïvement « La guerre, c’est mal, la paix c’est bien. » Qui, en effet, pourrait aujourd’hui raisonnablement soutenir le libéralisme sauvage, l’obscurantisme religieux, la politique pénale désastreuse des Etats-Unis, l’homophobie, le travail des enfants, les génocides, la finance folle, le négationnisme, la téléréalité imbécile, la pauvreté, le racisme sous toutes ses formes ou le puritanisme (mais y compris celui de la « Gauche morale »...) ?
D’autres répulsions laissent indifférent ou étonnent simplement, comme celles se rapportant aux tatouages, aux téléphones portables, au bon sens populaire, aux jeux de hasard. On est toutefois frappé par deux thématiques récurrentes : l’extrême-droite et Vichy, qui s’invitent dans près d’un quart des 123 entrées du livre, au risque de lasser le lecteur et, surtout, de produire un fâcheux effet contreproductif.
Plus intéressantes sont les attaques dirigées contre des personnalités, qui témoignent d’un art de la rosserie mieux maîtrisé que celui de l’impartialité - mais c’est ici la loi du genre. Ainsi, l’imitateur Laurent Gerra, « jeune beauf à la vulgarité satisfaite, mais efficace », Jacques Vergès, « un avocat pervers qui jouissait d’épouser les causes infâmes de ses clients » sont-ils brocardés parmi d’autres. Frédéric Taddeï, parce qu’il ne cède pas au politiquement correct ambiant dans le choix de ses invités, se trouve aussi habillé pour l’hiver. C’est de saison.
De Gaulle, encore, est malmené pour « toutes [ses] casseroles » et pour ses Mémoires de guerre qui n’évoquaient pas la shoah, dans un rapprochement si anachronique et excessif avec le consternant « détail » de Jean-Marie Le Pen qu’il rend le propos insignifiant. En revanche, Mao, dont le règne sanglant fournirait à lui seul toute une batterie de cuisine, reste épargné par l’auteur, ancien de la Gauche prolétarienne, il est vrai.
D’autres personnages émergent au fil des pages. A leur seul renommée, le lecteur retient son souffle ; il imagine qu’on va enfin lui « montrer qui c’est Raoul » ; il redoute l’exécution en règle, l’étrillage suprême, l’éreintage définitif... Mais il reste sur sa faim. Le regretté et brillant Philippe Muray, pourtant grand pourfendeur des « mutins de Panurge » si proches du rédacteur, lui fait juste « penser à Jean Dutourd, mais en mieux ». C’est un peu court. Michel Onfray, qui publia il y a quelques années un violent pamphlet contre Freud, n’est qualifié que de « fils caché que Zavatta aurait eu avec Nietzsche. » Pourquoi une telle mansuétude ? La réponse figure dans le livre : « Jean-Paul Enthoven, mon éditeur, vient aux nouvelles. Dans ce livre que je suis en train d’écrire, vais-je dire du mal de Michel Onfray, qu’il n’aimerait pas me voir houspiller : Onfray est un auteur de Grasset, ce ne serait pas courtois. Je rassure mon ami Jean-Paul. » Baudelaire, qui avait le sens de la formule, appelait cela « les camaraderies effrontées »...
La rhétorique du psychanalyste est parfois mieux huilée, comme lorsqu’il évoque Marc-Edouard Nabe : « Dans un certain nombre d’années, quand ce spécialiste du second degré nauséabond aura passé l’arme à gauche, il y aura certainement un Fabrice Luchini pour venir chanter sur scène le génie de sa diarrhée verbale. » Une manière de « tacler » à la fois sa cible principale, puis Fabrice Luchini, enfin implicitement Louis-Ferdinand Céline - tout en omettant de préciser que l’excellent acteur ne lit au théâtre que des extraits du Voyage au bout de la nuit ou de Mort à crédit - deux chefs-d’œuvre littéraires - ou de sa correspondance, mais aucunement de ses pamphlets antisémites, effectivement nauséabonds.
Une motivation éthique, peut-être, une argumentation étique, sûrement, font de ce livre une leçon de morale bien-pensante permanente et dressent, comme on assemble un puzzle, un portrait en creux de l’auteur. Il est sans doute louable, et même courageux, d’avoir « le glaive vengeur et le bras séculier » d’un chevalier blanc, à condition toutefois d’être absolument irréprochable. Or, la méthode de Gérard Miller n’est pas exempte de tout reproche.
Un exemple suffira. L’entrée concernant Elisabeth Roudinesco s’ouvre sur une curieuse phrase : « Elisabeth Roudinesco devant la justice, accusée de diffamation par mon frère Jacques-Alain. » Ces quelques mots, pour beaucoup de lecteurs, qui ne suivent pas par le menu les conflits qui opposent les différents courants de la psychanalyse, pourraient facilement laisser entendre qu'Elisabeth Roudinesco aurait diffamé Jacques-Alain Miller, même si le texte ne fait référence qu'à une accusation, non à une condamnation - deux termes que l'on amalgame pourtant trop souvent. Or, la réalité est tout autre : le procès en question, qui se rapportait à « l’affaire Kadivar », déjà évoquée dans ces colonnes, donna en effet lieu, le 11 septembre 2013, à un jugement de la 1ère chambre du TGI de Nanterre qui débouta Jacques-Alain Miller de ses demandes, ce que ne pouvait ignorer son frère. Il n’y avait donc pas eu diffamation, ce qu'il eut été bon de préciser pour n'entretenir aucune ambiguïté. Encore une omission, passablement perfide ! L’Histoire, même littéraire, réserve parfois de curieux raccourcis : « Contre la médisance, il n’est point de rempart », écrivait Molière. C’était dans Tartuffe...

