Christopher Nolan, 2014 (Etats-Unis)

KUBRICK’S CUBE DANS L’ESPACE ?
Certains cinéastes considéreraient-ils la réalisation d’un film dans l’espace (bien distinct du film de SF, même si les deux peuvent être confondus) comme un passage obligé au cours de leur carrière, une sorte de figure imposée qui les inscrirait enfin dans les pas des plus grands et notamment d’un certain Stanley Kubrick ? Comme si 2001, pourtant réalisé en 1968, était resté la référence absolue et indépassable en matière d’esthétique spatiale. Brian de Palma (Mission to Mars, 2000), Steven Soderbergh (Solaris, 2002), Danny Boyle (Sunshine, 2007), Aflonso Cuarón (Gravity, 2013) et désormais Christopher Nolan, la liste des cinéastes qui s’inscrivent dans cette filiation s’allonge lentement mais sûrement, alors que le genre était considéré comme moribond au tournant du siècle. Déjà largement dépoussiérée par la sortie l’année dernière de Gravity, immense succès commercial et tour de force technique, l’épopée spatiale suscite à nouveau un vif intérêt avec l’arrivée sur les écrans d’Interstellar.
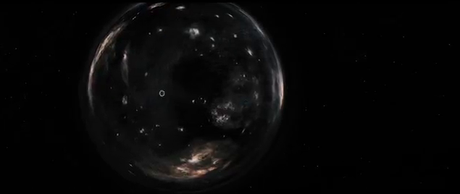
LES TROUS NOIRS DE LA PROMOTION
Cette fois, Nolan nous propose un véritable film de science-fiction, dont les thématiques seront certainement familières aux amateurs du genre, voire un peu trop diront les mauvaises langues. Toujours est-il que les différents trailers, dont la diffusion savamment orchestrée tout au long de l’année dernière s’est montrée prodigieusement efficace, ont fait monter la pression. En l’espace de quelques mois, Interstellar est devenu l’un des films les plus attendus de l’année, mais également la réponse claire de Nolan à Gravity de Cuarón, bien que le premier s’en défende. Interstellar étant un film au budget conséquent, le rouleau compresseur hollywoodien s’est mis en branle quelques semaines avant sa sortie, assurant une promo de tous les instants, hélas pas toujours des plus subtiles. Ainsi, la production s’est assurée les services de l’astrophysicien Kip Thorne, considéré comme l’un des plus éminents spécialistes actuels de la relativité générale. Fort de cette caution scientifique, l’équipe de communication s’est efforcée d’expliquer au monde entier qu’Interstellar serait le film de science-fiction le plus réaliste jamais créé et que les moyens mis en œuvre en matière de simulation numérique permettraient à l’équipe de Kip Thorne de publier d’importants travaux scientifiques dans les prochains mois. Mais de quoi parle-t-on ? Essentiellement de la modélisation à l’écran du trou noir (prénommé Gargantua dans le film) au cœur du scénario imaginé par Jonathan Nolan (le frère du réalisateur). Premier effet d’annonce et premier dérapage incontrôlé pour la production, qui avait oublié les travaux de Jean-Piere Luminet et Jean-Alain Mack (dans les années 1980), premiers scientifiques à avoir modélisé des trous noirs à l’aide d’ordinateurs dont les capacités techniques, pourtant, feraient (et ce qui est d’autant plus notable) écrouler de rire n’importe quel smartphone aujourd’hui. Pire, il s’avère qu’en réalité, la modélisation du trou noir et de son disque d’accrétion affichée dans le film est tout simplement fausse. Kip Thorne serait-il un menteur ou pire un incompétent ? Loin de là, le scientifique avait d’ailleurs envoyé un courrier à Jean-Pierre Luminet (qui, rappelons-le, est l’un des plus éminents spécialistes mondiaux des trous noirs) pour lui expliquer la teneur du problème. Les spectateurs étant en fait des imbéciles, la production a préféré une représentation fausse du trou noir (ou plutôt de son disque d’accrétion, normalement fortement dissymétrique), qui serait plus facile à comprendre et à appréhender pour des néophytes. On voit bien à travers cette petite démonstration, que le film de Nolan partait sur des bases tout à fait saines. Mais revenons plutôt au scénario et au propos d’Interstellar, nous aurons l’occasion un peu plus tard de pointer les nombreuses aberrations scientifiques et techniques qui émaillent un film qu’on avait pourtant annoncé comme irréprochable sur ce plan.

QUITTER LA TERRE ou L’AMÉRIQUE EN PERDITION
Reconnaissons à Nolan une certaine ambition en matière de science-fiction, loin de l’ambiance pulp d’une bonne partie de la production actuelle et passée (Star wars, Star Trek, Les gardiens de la galaxie, j’en passe et des meilleures….), le film s’inscrit dans une vision plutôt réaliste de l’avenir. La Terre, exsangue, ne parvient plus à nourrir l’humanité ; le changement climatique, les maladies, l’épuisement des ressources ont mis un terme au développement technologique à outrance et au gaspillage, en un mot, à la société de consommation. Désormais, l’objectif est d’assurer l’alimentation de la population mondiale envers et contre tout. Les Etats-Unis, cette superpuissance économique et militaire, autrefois conquérante et pionnière, s’est transformée en une nation de gentils agriculteurs qui luttent sans cesse contre les éléments (des tempêtes de sable essentiellement) et les maladies qui ravagent leurs cultures. Cooper, le héros du film, est l’un de ces agriculteurs, un ancien pilote de la NASA (considérée après la crise comme un organisme de propagande et démantelée) reconverti dans la culture du maïs car le blé est devenu désormais trop difficile à produire. Veuf depuis que sa femme est morte d’un cancer, Cooper vit donc avec son beau-père, sa fille et son fils, une existence de paysan éclairé, débrouillard et malin, dans un pays qui sombre peu à peu dans l’ignorance et la sous-industrialisation (entendre le passage sur la propagande de la NASA et la conquête de la Lune lors de la scène de l’école). Cette partie du film n’est d’ailleurs pas sans rappeler un autre long métrage de science-fiction, Idiocracy de Mike Judge (2006), qui décrivait les errements d’une société post-industrielle désormais peuplée de débiles plus ou moins légers, totalement incultes et incapables de comprendre et d’entretenir la technologie du passé. Cette comédie satirique, pas toujours très subtile mais parfois drôle, illustrait une autre crainte de l’avenir, celle de la baisse des capacités intellectuelles de l’espèce humaine, une illustration un rien forcée qui avait surtout pour objectif d’écorner les travers de la société américaine. Sans aller jusque-là, Nolan décrit une humanité qui se replie face à l’adversité et revient à des considérations plus triviales, mais finalement essentielles. L’homme est donc désormais bien loin des étoiles et son rêve de quitter la Terre n’est plus dicté par l’esprit de conquête et de découverte, seulement par la nécessité de fuir une planète de plus en plus hostile à la vie. Par une série de faits hautement improbables sur lesquels je passerai rapidement, Cooper et sa fille découvrent une base cachée de la NASA, dans laquelle les survivants du rêve spatial œuvrent pour que l’humanité puisse enfin partir vers les étoiles à la découverte d’une nouvelle planète plus accueillante. Problème, comment quitter le système solaire alors que l’étoile la plus proche de nous se situe déjà à plusieurs années lumières et surtout comment sauver des milliards d’individus alors qu’on ne dispose que d’un modeste vaisseau spatial, à peine capable de transporter quatre astronautes vers Mars. C’est à ce stade qu’intervient évidemment le fameux trou noir dont il était question plus haut et la théorie des trous de vers, qui permettent de plier ou contracter l’espace-temps pour voyager en un claquement de doigts d’un bout à l’autre de la galaxie. Cooper et trois scientifiques sont donc envoyés à bord du dernier vaisseau en possession de la NASA à la rencontre d’un trou de ver (singularité) mystérieusement apparu près de Saturne il y a quelques années. De l’autre côté de la singularité, les scientifiques espèrent découvrir d’autres planètes habitables.

ERREURS EN CHAÎNE
Force est de constater que si le scénario n’a rien de bien original pour un lecteur un tant soit peu versé dans la science-fiction, il a le mérite de ne pas avoir été véritablement abordé au cinéma, tout du moins pas de cette manière. Pourtant le film se heurte rapidement à plusieurs écueils. La plus grande erreur de Nolan, à mon sens, est de ne pas avoir su choisir entre réalisme et sense of wonder. A vouloir faire un film à l’approche documentaire dans la manipulation des concepts scientifiques, mais dont la finalité relève du merveilleux, Nolan s’est mis en porte à faux vis-à-vis du spectateur. Ce dernier hésite sans cesse entre la volonté d’adhérer au film en se laissant transporter par cette incroyable épopée et le brusque retour au principe de réalité sans cesse mis en avant par le réalisateur lorsqu’il essaie de coller au plus près de la science. Pouvait-on concilier approche documentaire et sense of wonder, probablement pas car l’adhésion du spectateur au mode de discours que propose la science-fiction nécessite la suspension de l’incrédulité sur toute la durée du film. Un principe que Nolan, involontairement sans doute, broie à de multiples reprises. Prenons un exemple simple, nul ne s’inquiète dans Star Wars du mode de propulsion du Faucon Millenium, pour la bonne raison qu’à aucun moment George Lucas ne s’intéresse véritablement à cette question, le spectateur part donc du principe que dans le monde où se déroule l’histoire, le voyage spatial au-delà de la vitesse de la lumière est possible grâce à une technologie dont au fond on ne veut rien savoir (et pour cause, ce flou est bien pratique pour maintenir cette fameuse suspension de l’incrédulité). Cet exemple simple peut être reproduit dans de nombreux domaines de la science-fiction et ce que Nolan a probablement oublié, c’est qu’être crédible ne signifie pas forcément être réaliste. En essayant de coller au plus près de la science le réalisateur a pris le risque de prêter le flanc à la critique, de la part des spécialistes ou des amateurs éclairés les plus virulents, qui cherchent la petite bête et prennent un malin plaisir à relever les erreurs ou les incohérences du film. Ceux-là mêmes que le sabre laser ou la propulsion hyperluminique ne dérangent pas le moins du monde dans un film de SF tendance pulp, mais qui se demandent bien comment un vaisseau spatial, qui a besoin d’un étage d’appoint pour quitter la Terre, peut ensuite s’envoler de la planète océanique (dont la gravité est égale à 130% de celle de la Terre) par ses propres moyens. Sans compter qu’on ne peut qu’être intrigué par le système de propulsion du drone indien capturé par Cooper ; des batteries capables de tenir plus de dix ans couplées à un système de propulsion à réaction, on demande à voir les schémas techniques. En plus d’être révolutionnaire, et facile à stocker, cette source d’énergie quasiment inépuisable devrait intéresser nos amis de chez Total ou Areva. Autre erreur inexplicable, cette même planète est traversée par des vagues gigantesques alors que le fond semble n’être qu’à quelques centimètre de la surface (40 cm à tout casser puisque les astronautes n’ont de l’eau que jusqu’aux genoux), une configuration tout simplement irréaliste sur le plan mécanique. La planète de glace n’est d’ailleurs pas plus réaliste, là aussi il s’agit d’un simple problème de mécanique, même gelé, un nuage est bien incapable de soutenir les contraintes imposées par l’installation des astronautes. Faut-il continuer la liste des erreurs (on a déjà parlé de la modélisation discutable du trou noir, mais la présence même de planètes habitables à proximité d’un trou noir massif est hautement improbable), c’est sans doute inutile et à la limite, tout ceci serait sans objet, si Nolan n’essayait pas constamment de nous rappeler que son film est scientifiquement réaliste et les écrivains de science-fiction savent pertinemment que la suspension de l’incrédulité est le fondement même de leur fond de commerce et qu’une toute petite erreur d’appréciation peut ruiner littéralement une histoire, aussi bien menée soit-elle.
Faut-il pour autant vouer Interstellar aux gémonies sous prétexte qu’il est scientifiquement bancal (sur des points de détail quant au scénario, reconnaissons-le), à la limite on pourrait lui pardonner de l’être s’il traitait correctement son sujet. Oui, mais voilà, au lieu de la grande épopée que le spectateur était en droit d’attendre, Christopher Nolan choisit de recentrer son film sur l’individu et l’intime, au détriment de la dimension sociétale et humaine du récit. En réalité le réalisateur tourne sans cesse autour du pot et évite ce qui aurait dû être le véritable propos du film, à savoir la responsabilité de l’humanité dans ce qui arrive à la planète. C’est d’autant plus dommage que la première partie du film est absolument remarquable sur ce point. Sans être trop didactique, il pose un cadre et esquisse la situation de la Terre, planète épuisée dont le climat est définitivement perturbé et de plus en plus impropre à assurer la survie de l’humanité. Nolan évoque-t-il réellement la responsabilité de l’espèce humaine dans ce désastre écologique ? Pas vraiment, le réalisateur fait au contraire preuve d’une sorte d’optimisme béat, refusant l’idée même de sacrifice (alors même que la solution de l’arche génétique semblait la plus viable), attaché définitivement à l’idée que l’humanité doit intégralement être sauvée et essaimer librement sur une autre planète, au risque de recommencer probablement les mêmes erreurs. Entendons-nous bien, il ne s’agit pas ici d’affirmer que l’humanité mérite un quelconque châtiment divin en agonisant sur une planète désormais devenue inhospitalière, mais de s’interroger sur l’absence totale de réflexion politique et de remise en question sur l’avenir de l’humanité. Il est d’ailleurs tout à fait symptomatique de constater l’inexistence de gouvernance tout au long du film, il n’y a pas l’ombre d’un dirigeant, d’un leader ou même du moindre chef. On peut s’en réjouir, mais pas forcément trouver cela crédible. Il y avait pourtant dans cette piste scénaristique une tragédie sans commune mesure avec ce mélo centré autour de la relation père/fille, qui certes pourrait être émouvant s’il n’était pas aussi décalé face aux enjeux mis en évidence au début du film. C’est un peu comme si Nolan avait traité la question par la périphérie, sans jamais entrer au cœur du problème. Cette relation père/fille prend tellement d’espace qu’elle empêche les autres personnages d’exister, le fils de Cooper n’a ainsi guère plus de substance qu’un fantôme, et le reproche peut être étendu à la majorité des personnages secondaires (mention spéciale pour les coéquipiers de Cooper pendant la mission, quasiment inexistants).
Ni sur le fond ni sur la forme Interstellar ne réussit réellement à convaincre, le film est bourré de bonnes idées, parfois superbement exploitées (notamment tout ce qui à trait aux principes de la relativité générale et en particulier au paradoxe des jumeaux de Langevin, excellent ressort dramatique s’il en est), mais globalement gâchées par une approche très hollywoodienne (et américano-centrée) du cinéma, glorifiant le héros valeureux et courageux (interprété par Matthew McConaughey), soulignant les émotions à outrance par une musique envahissante et bien trop appuyée. Prévisible à loisir, truffé d’artifices scénaristiques et soutenu par un faux suspens, Interstellar souffre de longueurs incroyables, à peine ponctuées de fulgurances hélas bien trop rares. Reste heureusement la beauté des images et des effets spéciaux, parce que n’en déplaise aux contempteurs les plus virulents, l’espace c’est fichtrement beau.
