« C’est un val maudit », m’a annoncé sans ambages la vieille dame au dépanneur du rang Jaune.
Elle n’a rien à m’apprendre sur les superstitions et le folklore du terroir : je suis né et j’ai grandi dans ce pays avant de m’expatrier. Et j’y reviens en ce tard octobre, comme un saumon remonte à l’endroit de son fraie pour y mourir.
Je connaissais déjà ce chalet agrippé à une colline glaiseuse de la Louve. J’ai travaillé à l’agrandir à la fin de mon adolescence – le père d’un de mes amis l’avait acheté. Une cambuse à l’époque, bâtie pièce sur pièce – probablement construite comme abri temporaire au temps où la Hudson Bay défendait de labourer et de semer. Nous y avons ajouté une aile pour y découper deux chambres. Une construction simple, mais robuste.
L’endroit avait mauvaise réputation. Le cultivateur qui avait vendu le lopin de terre répétait : « Je suis bien content de m’en débarrasser. Je n’y aurais jamais labouré après la brunante… » Le Village volant, ce village maudit et béni à la fois, s’y serait arrêté plus souvent que partout ailleurs. Les premiers coureurs des bois, ceux de la traite des fourrures, n’auraient jamais pagayé de nuit sur cette section de la Louve, pourtant paisible. Ce sont du moins les histoires qu’on se racontait l’hiver, au fond des rangs perdus, autour des poêles qui ronronnaient.
Le père de Roland ne s’intéressait pas à toutes ces légendes. Il était entrepreneur en construction et patroneux duplessiste – ce qui ne l’inclinait pas à porter foi aux histoires de bonne femme. Il voulait un coin bien à lui, le long de cette rivière tranquille, pour y boire et y jouer aux cartes avec ses copains ; y taquiner la ouananiche et le doré ; et y ancrer en toute sécurité le premier Chris-craft de la région. Il allait y mourir, toutefois. Du cœur. Un matin d’août, on allait le retrouver raide dans son lit. Mais il faut bien mourir quelque part, le long de la Louve, à Québec ou à Tombouctou. Ça ne signifie rien.
Sur la tablette, près de la porte, les fioles plastifiées des médicaments multicolores montent la garde.
« C’est quoi que t’as au juste ? » m’a demandé Simon Courchesne. Il est aujourd’hui un des rares taxis de Saint-Euxème. Nous ne nous sommes pas vus depuis un siècle. Mais, jeunots, nous avons couru les champs et les boisés ensemble. Je ne lui ai pas répondu. Le mal reste le mal. Les malheurs inéluctables portent mille masques, ont mille visages. À quoi servent les mots longs comme le bras ?
Tout de même, j’espère qu’il reviendra pour une petite jase de temps à autre. (En fait, nous avons jasé amicalement, à ce qu’il me semble, mais c’est curieux : après avoir traversé le pont de la Louve, je ne me souviens plus de rien. Mon dernier souvenir, c’est la propriétaire du dépanneur qui me prévenait contre cet endroit.)
Seize heures. La nuit accourt des montagnes. La Louve coule, lente, vers la Calouna. Pas très large, cette rivière. Une dizaine de mètres. Mais assez profonde. Et giboyeuse. Des calibres douze éclatent et tonnent à intervalles irréguliers. Deux garrots à l’œil or strient la surface mate de sillons triangulaires. Dans la boue du rivage, un chevalier solitaire patauge et fouille la vase de son long bec. Un bihoreau violet passe, pattes jaunes et inutiles à la traîne sous son corps trapu.
Un vent léger, un suroît. Les saules de la rive d’en face balaient l’eau des quelques feuilles racornies que leurs branches portent encore. Les vaguelettes clapotent contre les madriers du ponton. Puis le vent cesse.
La nuit étend son règne.
À peine si je distingue les écores de l’autre rive. Un colvert cancane, mais n’obtient aucune réponse. Un renard glapit dans les collines, vers l’arrière. Tous ont un rôle. Le mien s’achève. Terminer dans la dignité de ce qui vit et remercie de vivre en défendant sa vie à griffes et à crocs. Malheur à moi, mon ennemi est de l’intérieur. Garder tête haute. Le sort ne me verra pas baisser menton.
Relire Faire un feu de Jack London. Faire un feu pour tantôt me nourrir, bien sûr. Pour combattre l’humidité et le froid aussi. Et, surtout, pour me rassurer, entendre le crépitement de ses langues rouges et dansantes ; pour que les carreaux se couvrent de buée contre la nuit et que ma peau redevienne moite d’un juillet qu’auront conservé les bonnes bûches de résineux et de feuillus.
L’obscurité me force à la recréation. Yeux rivés à la fenêtre, je ne peux me détacher de ce paysage qui n’existe plus que pour la mémoire et par l’imaginaire. Des aires nouvelles et vierges s’ouvrent dans la nuit brune, des nœuds de l’espace et du temps qui se superposeront à ce qu’embrassera mon regard aux aurores – plus réels peut-être que cette rivière et ces arbres que redessinera mon regard au matin.
Un hors-bord. Des chasseurs. Un bruit strident dans la nuit. Le silence, on peut le déchirer parce qu’il existe : il possède une texture, une densité… Et une couleur. Au fond de ce val, il bruit, et ses couleurs varient du mat au moiré qui chatoie. Il est plein, comme l’obscurité est pleine.
Je me verse un whisky et songe à sortir mon PC portable pour y trahir ces réflexions en notes à utiliser. Mais quand ? Pour quel ouvrage ? Il n’y en aura pas d’autres.
J’ai faim.
Je sors démarrer la génératrice. Elle ronronne comme Mog. Ce matou paillard et bagarreur que j’ai, à regret, abandonné en ville. Un hibou ulule, des ailes duveteuses chuchotent et frôlent le toit que recouvrent les mousses.
Les fèves chauffent sur le rond.
Le courant de la génératrice ne convient pas à mon ordinateur. J’écrirai jusqu’à ce que mes piles se vident de leur énergie. Par la suite, revenir au stylo ? Pourquoi pas ? L’odeur du papier et la musique de la pointe qui gratte les grains et les sens me manquent.
Et on gratte à ma porte. Je n’ai pas de chien pourtant. Des branches contre la toiture peut-être ? Le vent chasse les nuages devant une lune qui révèle l’argent de la Louve. La rivière se faufile dans l’ombre.
On gratte à nouveau. On s’appuie et on geint.

— D’où vous venez ?
Elle cherche, semble faire un effort pour se rappeler.
— Ne vous fatiguez pas. Vous me répondrez quand vous vous sentirez mieux.
— Je viens de l’autre côté, murmure-t-elle. De l’autre rive.
Puis elle se crispe, affolée :
— C’est quoi, mon nom ?
Sans me laisser le temps de répondre, elle reprend :
— Il y a eu comme une explosion, une chute dans la nuit. Des cris, l’obscurité, l’impression de flotter. Je me suis retrouvée marchant à travers un marécage. Tout autour, des milliers d’oiseaux. Je ne les voyais pas, mais je les entendais. Je suis arrivée à cette rivière et j’ai vu votre cheminée qui fumait. J’ai traversé.
— Vous avez traversé à la nage ? L’eau est plutôt froide en octobre.
— Je n’ai rien senti.
— Il faut vous conduire à l’urgence. Moi, je n’ai pas d’auto. Le cultivateur qui me loue ce chalet habite à moins d’un kilomètre. Je vais m’y rendre et revenir vous chercher.
— Inutile. Je n’ai besoin d’aucun soin. Croyez-moi. Ne me laissez pas seule. Si vous saviez…
— Si je savais quoi ?
— Si seulement je me souvenais de mon nom, on pourrait parler. Vous comprenez ? Mais je ne me souviens même pas de mon nom.
Elle ferme les yeux. Ses propos sont décousus, mais si elle s’est égarée, si elle a paniqué jusqu’à traverser ce cours d’eau à la nage, on peut le comprendre. Son pouls pulse à quatre-vingt-quatre ; pas si mal. Aucune plaie ni fracture apparentes. Aussi bien la laisser dormir.
Et si jamais elle succombait subitement ? Non-assistance à personne en danger ! Une poursuite au criminel – et peut-être au civil en plus. Dans ma situation, quelle importance ?
Elle repose. Son souffle est régulier. Dans son poing gauche, un ruban mauve. Un autre enserre ses cheveux.
J’attiserai le feu et dormirai sur le vieux sofa. Au matin, on avisera.
***
Au matin, elle a disparu : elle n’est plus là. Un ruban mauve traîne sur le plancher. De la boue et des herbes séchées maculent le lit, mais elle n’est plus là.
Je fourre le ruban dans ma poche et je décide de descendre en ville. La météo est magnifique et, par mes raccourcis d’enfance à travers bois, à peine trois kilomètres de marche.
J’aime l’automne, sa nostalgie, ses soirs hâtifs et cette odeur des sous-bois où s’épanouissent les champignons – ces parfums terreux et musqués que certains vins portugais réussissent à rendre si bien.
Il est encore tôt. La rue principale est à peu près déserte.
Je passe devant le salon funéraire de Pierre Lalier. Par la porte ouverte, je l’aperçois. En compagnie de son épouse Charlène, il époussette les nombreuses babioles rattachées à la mort. Nous nous connaissons depuis l’école primaire. Je décide d’entrer et de discuter avec lui de mes derniers arrangements. En m’apercevant, il tombe à la renverse, en convulsions. Charlène reste figée, balai en main. Dans ses yeux, je peux lire la plus réelle des épouvantes. La maladie ne m’a tout de même pas changé à ce point !
— T’es en bas. T’es dans le frigo, mon vieux. Dans le tiroir ! Tu ne peux pas être ici ! balbutie Lalier en se relevant.
Il souffle péniblement.
— T’es-tu soûlé cette nuit, Pierre ?
— T’es mort, reprend Charlène d’une voix qui tremblote. Je t’ai fermé les yeux moi-même quand ils t’ont amené ici.
— Non, mais vous me connaissez ! Vous riez de moi ? Êtes-vous fous ? Ou voulez-vous me rendre fou ?
— Ils t’ont ramené hier soir. Ils t’ont sorti de l’eau. Le taxi de Simon Courchesne a sauté le parapet du pont. Vous vous êtes noyés, tous les deux, dans la Louve. Vous êtes tous les deux en bas, insiste Charlène.
— C’est quoi qu’on t’a fait pour que tu reviennes nous hanter ? On a toujours été corrects avec toi, continue-t-elle.
Lalier scrute la rue principale. Les commerces ouvrent. Des passants commencent à circuler. Lalier va sortir et se mettre à raconter ses inepties à la ronde. Il va se mettre à crier, à demander de l’aide.
Je me glisse entre la porte et lui. Les Lalier sont encore plus blêmes – si la chose est possible.
Charlène, qui a lu des ouvrages sur l’après-vie et les hantises, a un éclair de génie.
— Il ne sait pas qu’il est mort ! Faut lui expliquer, faut lui prouver.
Suis-moi, m’ordonne-t-elle. Suis-moi, mais reste loin derrière ! Approche-moi pas !
Et elle s’engage dans l’escalier qui mène au sous-sol.
Du haut des marches, Pierre nous observe courageusement.
Elle tire un premier tiroir et soulève le drap blanc : Simon Courchesne repose sur le dos, nu comme un ver.
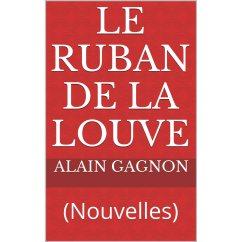
— Tu le reconnais ? me demande-t-elle.
— Évidemment. Un peu bouffi, mais c’est bien lui.
Elle tire un second tiroir et soulève le suaire tout en me regardant.
C’est à mon tour de défaillir : la fille sans nom y repose. Et, dans sa main gauche, un ruban mauve, identique à celui que j’ai fourré dans ma poche en quittant le chalet.
Pendant que les Lalier hurlent de terreur, je m’enfuis vers les bois et les champs.
Depuis ce jour je me promène, terrorisé et sans âme…
(PS : On peut se procurer le recueil contenant cette nouvelle et plusieurs autres à cette adresse : http://www.amazon.ca/ruban-Louve-Nouvelles-French-ebook/dp/B00JNSNTN0/ref=sr_1_3?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1416412789&sr=1-3&keywords=alain+gagnon)
L’auteur…
Auteur prolifique, Alain Gagnon a remporté à deux reprises le Prix fiction roman du Salon

