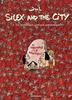Parfois, la rencontre entre deux univers particuliers sonne comme une évidence. C’est le cas avec Carole Martinez et Maud Begon. Lorsque la seconde, dessinatrice, s’est plongée dans les lignes de la première, romancière multi-récompensée, auteur notamment de Du domaine des Murmures (publié aux éditions Gallimard, prix Goncourt des lycéens en 2011), elle n’a alors eu qu’une seule envie en tête : pouvoir mettre en images la fertilité de ses mondes sensibles et en couleurs la richesse des voix féminines et puissantes qui les traversent. Très vite, entre elles, un dialogue dense s’installe, fait d’échanges vifs autour de la littérature et de la peinture, du spiritisme et de la filiation, chacune nourrissant et s’inspirant des mots et des lumières de l’autre et puisant à sa façon la matière qui allait former leur projet commun : Bouche d’ombre, premier tome d’une tétralogie (éditions Casterman) au titre inspiré d’un poème de Victor Hugo.
Lou, jeune fille à la chevelure flamboyante et aux yeux félins, remplit ses journées entre cours au lycée, footing en bord de Seine, petites fêtes entre amis et visites de ses aînées en banlieue parisienne. La nuit, son univers se transforme en conte dans lequel le petit chaperon rouge qu’elle devient s’ébat dans un décor médiéval, sous une bande-son tonitruante qui passe en boucle « Je rêvais d’un autre monde » de Téléphone. Premier décalage, qui en amènera d’autres, lorsque son groupe d’amis se mettra à organiser des séances de spiritisme qui conduiront au suicide de l’une d’entre eux. Différents univers se superposent alors, et depuis le récit fantastique de Carole Martinez, passant d’un siècle à un autre, d’un lieu à un autre, Maud Begon démultiplie les issues et chemins de traverse, dans des teintes tantôt embrasées, tantôt obscures.
Main dans la main, elles reviennent sur la genèse d’un album à la fois singulier et merveilleusement déroutant, qui n’a pas fini d’interroger et de jouer avec les frontières.
Carole Martinez, à vos ouvertures de rideaux, il y a des motifs récurrents : des voix (murmures, cris, paroles de chansons), des astres (lune ou soleil), des indices de drames (des corps souffrants, de femmes ou d’animaux), et ce nom qui suggère l’ouvert : Lou/e (un prénom dans Bouche d’ombre, une rivière dans Du domaine des Murmures). Vos incipits ressemblent à de véritables mises en scène, des décors clos et cohérents qui se font écho.
Carole Martinez : C’est incroyable, car pour vous dire la vérité, je n’ai en fait jamais fait le rapprochement entre la Loue, cette rivière de mon roman, et le prénom Lou du personnage de Bouche d’Ombre ! C’est absolument inconscient… C’est l’une des raisons pour lesquelles le regard de tout lecteur est si important, car il sait parfois aller là où l’auteur ne songeait même pas à aller, et c’est très enrichissant, d’un côté comme de l’autre ! Alors oui, évidemment, maintenant que vous le dites, il y a une relation entre le personnage et cette rivière qui, dans mon univers, est un élément féminin, avec ce e final… D’ailleurs, je n’en sortirai pas avant longtemps, car dans mon prochain roman, il sera une nouvelle fois question de la Loue. Je souhaitais écrire une histoire romancée de femmes au bord de la rivière, et là, c’est comme si, avec Lou, j’avais tiré mon personnage féminin de cette rivière, de mon univers. Cette idée de prologue, lorsque vous notez que tous mes prologues se ressemblent, est également inconsciente, mais elle est vraie ! Je réfléchis de cette façon pour mes romans, avec ce besoin d’installer tout de suite les choses, décors et personnages. Dans la bande dessinée, cela m’a été plus compliqué, n’étant pas du tout familière de ce travail particulier à la base. Le travail du prologue peut-il fonctionner de la même façon en bande dessinée et dans des romans ? Apparemment oui, mais je le répète, la démarche n’a pas été consciente. Je souhaitais en fait, à travers Bouche d’ombre, aller sur un terrain inconnu, m’éloigner pour un temps du roman, car je suis très lente lorsque j’écris et il faut savoir que l’écriture d’un roman me demande énormément de temps – cinq ans, voire parfois jusqu’à quatorze ans ! Là, pour un album, la vision et l’appréhension du temps ne sont forcément pas les mêmes, elles sont réduites puisque nous sommes deux à réaliser le projet et je pouvais donc me laisser aller à inventer des histoires très rapidement et à proposer des scénarii, le dessin suivrait, l’écriture et le dessin s’enrichiraient l’une l’autre ! La bande dessinée apparaît pour moi une très belle façon de faire des histoires autrement ! Je n’ai donc pas volontairement cherché à « adapter » ce que je sais déjà faire en romans en bande dessinée ; je voulais m’en détacher… mais pourtant, comme vous le voyez, il n’y a rien à faire, et je reviens toujours à mes thèmes personnels, ces motifs qui me sont chers ! Tout circule, comme une rivière, en fait ! Dans mes romans, je m’éloigne énormément de l’autofiction, ou tout du moins, j’essaie. Je parle de moi, mais avec de la distance. Dans la bande dessinée, il y a d’emblée ce filtre de l’image : le dessin de l’autre. Je peux donc me permettre de mettre plus de « moi », a contrario, et de raconter des éléments de ma propre vie. Une autre personne, Maud, qui dessine remarquablement, va mettre en formes et en images des personnages que je connais mais que je ne reconnais pas – et cette nouvelle mise à distance est intéressante, car elle m’a permis de disséminer dans l’album beaucoup de personnes de mon entourage. Il y a beaucoup de mon adolescence, par exemple, dans Bouche d’ombre : les footings avant les cours, la chambre de bonne de Lou, pas si éloignée de celle que je possédais moi-même, et ma grande tante qui tirait elle aussi les cartes… De même, Marie-Rose, la jeune fille haïtienne qui va vivre un drame, m’a été inspirée par une élève que j’avais lorsque j’étais professeur. Elle avait une sœur et toutes deux n’avaient que deux mois d’écart ! Cela m’intriguait énormément, à tel point que j’avais mené ma petite enquête et j’étais directement allée demander au papa de ces deux adolescentes qui m’avait un peu raconté leur histoire… Je suis sans doute un peu trop curieuse ! Mais tout ceci nourrit forcément mon imagination.
Vous jouez sans cesse avec l’ouvert et le fermé. Dans Bouche d’ombre, on peut compter autant de cercles qui suggèrent l’infini (la table ronde, le pendule de l’hypnotiseur, l’œuf volé par Boule…) que de carrés ou de quadrillages qui indiquent un cloisonnement (la chambre de Lou, les dalles au sol, les regards qui s’obstruent, le cercueil, le mur taggué…). Finalement, cet album permet-il d’actualiser ce que vous dites dans Du domaine des Murmures, dans lequel Esclarmonde parle de sa volonté d’« observer son temps à travers un judas » ?
CM : Cette cohérence m’étonne moi-même… Comme je le disais, cet album m’est très personnel : il respecte et met en scène, d’une certaine façon, « mon » temps et « mon » adolescence. Il se trouve que j’aime donner cette impression que le merveilleux et la magie peuvent naître d’un espace complètement clos et cloisonné. Ici, c’est le cas, notamment à travers ces deux petites vieilles de la famille de Lou, qui sont prostrées dans leur cuisine et qui engendrent quelque chose de magique. Ou encore à travers le chat, qui va prendre une importance colossale dans la suite de la série. Ce chat, tout petit et tout mignon, n’est bien sûr pas un simple observateur : il est un gardien, qui, seul, peut passer de case en case. On peut même aller jusqu’à dire qu’il est le maître du jeu ! On ne sait pas vraiment à quel monde il appartient, et les personnages eux-mêmes viendront à interroger cela ; il est mystérieux. Est-il dans le monde des vivants, ou plutôt dans celui des morts ? Il est en fait le seul petit être à pouvoir être totalement libre, là où tous les autres personnages sont enfermés.
Maud Begon, de fait, vos traits sont souvent très dynamiques et circulaires, voire tourbillonnants. Souvent, vos cases sont des fenêtres qui s’ouvrent ou miment la forme d’un judas : elles paraissent être de véritables passerelles, d’un temps à un autre, d’un lieu à un autre, d’un rêve ou de l’au-delà à une réalité. Pourriez-vous revenir sur cette narration de l’image si particulière ?
Maud Begon : Quand a commencé le travail sur l’album, tout de suite s’est présenté le problème des différentes temporalités, niveaux de réalité, posant la question toute ouverte : comment transcrire ces passages, d’un fil à l’autre, ces ouvertures indicibles ? C’est un thème sur lequel j’avais commencé à m’interroger pour l’album sur lequel j’avais travaillé juste avant, qui met en scène des phases où le héros s’échappe dans des faux souvenirs, rêves ou cauchemars (Je n’ai jamais connu la guerre, avec un scénario de Joseph Safieddine, aux éditions Casterman, 2013). J’avais alors mis l’accent sur des couleurs irréelles, presque acides parce que trop vives, et des décors à peine évoqués : l’individu projeté dans un univers fantasmé et créé de toute part. Il y avait une volonté d’aspect commercial dans ces couleurs trop vives, trop édulcorées : le faux souvenir était fait produit, commercialisé, livré au fantasmes et aux désirs de consommateurs. De ce fait, pour Bouche d’ombre, j’avais déjà une idée de ce sur quoi je voulais jouer, et ce que je voulais éviter : différences d’univers colorés, mais plus subtiles, et surtout, des contours de cases évoquant l’image mentale, qui apparaît, comme dans un rêve que l’on cherche à revivre, dans une sorte de vision limitée, floue à ses bords, centrée sur et définie par les détails dont on se rappellera.
Pendant la séance d’hypnose, Carole avait écrit son scénario aussi de façon différente, sans narration ; c’était une suite d’éléments apparaissant dans le blanc de la page, s’imposant à Lou, et au lecteur par le même coup. C’est ce que j’ai voulu retranscrire en image. Le vrai nœud a été le rêve ou le cauchemar du début : rendre le Moyen Âge réel, mais en intimant à la fois qu’il y a quelque chose de différent, que ce n’est peut être qu’une vision, déformée par l’esprit, afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté quand Lou se réveille. Le lien est fait entre les deux scènes par la chanson de Téléphone, mais il fallait quelque chose de plus dans le traitement pour lier la première à la deuxième, et inversement. Il fallait un contraste donneur de sens.
L’œuvre de Carole Martinez semble se structurer à la façon de cercles concentriques, des thèmes convoquant d’autres thèmes, les temps se superposant. Maud Begon, au tout début du travail sur Bouche d’ombre, il vous a donc fallu entrer dans ces cercles. Pourrions-nous dire qu’au fur et à mesure, les cercles de l’une se sont greffés, ou plutôt, ont nourri les cercles de l’autre ? Sur quels détails vous êtes-vous toutes les deux influencées plus particulièrement ?
MB : Forcément… Je ne saurais pas dire avec précision, mais je sais que travailler avec Carole a fait énormément évoluer mon dessin, l’importance prise par les décors, les ambiances. M’éloigner un peu d’un focus sur le personnage héros pour donner au lecteur à découvrir autant sa place dans le groupe, dans son monde, que lui même. Ce fut un gros changement pour moi, son regard. Et forcément, j’imagine que le fait de travailler avec moi plutôt qu’une autre, ma sensibilité et ma façon de donner à sentir les personnages, influence un peu Carole dans son écriture ; par exemple, mes premiers dessins du psy de Lou, que j’avais lus entre les lignes, comme une indécision entre bienveillance et menace, ont donné une dimension supplémentaire à son personnage. Carole les écrit, les décrit, et je les interprète. Ainsi, c’est un travail double, impliquant que ce que j’interprète et qui plaît à Carole amène des caractéristiques et possibilités nouvelles à l’univers de l’album. C’est une création à quatre mains !
Carole Martinez, la frontière entre la vie et la mort est toujours très fine dans votre œuvre qui accumule les stigmates et les fantômes, la présence et l’absence. De nombreux personnages de Bouche d’ombre, comme dans le poème de Victor Hugo, « vivent », « mais comment ? » (Lou, Marie-Rose qui la hante, la famille de Céline). Sont-ils des « ombres qui causent » ?
CM : En fait, on pourrait peut-être formuler cette question ainsi : tous ces personnages m’habitent-ils vraiment ? Je le crois, oui ! Je dis souvent que les personnages, de mes romans, et maintenant de mes albums, sont pour moi des « occupants ». Lorsque j’étais enseignante, déjà, je considérais mes élèves comme des « occupants », et un jour, il a fallu faire un choix car, de façon très imagée mais concrète, je n’avais tout simplement plus la place d’accueillir à la fois mes élèves et mes personnages ! J’ai donc cessé d’enseigner et me suis consacrée à l’écriture. Mais j’ai globalement beaucoup de mal à me défaire de tous ces êtres qui ont à la fois une part d’imaginaire et une part de réel. Même lorsque je fais mourir mes personnages dans mes romans – ce qui me demande énormément d’effort, car ce n’est vraiment pas évident ! –, ils continuent à vivre en moi durant très longtemps, je ne m’en détache pas facilement. Je me souviens que pour le personnage féminin de mon tout premier roman, cela a été terrible de m’en débarrasser ! En fait, au moment de m’en éloigner, au bout de treize ans, c’est comme si je n’arrivais plus à écrire. Certains personnages naissent de contes et restent donc, dans les textes, dans la conscience et dans l’imaginaire.
Vos jeunes femmes sont un peu toutes des Ophélie, à leur façon !
CM : Oui, un peu ! Elles sont à fleur d’eau, à la limite de se noyer, dans la nature… Tout coule… Et à en croire les critiques, elles sont aussi toutes étouffées et asphyxiées ! Mais cela ne me paraît pas si juste, car toutes sont au centre, et elles sont même le cœur d’une écriture. Or, l’écriture, c’est le souffle ! C’est la raison pour laquelle j’aime particulièrement l’idée de série, car je vais justement pouvoir faire respirer mes personnages durant longtemps, et le plus longtemps possible. J’aime aussi par dessus tout ce moment où j’atteins le point où je crois qu’ils sont parfaitement façonnés et construits dans ma tête, et, d’un coup, évidemment, ce que je leur prévoyais, parfois depuis très longtemps, ne fonctionne alors plus ! Ils s’échappent eux-mêmes, seuls ! Ils prennent leur liberté, empruntent des chemins qui sont devenus plus logiques. Les personnages ne sont en réalité jamais enfermés, et surtout pas dans la tête de leur créateur : ils sont de véritables petits organismes qui évoluent à leur façon. L’auteur ne fait donc pas toujours ce qu’il veut !
Maud Begon, comment mettre au mieux en images cet univers purement synesthésique, qui fait appel à tous les sens ? Très souvent, vos couleurs s’étalent et vos traits se déforment, les yeux s’étirent aussi et sont presque expressionnistes. Vous dites apprécier Van Dongen, vos planches paraissent en effet, dans leur luminosité, parfois très « fauves » !
MB : Je cherche toujours, au delà d’un réalisme, à faire ressentir par le dessin, les couleurs, les émotions de nos personnages. L’effroi de Marie-Rose, le choc de Lou, l’amour de Nassim… À défaut d’avoir l’intonation, la grosseur et la profondeur d’une voix comme au théâtre, au dessin, on a la palette des proportions d’un visage, des harmonies ou disharmonies de couleurs. Une ambiance glauque, une lumière blanche, froide violette ou rouge brûlée, la fièvre.
Pour le fauvisme, je ne peux pas accepter le rapprochement car mes couleurs sont bien trop bridées, ce qui reste pour moi un point sur lequel je veux encore chercher et évoluer. Je suis amoureuse des fauves, des yeux et des palettes de Van Dongen, de la musique et des collages de Matisse, de toute cette liberté, de leur jungle de couleurs. Ce n’est pas un amour que j’arrive pour l’instant à concilier avec mon dessin, même si je m’y essaye.
Les références à l’art sont d’ailleurs très nombreuses : explicites, comme ce décalage initial univers médiéval / chanson de Jean-Louis Aubert, comme les pièces manquantes d’un tableau / puzzle en train de se construire, ou comme ce portrait recomposé de moitié de Marie-Rose et Céline, ou plus implicites, un tableau de Man Ray à la dérobée. Pourriez-vous chacune nous dire quelques mots à ce sujet ?
CM : Le principe, lorsque nous avons commencé à parler du projet, était que chaque album puisse nous conduire dans un siècle, ou tout du moins dans une période bien précise. J’avais donc très envie que le dessin soit inspiré par le siècle en question. Pour le prochain tome, tout se déroulera en 1900, et je souhaitais vraiment que Maud puisse être inspirée par l’art et jouer avec les références de ce siècle-là. Qu’elle puisse, à travers son dessin, me conduire et conduire le lecteur dans cette époque foisonnante, à travers tous ces courants artistiques, sur tout le XIXe et jusqu’au début du XXe siècle. Graphiquement, les quatre tomes ne se ressembleront donc pas et chacun aura droit à son univers artistique particulier. Et que Maud parvienne à mettre sa propre patte tout en inspirant d’époques différentes pour chaque album, ce qui est le cas, relève d’un véritable challenge ! Le monde des arts est donc en effet très important, d’autant que cet album a été directement inspiré par une exposition (« L’Europe des Esprits ou la fascination de l’occulte – 1750/1950 » qui s’est tenue au musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg d’octobre 2011 à février 2012, NDLR). Cette exposition expliquait notamment l’influence qu’a pu avoir l’occultisme sur les artistes, les écrivains, les scientifiques… ce qui abolit les frontières ! Il m’a paru évident que le monde artistique devait trouver une place de choix au cœur de l’album, et que celui-ci devait avancer par énigmes et par petits morceaux, comme des pièces d’un puzzle qui se recompose doucement. Ce qui importe, souvent, est ce qui manque, ce qui est lacunaire. Comme le beau en art, finalement, qui est un fragment en soi ! Depuis ce trou, tout peut se structurer, et l’œuvre d’art atteint le sublime car chacun peut alors remplir les manques et se faire sa propre construction. L’art doit proposer cela, ce dialogue infini.
MB : Dés le scénario, la volonté de Carole de raccrocher Lou et son univers à leur époque artistique, comme Louise au Moyen Âge avec le tableau de Grünewald, et toutes les suivantes avec leurs lots d’expositions universelles et d’écrivains maudits, était claire, limpide, avec ses références à la musique de Lou, à ce qu’elle affiche à son mur, à ses chaussures, à ses vêtements, et c’est une volonté à laquelle je me suis pliée et me plie encore avec plaisir.
C’est extrêmement important pour moi aussi. Je peux passer des heures à me plonger dans des époques qui ne sont pas les miennes, à travers le travail de photographes des années 1980, découvrir ces rues que je n’ai pas connues (je suis née en 1987), ces vêtements, ces femmes, ces hommes qui me fascinent, à travers des expos, comme Paris 1900 au Petit Palais dans laquelle nous sommes d’ailleurs allées flâner quelques heures avant de commencer le tome 2, sur Internet, perdues dans les reproductions impressionnistes de mes grands peintres adorés… tous reflets de leurs temps, facettes du prisme, je choisis celles qui me parlent et je me laisse influencer.
Carole Martinez, on a l’impression que les personnages de Bouche d’ombre font comme vous, à accumuler les sujets et les objets (les « crises » de collection d’un des parents, les vols de poèmes et autres objets, les cartes de tarot et les lettres de scrabble…). Peut-on dire que cela permet de sonder, de creuser ou de remplir une sorte de réservoir d’influences inépuisable ?
CM : Oui, c’est tout à fait possible ! J’ai moi-même grandi dans un tel univers, plein comme un œuf. Mon père a toujours été une sorte de ferrailleur magnifique dans un tout petit espace… Il passe son temps à accumuler choses et objets. Au milieu de tout cela, j’aurais très bien pu faire une overdose, mais non, il s’est passé tout l’inverse en réalité : tous ces tas ont fini par nourrir mon imaginaire. Mon univers a donc toujours été baroque, à la limite du trop-plein et de l’étouffement, mais c’est cela même qui permet de s’échapper. L’ouverture, pour moi, s’est ainsi faite par l’écriture, par l’imaginaire et par l’au-delà ; oui, il peut y avoir d’autres mondes… Et tout ce qui pourrait étouffer donne en fait du souffle, permet de créer, et libère.
Il apparaît que l’occultisme vous permette en fait de revenir sur un thème qui vous est cher : la filiation, éminemment féminine. Cette question sera-t-elle le cœur des prochains tomes de Bouche d’ombre ? Et en quoi le fait d’être deux femmes lancées dans cette aventure est-il, dans ce cas, intéressant ?
CM : Je ne suis pas certaine d’avoir vraiment voulu placer au centre de cet album la question du féminin. Ou en tout cas, pas dans ce premier tome, car elle sera bien présente dans les prochains, en revanche. Il s’agissait, avec Lou, de réaliser une sorte d’entrée en matière, en installant un décor, avec un peu d’occultisme et de magie, des fantômes de femmes. Dans le tome suivant, à travers une séance d’hypnose, nous serons plongés dans le siècle de Marie Curie. Il y aura également une présentation du préfet Camille Sée (qui a donné son nom au lycée dans lequel se déroulent certaines scènes de Bouche d’ombre, NDLR), peu célèbre, mais qui a pourtant été à l’origine d’une loi instituant les collèges et lycées pour les jeunes filles, à la fin du XIXe siècle. Le premier tome est donc plus un « sas », il ne traite pas directement de la question du féminin, mais permet d’introduire le thème, avant de le développer plus en détails par la suite.
MB : Bien sûr, ce sont des thèmes qui nous touchent en tant que femmes, mais faut-il être femme pour en être touchées, pour en parler ?
C’est sûr qu’entre nous, il y a une certaine sensibilité qui se retrouve. Quand j’étais adolescente, j’ai longtemps fantasmé les ancêtres du côté de ma mère, ces filles de vikings, ces Valkyries, et leur lignée. Cette féminité du sang, fascinante, me paraissait alors étrange, presque magique, puissante : la sorcière et sa puissance féminine, mystérieuse, menaçante mais complice, rêvée comme une réponse à un monde au masculin menaçant. Peut-être que si j’avais été garçon, je n’y aurais pas été si sensible, et je n’aurais pas autant retrouvé ces thèmes de mon imaginaire dans le travail de Carole ? Mais je ne suis pas sûre – peut être que je suis naïve, de me voir comme un individu, de faire comme si je pouvais nier l’influence de mon sexe sur ma façon de travailler, de dessiner. Je voudrais être ni homme ni femme, surtout pas dans la bande dessinée, ce monde dans lequel les femmes, pour se faire une place, doivent un jour ou l’autre agiter dans tous les sens l’étendard de leur féminin.
Propos recueillis par Cathia Engelbach