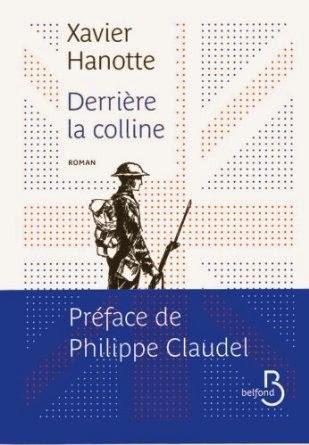 Auteur: Xavier Hanotte
Titre Original: Derrière la colline
Date de Parution : 23 janvier 2014
Éditeur : Belfond
Nombre de pages : 430
Prix :
Auteur: Xavier Hanotte
Titre Original: Derrière la colline
Date de Parution : 23 janvier 2014
Éditeur : Belfond
Nombre de pages : 430
Prix : Quatrième de couverture :Professeur, mariée, un enfant, la trentaine, Lise est admise dans une maison de repos, à Saint-Libron, dans le sud de la France. Elle souffre de dépression. Sur place, elle ne tarde pas à se lier d’amitié avec Oriane, nettement plus jeune, parisienne de bonne famille et qui souffre d’anorexie. Oriane a subi des violences sexuelles à l’adolescence. Dans le Grand Hôtel voisin où l’on soigne les accidentés de la route, Daisy, Américaine de la côte Est, se rétablit d’un grave accident de la route, sous le regard de Maxime, son élégant et mystérieux mari qui pousse avec amour son fauteuil roulant. Tout est étrange dans ce couple : l’accident a couté la vie à Gladys, la précédente épouse de Maxime, et Daisy, blessée mais vivante, a pris la place de la défunte... La rencontre des trois femmes convalescentes et du séduisant Maxime, surnommé par Oriane et Lise « l’homme en noir », réveille toutes sortes de fantasmes, d’angoisses, de souvenirs. Et la mort rôde tant dans les cauchemars que dans le quotidien sans relief de ces convalescentes que la cure emprisonne. Peut-on vivre, aimer dans cette bulle qu’est la convalescence ? Peut-on vraiment en sortir un jour ? Oriane, Lise, Daisy répondent chacune à leur manière à ces obsédantes questions.
Extrait Derrière la colline, mais tout à côté d'eux
Si la Première Guerre mondiale a fait les millions de morts que l'on sait, elle n'en continue pas moins d'enfanter, à la manière d'une inépuisable parturiente : s'interrogera-t-on un jour sur la quantité remarquable d'ouvrages, d'histoire et de fiction, que cette guerre continue aujourd'hui encore à faire naître ? Que les historiens s'emparent de l'événement, rien là de surprenant : c'est leur pain quotidien que de fouiller les faits, les dates et les enjeux du passé des hommes. Mais que, dans le champ artistique, les écrivains, et plus particulièrement les romanciers, reviennent avec une constance obstinée sur ces quatre années de massacre, voilà qui est plus curieux. Nous avons depuis longtemps passé la période du témoignage durant laquelle l'écrivain combattant, et survivant, fit de sa propre expérience la matière d'une oeuvre entière ou de certains de ses livres : c'est parmi cette vague originelle, on le sait, que l'on compte dans les lettres françaises des chefs-d'oeuvre signés Barbusse, Dorgelès, Genevoix, Giono ou Céline. Nul ne peut contester à ces auteurs une légitimité à transcrire, dans un cadre plus ou moins fictionnel, un quotidien effroyable qui a marqué, jusque parfois dans leur chair, ces hommes qui étaient alors dans la jeunesse du premier âge adulte. Leur génération a disparu depuis longtemps, la suivante est sur le point de le faire, et c'est donc de nos jours ceux qui pourraient être leurs petits-enfants, voire plus certainement leurs arrière-petits-enfants qui, dans la dimension romanesque, continuent à interroger la guerre de 14-18. Ne m'intéresse nullement le débat acrimonieux que certains ont voulu lancer il y a quelque temps, à propos d'une autre guerre, concernant qui avait ou non le droit de traiter en roman un fait historique auquel il n'avait pas été directement lié. Si la littérature s'encombrait d'attendre pour se faire le blanc-seing de vieilles badernes qui se drapent d'autorité morale, de gardiens des cendres autoproclamés, il y a beau jeu qu'elle n'existerait plus ou aurait perdu toute essence. Non, ce qui aiguillonne ma curiosité, c'est davantage l'étonnement de voir toujours vivant un vieil événement mort. De le palper chaque année dans une pleine cargaison de romans frais, comme on inspecte les caisses de bois d'une marée débarquée d'un chalutier. Savoir qu'une cohorte d'écrivains dont le lait goutte encore des oreilles se plaît à s'embourber dans les lointaines tranchées, à palper la neige et les brouillards, à sacrifier leur présent confortable de technologies high-tech, d'air conditionné et paix délicieuse au profit du spectre d'une guerre sale, puante, poisseuse, interminable, encombrée de cadavres sans tête, de boyaux et de mouches, d'ordres déments, de vinasse, de gros tabac gris et de graciles aéroplanes, ne cesse de me surprendre. Pourquoi donc ainsi, et toujours et toujours, délaisser l'aujourd'hui pour fouiller cet hier ?

