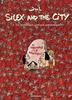Depuis une dizaine d’années, le dessinateur-reporter Aurel anime la presse locale et nationale, toutes périodicités confondues, et se plaît à donner du grain à moudre à ses lecteurs, tout en leur égayant l’esprit. Multicarte, celui qui promet que « ça ira mieux demain » car, après tout, « ça pourrait être pire », affûte son coup de crayon tant pour croquer les coulisses de l’Élysée qu’au service de sa passion pour la musique, jazz en particulier.
On le retrouve également une fois par an dans les pages du Monde diplomatique, pour lequel il cosigne, avec le journaliste Pierre Daum, un grand reportage. C’est dans la continuité de ce travail que s’inscrit son nouvel album, Clandestino, publié aux éditions Glénat. Il présente la « sortie de cocon » d’Hubert Paris, ancien secrétaire de rédaction, chargé par un magazine américain de la rédaction d’un grand papier sur les migrants clandestins dans le monde. Fiction basée sur des faits réels, l’album, qui suit le parcours du journaliste inexpérimenté, offre un témoignage et un regard à la fois sensibles et accablants sur les dessous de l’immigration clandestine.
La couverture de Clandestino présente des migrants, des harragas, sur une embarcation en pleine mer et un mur tagué (Los inmigrantes tambien son de la clase obrera - « les immigrants proviennent aussi de la classe ouvrière »). Pourriez-vous nous en dire plus sur ce choix qui oblige un double regard ?
On s’est beaucoup interrogé, l’éditeur et moi sur la couverture. On a beaucoup cherché, mais aucune image « seule » ne convenait. Je n’avais pas envie qu’Hubert Paris soit en couverture pour ne pas qu’il devienne le héros de l’album (il n’est que le passeur). Et, en même temps, c’était très dur de résumer l’album en une seule image. Nous avons donc opté pour ce principe de bandeaux avec deux images. Ces deux images résument à la fois les deux grands thèmes de l’album (l’immigration clandestine et la problématique sociale) mais elles représentent également deux parties non traitées dans l’album : la traversée en elle-même et la lutte sociale ou syndicale que je n’évoque qu’à peine. C’est une manière de résoudre les ellipses de l’album.
Votre envoyé spécial se nomme Hubert Paris… Un prénom et un nom qui semblent « passe-partout » et fortement inscrits dans un lieu, mais auxquels vous tenez semble-t-il énormément (vous avez récemment confié vous être battu pour les conserver auprès de votre éditeur). Faire d’Hubert Paris un grand reporter, est-ce une façon de rendre compte d’une « sortie des frontières » nécessaire ?
Oui, c’est un nom passe-partout, c’est vrai. Et ça va très bien au personnage. Au début du travail d’écriture, et afin de présenter le projet aux équipes de Glénat, j’ai écrit la biographie de tous mes personnages. Hubert Paris est clairement quelqu’un d’assez normal, voire banal. Il a toujours été couleur muraille ou dans l’ombre de quelqu’un. C’est sa nouvelle vie (rupture amoureuse et professionnelle) qui va le transformer et lui offrir une nouvelle liberté, un nouvel horizon. Le nom n’est pas trop glamour, c’est pourquoi, je pense, il ne séduisait pas plus que ça chez Glénat, mais j’y tenais car il y a une sorte de clé dans ce nom et prénom.
Vous dites également qu’il s’agit, à travers cet album, de « combattre un peu nos égoïsmes ». Pourriez-vous revenir sur cette motivation à l’origine de votre travail ?
« Combattre nos égoïsmes », c’est prendre un peu de recul sur ce que l’on fait au jour le jour, vous comme moi, nos lecteurs, sans trop y réfléchir. Parce que c’est plus simple, parce qu’on n’a pas le temps de réfléchir à comment faire autrement, parce qu’on a d’autres soucis. Il peut s’agir des modes de déplacements, de sa vie sociale, de la vie amoureuse, ou de son mode de consommation. Dans cet album, je m’adresse plutôt à ce dernier type d’égoïsme. On achète un peu n’importe quoi car on ne regarde que le prix. C’est une forme d’égoïsme car tout à un prix. Si quelque chose n’est pas cher, c’est que quelqu’un l’a payé à notre place : la pub, l’État (donc nous), des ouvriers de leur santé, de leur bas salaire, etc.
Cela peut paraitre futile ou inapproprié en période de crise, mais payer les choses à leur juste valeur est une question fondamentale selon moi. Une réelle question politique. Le fait de pousser à la consommation de tout et n’importe quoi et au prix le plus bas est à l’origine de bien des soucis (le début de la crise des supprimes c’est exactement ça, dans l’immobilier). Et c’est la clé de voute de la société d’hyper-consommation et libérale.
Entre les premières planches de Clandestino et sa parution effective, il s’est passé plus de quatre ans. L’idée de proposer un reportage graphique et narratif sur un tel sujet était-elle présente dès le début ?
Oui oui ! Il s’est passé quatre ans de travail de scénario, de mise en forme et de dessin. C’est long, mais je fais beaucoup de chose en plus de la BD… Ou même qui passent avant la BD. Je suis dessinateur de presse et j’ai fait trois autres BD entre temps !
Que pensez-vous de l’émergence de la « BD reportage », initiée par Cabu ou encore Teulé, et qui fait aujourd’hui les beaux jours de quelques titres de presse (avec des séries « feuilletons » publiées dans Le Monde diplomatique, Libération, la revue XXI…). Certains titres ou auteurs vous ont-ils influencé ? Pourquoi avoir fait le choix, en incluant une grande part fictionnelle dans Clandestino, de vous en tenir éloigné ?
Je n’aime pas du tout le terme « BD reportage ». C’est un label commercial sous lequel on met un peu tout et n’importe quoi. Plein de BD de très grande qualité sont présentées comme de la BD reportage mais ne sont pas du tout du reportage. Cabu n’a jamais fait de la BD reportage. Il fait du reportage dessiné. C’est un de mes modèles dans le genre, au même titre que Tignous, Luz ou bien évidemment Joe Sacco ou Chappatte. J’irai même plus loin en disant que je pense que la BD n’est absolument pas le bon format pour le reportage au sens journalistique du terme. J’y oppose le reportage graphique qui s’émancipe du carcan de la BD.
Le reportage est contradictoire au carcan de la narration graphique, du système de case, de la maquette « imposée », de l’ellipse. Une BD est aussi éloignée d’un reportage graphique qu’un essai ou un documentaire le sont d’un reportage écrit ou audiovisuel. Les exemples que vous citez (hormis Le Monde diplomatique pour lequel j’ai réalisé des reportages graphiques) publient des BD qui traitent de sujet d’actualité, mais ce ne sont pas des reportages, à mon sens. Des documentaires éventuellement. C’est une question de vocabulaire, je le concède, mais c’est important.
Si j’ai choisi de mon côté la fiction, c’est pour pouvoir mieux coller aux impératifs de la BD, d’une part, et pour éliminer tout égotisme ou questionnement narcissique d’autre part. Ce n’est pas ma petite vie de reporter que je veux raconter, c’est tout ce qui se passe autour. Mon vécu me permet juste d’insuffler à Hubert Paris quelques touches de vérité, de réalisme.
À ce propos, que pensez-vous de cette déclaration de Joe Sacco : « Un journaliste va écrire dans un article : Les rues de Gaza sont très boueuses. Mais combien de fois peut-il l’écrire ? Alors que moi, je peux les montrer en permanence à l’arrière-plan, et elles collent à l’esprit du lecteur comme elles ont collé à mes chaussures. »
Je n’ai rien à ajouter. Il a raison. Joe Sacco est la seule exception à mes yeux à ce que je disais précédemment concernant la BD et le reportage. Ceci étant, les BD de Joe Sacco sont souvent très bavardes, seul moyen d’apporter toutes les informations nécessaire à un bon reportage.
Revenons à Hubert Paris. Dès le début de l’album, il apparaît un peu gauche, tranquille dans ses montagnes cévenoles avec son bâton et son sac à dos, volontairement en marge de la société… Pourquoi cet incipit, qui fait directement suite à une scène de violence en Andalousie (que l’on retrouvera en fin d’album), impliquant d’emblée un net décalage ?
Cela permet de montrer qu’Hubert Paris a une vie. Qu’il n’apparaisse pas aux yeux des lecteurs juste comme un journaliste. Surtout qu’il n’en est pas vraiment un, comme il l’explique un peu plus loin dans l’album. Quant au décalage avec la scène précédente, c’est essentiellement dû à la volonté d’imposer un rythme et des actions parallèles.
En charge pour Struggle, un titre de presse américaine, de faire un sujet sur les migrants à travers le monde, Hubert Paris part rejoindre un ami, Paul, à Alger, et il compte sur lui pour le guider à faire ses « premiers pas de reporter ». Pourrait-on y voir un double de vous-même, vous confrontant à un autre genre à travers cet album et vous donnant ainsi une « chance de dessiner autre chose », pour reprendre l’une de vos expressions ?
Non. Hubert Paris, comme je le disais tout à l’heure, n’est pas un double. Il vit des choses que j’ai pu vivre moi-même, certes, mais aussi beaucoup de situations inventées. Le binôme Paul-Hubert m’a servi à raconter certaines scènes que j’ai moi-même vécu en binôme avec Pierre Daum du Monde diplomatique (par exemple avec le directeur de l’ANPE marocaine), mais les comparaisons s’arrêtent là.
Vous avez collecté beaucoup d’informations, menant vous-même enquête sur les rives méditerranéennes avec le journaliste Pierre Daum, que vous resituez sur vos planches. Comment s’est effectué le choix ?
C’est plutôt le contraire qui s’est passé. Le scénario s’est écrit autour des infos que je voulais donner. Il a fallu que j’en laisse quelques unes de côté, mais c’étaient des digressions sur des éléments que je donnais déjà. J’ai pu aborder pratiquement toutes les situations et les infos ou problématiques que je voulais aborder en fonctionnant de cette manière. C’est ce qui explique la longue maturation du scénario. C’est avant tout un ouvrage de « journaliste ». Le but est d’informer le lecteur, par un biais de fiction et « ludique ». Mais d’informer !
Clandestino alterne les scènes d’enquête à proprement parler (dans les bureaux de l’ANPE marocaine, ceux d’ONG, auprès des populations…) et les scènes du quotidien, où vous revenez à l’humour que nous vous connaissons. En quoi ces parenthèses sont-elles nécessaires au récit ?
C’est exactement ce que je disais à l’instant. C’est l’huile dans les rouages. C’est les entractes entre deux situations. Cela me sert pour faire le lien entre toutes les infos et les situations, à donner un fil conducteur, à rendre le tout un peu plus digeste et léger… Et vu qu’au quotidien, je me sers de l’humour pour donner mon avis sur un sujet, j’ai fait ce que savais faire. Tout ceci explique une fois de plus le choix de la fiction.
Du point de vue de la narration, les personnages sont sans cesse ballotés entre progression et stagnation (à l’image de l’enquête qui piétine, de ce qu’il convient de « ne pas dire aux journalistes » et de ce qu’il faut donc savoir lire entre les lignes, Hubert Paris progresse lentement, contraint de prendre le bateau ou le train car il a une peur panique de l’avion, ne trouvant pas de taxi, puis courant comme un dératé pour des rendez-vous au final manqués ! et il lui faut un certain temps avant de trouver la confiance des personnes qu’il rencontre pour pouvoir recueillir leur témoignage…). Que révèle ce rythme particulier ?
Le rythme du reportage !
On ne sait jamais à l’avance précisément ce que l’on va trouver. On peut cadrer au mieux à distance avant de partir, mais on doit aussi composer en permanence, une fois sur place, avec les contretemps, les attentes, les rencontres fortuites, les rencontres induites, le hasard… tout cela sans perdre de vue son projet et son sujet. C’est ça que j’ai tenté de reproduire.
Lors d’un rendez-vous avec l’un de ses amis algériens, Hubert Paris tient ce propos : « Je suis là pour rencontrer des harragas. Les chiffres et les argumentations, je laisse faire ça à ceux qui savent faire. » Et, de fait, Clandestino accueille derrière les pourcentages et les discours des dizaines de voix qui luttent et une galerie de « personnes » (Lamine, Djamila, Rachid et Magyd, Aïcha, Mustapha…) plutôt que de « personnages ». L’un d’eux dira d’ailleurs : « Accepter de parler pour laisser une trace. Un testament. Un témoignage. Quelque chose. » Et Hubert Paris, en Espagne : « Tomates, concombres, poivrons à Noël. C’est là. Sous ces milliers d’hectares. Ces dizaines de milliers d’hectares. Combien d’immigrés là-dedans ? Et de sans-papiers ? Combien de Rachid, de Magyd ? » Un moyen de redonner à l’humain sa juste place ?
Oui, et de ramener le journalisme à ce qu’il oublie parfois un peu trop. Lorsqu’il analyse trop, qu’il oublie le réel, le concret pour se perdre dans des interprétations, des discussions de salons ou des grandes théories. J’adore les essais philosophique ou politique, mais après les avoir lus, il est impératif d’aller confronter les idées avec ses amis, ses proches, des inconnus. Sinon, on se déconnecte de la réalité.
C’est peut-être un des seuls moments où je parle à travers Hubert Paris.
Hubert Paris, ancien secrétaire de rédaction, vous donne également l’occasion de tacler gentiment une certaine presse qui étale des papiers « mal écrits et qui ne valent rien de soi-disant stars du journalisme ». Pourquoi ce petit règlement de compte ?
Encore une fois, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Il y a des très grands reporters, des très grandes plumes dans tous les journaux. Mais il y a aussi, comme dans tous les boulots des gens qui sont payés (très cher) pour pas grand chose… et qui ont parfois droit à un bruit médiatique un peu surestimé. Mais ça m’énerve tout autant quand il s’agit de chanteurs ou de dessinateurs !
Pour Hubert Paris, j’aimais bien l’idée qu’il soit une sorte de chrysalide qui sorte de son cocon… et qu’il ne soit pas parfait non plus : on peut penser qu’il est animé par une sorte de rancœur.
On quitte Hubert Paris alors qu’il s’apprête à se mettre à la rédaction de son article… Allons-nous le retrouver sur d’autres planches ?
J’espère ! Du point de vue de l’éditeur, cela dépendra de l’accueil de Clandestino je pense ! Mais nous avons déjà commencé à évoquer ce que pourra être la prochaine « aventure » d’Hubert Paris.
Propos recueillis par Cathia Engelbach