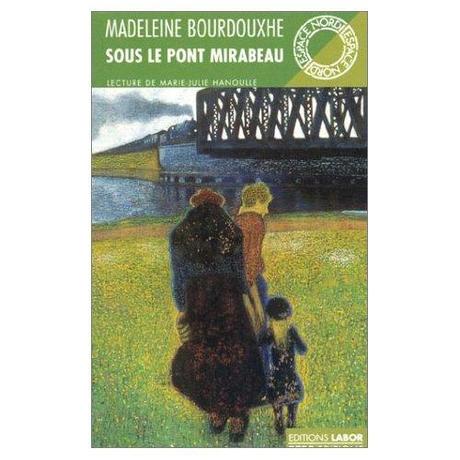
Quatrième de couverture :
Un matin de mai 1940. Une jeune femme vient d’accoucher. Dehors, c’est la ruée. Les Allemands sont à la frontière.
La jeune femme et son nouveau-né rejoignent alors les centaiens d’exilés sur les routes de France : femmes, enfants, vieillards fuient la Belgique et la guerre. Dans chaque village, à chaque halte, des images rappellent un autre voyage, en août 14…
Madeleine Bourdouxhe (Liège 1906 – Bruxelles 1996) est également l’auteur de La femme de Gilles (publié en 1937 chez Gallimard, sur l’avis enthousiaste de Jean Paulhan). Mêlée aux mouvements philosophiques, artistiques et littéraires du temps, elle échappe cependant à toue classification. L’amour, la solitude, l’incommunicabilité, la difficile rencontre des sexes forment la thématique de ces récits brefs où les mots cèdent le pas au silence.
Pour le rendez-vous classique de ce Mois belge, j’ai choisi ce court récit de Madeleine Bourdouxhe, parce qu’il est… court et pour découvrir autre chose que La femme de Gilles, roman très connu, je crois (et très beau, bien entendu).
De Pont Mirabeau, d’Apollinaire, il n’est absolument pas question dans ce texte, mais la douce mélancolie du poème sied bien à ce récit étonnant. Cela commence sur une page d’émerveillement et d’épuisement d’une jeune mère après son accouchement, j’étais déjà conquise (à nouveau) par les mots de l’auteur. La nuit même, les bombardements se déchaînent sur la Belgique et voici la jeune femme jetée sur les routes de l’exode avec sa petite fille nouveau-née. Elle se laisse conduire, jusque dans les Landes en passant par Dunkerque, Chartres, Bergerac… En chemin, dans les villages où on fait halte pour la nuit, elle croise des exilés comme elle et beaucoup de soldats en déroute, qui "attendent les ordres".
Mais de violence, de peur, d’angoisse, de faim, il n’en est pas étonnamment pas question non plus : il semble que le plus important soit de vivre le mieux possible ce temps des relevailles, et malgré qu’elles soient bouleversées par la guerre et l’évacuation, la jeune mère n’en souffrira pas vraiment. Les soldats qu’elle croise l’aident à s’installer, à trouver de la nourriture, à rendre le voyage le plus confortable possible malgré tout…
L’exode est vécu avec une grande sérénité et une attention particulière aux sensations : couleurs, chaleur du soleil, parfums, chants des oiseaux, éclats d’orage… Peut-être cette perception tout en silence et en ressenti est-elle symbolique de la situation de la jeune femme : un peu en retrait de par sa situation de jeune accouchée mais au plus près, malgré tout, de la vie et de la guerre qui l’effleure de son souffle, par le sang qui recommence à couler entre ses jambes…
Dans ce récit qui n’est pas sans rappeler sa propre expérience de mai 1940, le style de Madeleine Bourdouxhe privilégie les énumérations (et les constructions anaphoriques), la délicatesse des descriptions, la simplicité des faits. L’émotion naît de ces petites touches en demi-teintes qui disent la solitude, le silence et surtout la maternité d’une femme dans la guerre. Des notes, des sensations qui renaîtront plus tard, qui trouveront sens dans l’acte même d’écriture.
"Elle s’étire sous les draps, couchée sur le dos. Elle ne souffre plus. Une grande béatitude l’enveloppe tout entière, une béatitude d’enfant, le bien-être qui suit la souffrance. Elle est redevenue enfantine, de la tête aux pieds, dans sa chair, dans son coeur, dans son esprit. Si quelques paroles viennent à ses lèvres, c’est une chanson saugrenue, il n’y a pour la comprendre aucun effort à tenter. Colimaçon borgne, prête-moi tes cornes, un, deux, trois, grandmeriolle. Etait-ce bien ainsi, ou étaient-ce d’autres paroles ? Ah, paix en moi, et à côté de moi… Elle détourne la tête, pour voir à travers le grillage ripoliné le visage minuscule. Elle sourit : elle n’est pas belle, chaude des eaux et du sang de sa mère, marquée de nébuleux, de précurseur. Quelque chose lui manque qui ne l’a pas enveloppée encore, délivrée, touchée de sa grâce. Demain elle sera belle, quand l’aube aura glissé sur son visage, que les odeurs auront effleuré ses narines, quand l’air qu’on respire aura baigné tout son corps, qu’une parcelle du temps du monde aura séché ses cheveux et défripé ses mains. Alors, elle aura fait sa place, elle sera insinuée, bien calée, entre les phénomènes du monde, devenue phénomène elle-même. Demain elle sera belle, dès l’aube, et elle connaîtra tout de suite le soleil, elle qui vient de naître au mois de mai. Joli mois de mai, colimaçon borgne, prête-moi tes cornes, je n’ai plus mal, et je vais bien dormir, m’endormir… Ah, paix en moi, et à côté de moi…" (tout début du récit p. 7-8)
Madeleine BOURDOUXHE, Sous le pont Mirabeau, Lumière, Bruxelles, 1944 (réédité par Labor en 1996)


Bâtiment
Classé dans:De la Belgitude, Des Mots au féminin Tagged: Madeleine Bourdouxhe, Sous le point Mirabeau
