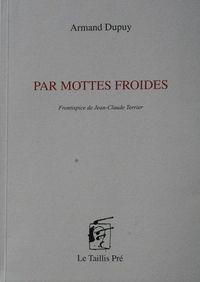 Le titre pourrait suggérer un cheminement, mais il faudrait penser un voyage d’hiver, immobile. Début du livre : « Blanc. C’est à peine si / ou plutôt c’est vraiment. // Ou simplement c’est. » (p.11) Fin du livre : « Autour, // rien n’a bougé. » (p.76) Il y a de la terre, de la neige, un paysage flou, et puis une table, du café, et puis quelqu’un, « je », qui sonde une expérience : être « sans ». Vide de soi, et absence de l’autre, alors que le monde reste immobile, inchangé : « Les choses / encore les choses et ce blanc / dedans » (p.12). Car c’est bien la perte qui a modifié la donne et amené jusqu’à ce presque rien : le « tu » présent au départ avec « (ses) mains sur la nappe » (p.12) a disparu à la fin : « Voilà, // je voudrais te dire il faut s’inventer, / tu n’es pas là. » (p.76) Ce « tu » qui disparaît, s’absente, est proche du « je » : on pourrait presque penser à un double, un peu comme si l’on était dépossédé de soi et qu’il ne restait qu’une pelure, une forme encore vive mais vide, avec seulement « le mince fil d’être ici » (p.40). Une présence faible, a minima : un « je » décharné.
Le titre pourrait suggérer un cheminement, mais il faudrait penser un voyage d’hiver, immobile. Début du livre : « Blanc. C’est à peine si / ou plutôt c’est vraiment. // Ou simplement c’est. » (p.11) Fin du livre : « Autour, // rien n’a bougé. » (p.76) Il y a de la terre, de la neige, un paysage flou, et puis une table, du café, et puis quelqu’un, « je », qui sonde une expérience : être « sans ». Vide de soi, et absence de l’autre, alors que le monde reste immobile, inchangé : « Les choses / encore les choses et ce blanc / dedans » (p.12). Car c’est bien la perte qui a modifié la donne et amené jusqu’à ce presque rien : le « tu » présent au départ avec « (ses) mains sur la nappe » (p.12) a disparu à la fin : « Voilà, // je voudrais te dire il faut s’inventer, / tu n’es pas là. » (p.76) Ce « tu » qui disparaît, s’absente, est proche du « je » : on pourrait presque penser à un double, un peu comme si l’on était dépossédé de soi et qu’il ne restait qu’une pelure, une forme encore vive mais vide, avec seulement « le mince fil d’être ici » (p.40). Une présence faible, a minima : un « je » décharné.
Cette expérience du peu d’être pourrait sembler « imprononçable » (p.31) mais elle passe pourtant à travers la tension créée par l’alternance entre les cinq séquences en vers libres courts d’ « Une suite sans » et les quatre séquences de poèmes en prose non justifiée à droite. Alternance du maigre et de l’épais, comme pour prendre en tenaille « cette chose à distance » qui se dérobe : soi. Cette double écriture complémentaire est une des réussites du livre. Les textes en prose sont plus nourris de détails ; ils sont plus explicites, si on veut, mais sans jamais relater ou tomber dans une mise en scène du deuil ou de la séparation. Ce qui est saisi, c’est une forme d’évidemment par l’absence, une perte de repères et non pas directement sa cause. Ainsi le lecteur reste sur une ligne de crête, face à une sorte de neige du réel qui reste, absurde d’être aussi vide : « Aujourd’hui, debout sur rien. On ajoute des / phrases aux phrases et ce qu’innerve la peine, / on ne sait pas. Il faudrait s’arrêter juste ici, garder / l’influx. On s’obstine. (…) On cherche des détails qui / tiennent l’attente, qui font mur et tiennent assez / pour ne pas sombrer, ne pas revenir non plus. » (p.62)
On attend le prochain livre, mais une voix est clairement posée, dans sa solitude tendue.
[Antoine Emaz]
Armand Dupuy, Par mottes froides, Ed. Le Taillis Pré, 80 pages – 10 €

