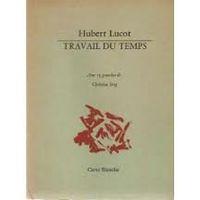 Le mot temps dit tout et rien de ce qu’il pourrait exprimer. Il désigne pourtant dans le titre de ce livre de Hubert Lucot l’objet d’une expérience passionnée qui choisit d’écrire depuis et dans le temps : pâte émotive, substance portante. L’écrivain nous donne le sens du mot qu’il trace — il serait d’ailleurs bien naïf de penser pouvoir le trouver dans un dictionnaire. Le temps ne pointe aucune vérité, ne renferme aucun signifié, sinon le sens (la direction et l’ardeur, le mouvement et l’ambition) d’un travail (torture et jouissance) qui consiste à chercher par et dans les mots une matière telle qu’elle décrive l’impératif du corps, du désir, du chaosmos.
Le mot temps dit tout et rien de ce qu’il pourrait exprimer. Il désigne pourtant dans le titre de ce livre de Hubert Lucot l’objet d’une expérience passionnée qui choisit d’écrire depuis et dans le temps : pâte émotive, substance portante. L’écrivain nous donne le sens du mot qu’il trace — il serait d’ailleurs bien naïf de penser pouvoir le trouver dans un dictionnaire. Le temps ne pointe aucune vérité, ne renferme aucun signifié, sinon le sens (la direction et l’ardeur, le mouvement et l’ambition) d’un travail (torture et jouissance) qui consiste à chercher par et dans les mots une matière telle qu’elle décrive l’impératif du corps, du désir, du chaosmos.
Ainsi le temps existe-t-il par les traces qu’il lâche et abandonne à l’espace du livre : écoulement de l’encre sur le papier, érosion des graphes, cycle de la main et du corps, battement d’un tempo qui accorde le mouvement du monde à la respiration de l’âme. Phanées les nuées inaugura, chez Hachette/POL en 1981, un ample roman de la langue. Travail du temps, quelques années plus tard, le poursuit en explorant notamment le sous-sol de cette effervescence verbale dont la grammaire est malmenée par un certain nombre de hiatus. Arrêts, décrochages, brisures, croisements, ellipses : chaque événement, chaque surgissement, chaque apparition provenant de la scène mentale se trouve ainsi verbalisé selon une syntaxe qui intègre par la désintégration, qui accueille par la faille, qui accomplit dans la distance la rencontre d’un moi et de son autre. Le travail révèle le temps comme le temps dévore le travail. Ce dernier, simulation suprême, ne cesse d’introduire de la discontinuité dans une trame et un parcours — ce que l’on appelle livre — que les lois voudraient linéaires et lénifiants.
Voici, donc, le récit d’une phrase, l’aventure d’un phrasé. Confrontées à un temps qui ne se montre que nié, ces propositions s’allongent et se replient au gré des failles qu’elles circonscrivent. Une phrase-monde donc, qui ménage des pauses, introduit des accélérations, reconfigure une durée, noue des rencontres. Fluidité arrêtée d’une prose qui ne s’impose plus de compter et de décompter les instants du temps, les rythmes balancés d’une progression argumentative. La ligne, ainsi, garde le souvenir de ce qu’elle a posé tout en fléchant ce qu’elle n’a pas encore saisi. Elle se détourne des coïncidences comme des évidences, et désigne notre monde en inventant continûment ce qu’elle tente d’exposer. Elle s’ouvre à l’expansion des sous-sols, crée de nouveaux territoires dont le caractère marginal épouse le centre de nos attentions. Présentée comme « corps noir », elle déplace et condense, tel le rêve, des densités que le sujet écrivant sublime et transpose ; des compacités qui, attachées aux choses du corps, du vivant, du politique, du quotidien, suturent la couture de la matière et de la vie. La fiction déplace les désordres sans jamais les répéter. Il lui suffit d’une date, d’un cadre, d’un lieu, d’un nom propre pour caresser cette « éternelle obsession » qui renverse le réel, exile la mort, déporte l’arrêt. Toujours cette « histoire naturelle » qui consiste à former des hypothèses verbales autour d’un objet, d’une sensation ou d’une émotion césurés, sans jamais prétendre récupérer ou recycler leur contenu. Il s’agit de pulser, de palper le temps travaillé par une langue qui n’en finit pas de dévêtir les mondes de nos violences, d’habiller nos attentes d’incertitudes. Aucun temps n’achèvera en tout cas notre travail de lecture.
[Anne Malaprade]
Hubert Lucot, Travail du temps, Carte blanche, 1985.

