Où l’on apprend qu’un film turc n’est pas un film américain, qu’il est bon de faire des étirements après avoir couru (on le savait déjà, mais bon…) et que décidément, je suis incapable d’être méchant, et pire que tout, rancunier…
Samedi 08.02
Le vent a encore soufflé toute la nuit, me vitrifiant l’humeur qui devient fort méchante. Le vent ou la fatigue, je ne sais plus bien mais voilà, je me sens irritable, mais c’est aussi parce que je sais que je ne fais pas grand-chose en ce moment, je me laisse un peu porter et ça, c’est insupportable.
Nous sommes allés courir hier, à cinq, en faisant le tour de la base de loisirs de Cergy, jusqu’à ce qu’une méchante douleur se réveille dans l’aine et derrière le genou, j’ai continué, j’étais épuisé, alors j’ai fini par m’endormir sur le canapé après m’être douché, sans demander mon reste. Ce matin, je les sens bien les kilomètres, mais c’est moins pire que ce que j’avais imaginé.
 J’ai regardé le très long film de Faruk Aksoy sur la prise de Constantinople (Fetih, 1453) et je suis loin d’avoir été séduit par cette superproduction turque. Le rythme est un peu lent et je me rends compte pour connaître un peu l’histoire de ces événements que la vision du réalisateur fait largement pencher la balance du côté qu’il souhaite. En plein vague d’anti-kémalisme et d’Ottoman revival, le film apparaît soudain comme un ode nationaliste, faisant passer le bon Sultan Mehmet II pour le gentil (ce qu’il n’a jamais été) et l’affreux empereur byzantin Constantin XI Paléologue pour le méchant (ce qu’il était assurément), en prenant au passage de belles libertés avec la réalité historique. Il ne me laissera pas de souvenir impérissable, ainsi que le jeu des acteurs.
J’ai regardé le très long film de Faruk Aksoy sur la prise de Constantinople (Fetih, 1453) et je suis loin d’avoir été séduit par cette superproduction turque. Le rythme est un peu lent et je me rends compte pour connaître un peu l’histoire de ces événements que la vision du réalisateur fait largement pencher la balance du côté qu’il souhaite. En plein vague d’anti-kémalisme et d’Ottoman revival, le film apparaît soudain comme un ode nationaliste, faisant passer le bon Sultan Mehmet II pour le gentil (ce qu’il n’a jamais été) et l’affreux empereur byzantin Constantin XI Paléologue pour le méchant (ce qu’il était assurément), en prenant au passage de belles libertés avec la réalité historique. Il ne me laissera pas de souvenir impérissable, ainsi que le jeu des acteurs.
Vers 17h30, le ciel devient jaune et la pluie tombe drue ; je reviens de faire quelques courses et j’ai l’impression de ne plus bien savoir quelle heure il est.
Lundi 10.02
Le réveil me surprend ; il est encore tôt et il fait froid. J’ai l’impression d’être un petit vieux quand je saute du lit au canapé en me recouvrant du plaid rouge. Une pensée me saisit au rebond ; je ne suis pas né dans la pourpre mais tous les matins je m’en enrobe pour renaître. Quel symbolisme curieux y voir ?
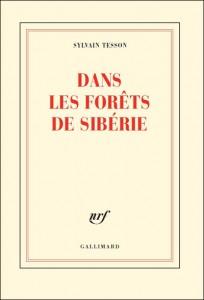 J’ai commencé à lire Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Je me suis dit qu”il fallait absolument que je lise ce livre, je ne sais même plus pour quelle raison, car je l’ai déjà dit, tout chez ce type m’est antipathique, mais je suis encore capable de faire le distinguo entre une œuvre et son auteur. Malheureusement, je n’arrive pas à y trouver de quoi creuser cet écart et j’entends encore sa voix gouailleuse et son accent parisien me cracher à la figure, même s’il me parle de solitude, de glace qui craque, de vodka qu’on boit tandis qu’il fait -35°C dehors ; je n’y arrive pas, mais ce n’est pas grave. A côté, je lis un autre livre : Onze lettres à Pénélope de Lorenzo Pestelli. C’est un tout petit livre qui fait figure de bijou, un de ces livres qu’il faut prendre le temps de lire comme on décortique des pistaches, avec le soin et la gourmandise qu’il mérite. Pestelli, une découverte grâce à Nicolas Bouvier.
J’ai commencé à lire Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Je me suis dit qu”il fallait absolument que je lise ce livre, je ne sais même plus pour quelle raison, car je l’ai déjà dit, tout chez ce type m’est antipathique, mais je suis encore capable de faire le distinguo entre une œuvre et son auteur. Malheureusement, je n’arrive pas à y trouver de quoi creuser cet écart et j’entends encore sa voix gouailleuse et son accent parisien me cracher à la figure, même s’il me parle de solitude, de glace qui craque, de vodka qu’on boit tandis qu’il fait -35°C dehors ; je n’y arrive pas, mais ce n’est pas grave. A côté, je lis un autre livre : Onze lettres à Pénélope de Lorenzo Pestelli. C’est un tout petit livre qui fait figure de bijou, un de ces livres qu’il faut prendre le temps de lire comme on décortique des pistaches, avec le soin et la gourmandise qu’il mérite. Pestelli, une découverte grâce à Nicolas Bouvier.
Départ dans neuf jours, je n’ai encore rien préparé, et l’angoisse de chacune de mes excursions me saisit à nouveau, paralysant mes nerfs, me rendant incapable de prendre des décisions. Je déteste cet état qui me rend léthargique. Je m’interroge sans cesse sur ce que je dois emmener comme vêtement, crains d’avoir froid dans l’avion, d’avoir trop chaud une fois sur place, et entre la maison et l’aéroport, comment je m’habille ; en bref, tout ceci sont des préoccupations bien futiles à côté de tout le reste.
Mardi 11.02
Tous les matins, je ne déroge pas à la règle que je me suis fixée ; une heure de lecture au minimum. Je ne m’accorde une pause que le week-end, profitant quand-même de ce moment de repos indispensable. Lire est un viatique pour l’enfer ; cela permet de s’extraire du monde, tout en prenant la réalité de ceux qui ont écrit en plein visage. Point de salut là-dedans, comme il n’y en a pas non plus dans la religion ; on donne l’impression d’être libre mais la liberté se mesure à la longueur de la chaîne.
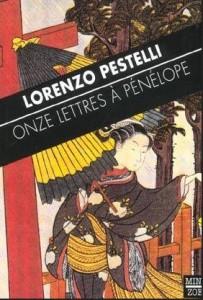 J’ai terminé hier soir le petit livre de Lorenzo Pestelli, Onze lettres à Pénélope, livre d’une rare beauté. Ayant eu un peu de mal à entrer dans cette poésie sauvage, je me suis quand-même laissé bercer par le doux rythme des mots et au final, je l’ai relu d’une traite, gardant près de moi certains de ses mots qui me font encore vibrer.
J’ai terminé hier soir le petit livre de Lorenzo Pestelli, Onze lettres à Pénélope, livre d’une rare beauté. Ayant eu un peu de mal à entrer dans cette poésie sauvage, je me suis quand-même laissé bercer par le doux rythme des mots et au final, je l’ai relu d’une traite, gardant près de moi certains de ses mots qui me font encore vibrer.
Je préfère écrire sur le sable, aussi longtemps que le consent la racine épuisée du jour. Une grande lettre, espacée comme une rive, que tu liras après ma mort dans le paysage de ta tristesse. Sur une côte inconnue, sur la feuille du silence, un seul signe, signature, si tu veux : mon corps raidi comme une guitare oubliée. Un doigt révélé par la lumière de la lune sur le mur vaporeux de ton visage !
Tu n’auras que tes cheveux pour ensevelir ton secret.
J’aurais passé hier une heure et demi avec la petite nouvelle pour son entretien. A la fin du temps imparti, je boucle l’entrevue mais elle se révolte et me dit avec une petite moue « oh non, j’aime bien discuter avec vous ». Il aura fallu, pour une fois que je me montre ferme. Je ne sais pas vraiment dire non, mais il faudra que j’apprenne. Penser c’est dire non. Il paraît.
Peut-être que la seule ville qui pourrait me voir habiter en dehors de mon habitus, serait Tokyo, ville-monde dans laquelle on pourrait facilement tout perdre…
Départ dans huit jours.
Mercredi 12.02
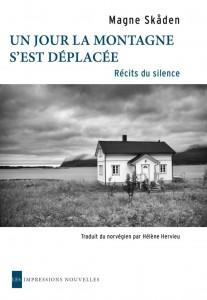 J’ai commencé hier soir un livre étrange. L’auteur en est un Norvégien d’origine samie, Magne Skåden. Hélène Hervieu, qui l’a traduit et préfacé, dit sa surprise le jour de sa rencontre avec le jeune homme qui vit d’ordinaire sous le 68ème parallèle, au-delà du cercle polaire. Elle ne sait rien de lui et n’a été attirée vers lui que par son texte, une écriture “concentrique” et dès la lecture de sa première nouvelle, on y ressent immédiatement cette vision des choses, on y sent la froideur du métal et l’inconsistante rigidité des peuples nordiques. Ce qu’elle ne sait pas tout de suite, c’est que Magne Skåden ne parle pas, non pas parce qu’il n’en a pas envie ou qu’il est muet, mais parce qu’il a subi des lésions cérébrales qui lui enlèvent cette capacité à produire un langage parlé. Un jour, en 2005, il finit par se mettre à écrire et déjà, il a publié plusieurs livres en Norvège, livres qui finissent par nous arriver.
J’ai commencé hier soir un livre étrange. L’auteur en est un Norvégien d’origine samie, Magne Skåden. Hélène Hervieu, qui l’a traduit et préfacé, dit sa surprise le jour de sa rencontre avec le jeune homme qui vit d’ordinaire sous le 68ème parallèle, au-delà du cercle polaire. Elle ne sait rien de lui et n’a été attirée vers lui que par son texte, une écriture “concentrique” et dès la lecture de sa première nouvelle, on y ressent immédiatement cette vision des choses, on y sent la froideur du métal et l’inconsistante rigidité des peuples nordiques. Ce qu’elle ne sait pas tout de suite, c’est que Magne Skåden ne parle pas, non pas parce qu’il n’en a pas envie ou qu’il est muet, mais parce qu’il a subi des lésions cérébrales qui lui enlèvent cette capacité à produire un langage parlé. Un jour, en 2005, il finit par se mettre à écrire et déjà, il a publié plusieurs livres en Norvège, livres qui finissent par nous arriver.
Un jour la montagne s’est déplacée : Récits du silence, tel est le titre de ce livre qui arrive dans la sphère des livres météoriques et dont je vous dirai des nouvelles. M’est avis qu’on ne peut ressortir de là indemne.
Tous les matins, je me réveille avec dans la tête le chant du muezzin dont je connais à présent chacune des notes. Tous les matins j’entends ce petit homme qui court pour se rendre dans la tour sud de la Yeni Camii, la mosquée nouvelle de la Sultane Valide sur le parvis d’Eminonü, face à la Corne d’Or. J’en connais les moindres variations de voix tellement je l’ai entendu et tellement je l’ai écouté encore et encore. C’est à ce point qu’on mesure l’amour qu’on peut avoir pour une ville qui fait défaut à l’intérieur, dont on n’arrive pas à se repaître sous peine de la faire mourir et d’entraîner l’âme qui la fait vivre avec elle. Je crois que cette vision des choses est fondamentalement compliquée à partager.
Départ dans sept jours. Je n’ai rien préparé, je n’ai même pas encore de billet d’avion pour les vols internes. On verra bien non ?
Photo d’en-tête © Alexis Gravel

