Victor-Lévy Beaulieu
(Alias Abel Beauchemin)
« Monsieur Melville »
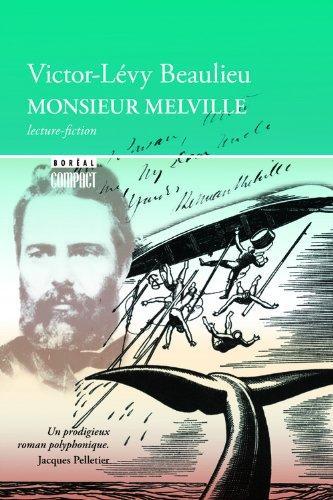
Que retenir des vingt-huit dernières années de la vie de Melville ? Cette question intervient dans le livre de VLB à la page 486. Pourquoi ? Pourquoi aussi VLB s’est-il tant intéressé à ces dernières années de la vie de Melville qu’il passa comme employé des douanes du port de New York, lassé de prononcer des conférences, se délivrant de sa culpabilité (son fils s’était suicidé d’une balle dans la tempe), meurtri, en écrivant Billy Budd ? Son autre fils aussi, Stanwick, était mort jeune, ignoré, seul, incapable comme son père de trouver un sens à sa vie. Melville vivait le silence, emmuré dans cette banalité du quotidien d’un inspecteur des douanes ; mais, le soir venu, il écrivait de la poésie. Oui, vingt-huit années passées à écrire de la poésie.
Cette période est, semble-t-il, moins connue des lecteurs de Melville. Pourquoi ? La poésie sans doute ne retient pas autant l’attention des lecteurs de Moby Dick ?
Voilà, c’est le mot clé, la poésie, pour moi qui ai aimé-préféré cette dernière partie du livre de VLB.
À cette époque, celle où Melville écrit de la poésie, il y a la guerre de sécession aux Etats-Unis, et Melville estime que toute guerre est infantile, méprisable parce que méprisante. Dans ses vers, de circonstances, il y a deux thèmes, l’élégie de l’héroïsme, et le chant de la douleur. Il écrit: « Dans la majorité de mes vers, je n’ai fait, semble-t-il, que placer une harpe à la fenêtre et noter les différents airs que les vents contraires ont joués sur ses cordes ».
« L’homme n’étant que passager, c’est à dire souffrance, il n’y a plus que la nature », écrit VLB à propos de ce que recherche-ressasse Melville. Écrire de la guerre et de la nature, est-ce possible ? Oui, je le crois, quand je lis ces quelques vers... tirés de « Malvern Hill ».
« Tout notre mauvais arroi se voyait en nos visages - / Est-ce que le bois des ormes / Se souvient du sang séchant dans nos barbes ? / Le drapeau noirci, aux étoiles noyées de fumée / Nous l’avons suivi (il n’est jamais tombé) ; / En silence, il ensemençait le renouveau de notre force, / En silence, il recevait le cri des autres ; / Enfin sur ces pentes, patiemment, nous avons pu / Retourner le canon et suivre les arbres bienvenus ; / Oh mais combien y ont trouvé / La terre nue de leur tombe ! - / Est-ce que le bois de Malvern / Pense à ces choses, rêve noir et ressasse ? »
Parfois deux vers m’émeuvent quand ils disent si « émouvammant »... des mots de nature...
« S’agite le monde comme il voudra, / Il faut qu’au printemps les feuilles vivent vertes ».
Oui, comme le dit VLB, « les hommes meurent mais le sol reste ».
Et tout cela est toujours si actuel... ainsi, ce jour, dans le journal Le Monde... des nouvelles si ordinaires qui sont le lot quotidien des informations qui nous arrivent...
...1/ entre 400 et 500 cadavres auraient déjà été transportés dans des hôpitaux de Juba. Ne cherchez pas, nous sommes au Soudan sud où il n’y aurait pas eu de coup d’état, pour sûr, mais, disons, quelques altercations entre clans rivaux... (on croit tout cela quand on le lit ? Bien sûr)
...2/ C'est un conte de Noël à l'américaine. Hal Plotkin, petit Californien sans le sou, devenu conseiller du président Barack Obama ;
...3/ la crise s’aggrave dans les banlieues françaises
...4/ Facebook peut tout utiliser, même ce que vous ne publiez pas...
...et oui, c’est comme ça tous les jours... il n’y a plus « la » nouvelle du jour, il n’y a que des dizaines-centaines-milliers de nouvelles très ordinaires, et si ordinaires qu’elles ne sont plus des nouvelles. Tellement elles nous blasent, elles nous blousent ; oui, elles ne nous séduisent ni ne nous révoltent plus dans leur ordinaire normalité. Elles nous tuent à petit feu, du moins, elles affectent notre goût de vivre encore... parfois. Elles troublent notre conscience, affectent notre moral, mettent en doute notre idée du réel, blessent notre âme, et, peu à peu, construisent la réalité si tant est qu’elle soit vraiment réelle. La poésie peut-elle mettre un baume là-dessus... ou nous redonner du courage... du courage de voir autrement, mieux, de changer les choses... ?
« Il y a des sanglots chez les forts / Et comme un voile sur le pays / Mais le peuple dans ses pleurs / Met à nu sa main de fer ; / Craignez le peuple quand il pleure / Et met à nu sa main de fer ».
Pour VLB, on ne peut dire mieux, on ne peut dire plus... mais cela va-t-il changer quelque chose ? Oui, faut-il craindre le peuple quand il pleure, ou faut-il souhaiter que le peuple pleure pour qu’advienne des changements. La révolution !
Puis - je suis toujours en train de lire les dernières pages du livre de VLB, les derniers mots de Melville -, vint Clarel, la grande œuvre, en vingt mille vers, à laquelle, pendant vingt ans, Melville a travaillé, lentement, accompagné d’étourdissements et de vertige. Un texte étrange, dit VLB, une sorte de « queste du Saint-Graal », cette histoire d’un étudiant qui a abandonné ses études religieuses et qui fera bientôt la longue traversée du désert chrétien...
« Un étudiant est assis, ses coudes sur ses genoux ; / Immobiles sont ses mains et sa poitrine. / L’étudiant est seul, et il rêve ».
VLB parle de John Marr and other sailors comme du plus beau poème de Melville... « dans un lyrisme qui fait des mots de Melville une simple beauté du dire »...
« Car droit vers la mort je me laisse entraîner ! / De bruits douloureux sont maintenant pleines les eaux, / Ces eaux qui s’emportent, se rassemblent / et me cherchent / Au beau mitan de la grande mer des Sargasses / Pour que totalement s’aveuglent mes yeux ».
... puis de The Aolian Harp, comme exemple de la musique d’un poème...
« Mon dire impuissant à faire venir / La beauté de votre dernier mot ».
« Surnager dans l’évanouissement du soi / Et ne plus avoir de désir pour rien ».
Dans un autre poème, After the pleasure party, Melville montre une femme savante qui se voit écartée de l’homme qu’elle aime quand celui-ci lui préfère une paysanne. VLB traduit ainsi l’évidente intention de Melville : « pourquoi l’homme choisit-il le monotone quotidien plutôt que le génie de la femme » ? Celle-ci choisira de n’être pas la vierge blanche mais la vierge armée... mais je ne résiste pas à me rappeler cette lecture de Jeannette Winterson « Pourquoi être heureux quand on peut être normal ? » et me demande ici: - être heureux serait-il de choisir la paysanne ? - et la normalité, de marier la femme savante ? Ou l’inverse ? Je ne sais pas où cela pourrait m’amener... mais je n’y irai pas... pas en ce moment.
VLB enfin conclut : « Après avoir lu Melville vieux (donc le Melville de cette période d’écriture poétique et d’inspecteur des douanes), je ne pourrai plus écrire comme avant ».
Et moi, je me dis : après avoir lu ces quelques extraits des poèmes de Melville, je découvre le « meilleur » de ce livre de VLB. Quelle conclusion ! Oui, quelle belle fin de livre ! Quelle belle fin de vie ! Même si cela paraît bizarre, ce Melville vieux, en fin de vie, si poète, si emmuré dans un travail à la con, écrivain-poète silencieux (il est sans doute le seul qui se soit vraiment compris...)... et que j’ai l’air de préférer au Melville jeune. Je n’ai jamais lu Melville...
J’entends par là que ce livre de VLB, que j’ai trouvé un peu long parfois, m’est révélé en toute fin. Je n’ai pas lu Moby Dick, ni aucun livre de Melville, et pourtant, je me suis laissé gagner par les conclusions de VLB... (et, ce qui ne gâte rien, ma femme vient de m’offrir Moby Dick en cadeau de Noël).
J’ai commencé par la fin, mais... je reviens au texte de VLB...
La première remarque qui me vient est celle-ci : VLB a adopté dans ce livre une (des) posture(s) innovante(s).
Il sera peu à peu si engagé dans sa lecture des textes de Melville qu’il fera le choix, des choix devrai-je dire, très originaux. Tour à tour, il sera l’écrivain critique de Melville, cet Abel Beauchemin, le narrateur, puis il sera le contemporain de Melville (il fera un voyage dans le pays de l’auteur de Moby Dick) lui parlant, s’instituant, au dire même de Melville à qui il prête la parole, son biographe attitré, son biographe « capricieux », cet Abel Beauchemin, cet écrivain-avatar de VLB, « qui est venu de je ne sais pas où, muni d’une dent de cachalot, pour me troubler dans l’au-delà même de la mort ».
Cette posture, comme narrateur biographe, et contemporain, a des exigences qui amènent VLB à inventer-imaginer-fictiver des « lettres » que Melville écrit, des « dialogues » qui ont lieu entre Melville et lui, des « sentiments et états d’âme » qu’il prête à Melville...
...ainsi Melville, parlant de son livre Mardi, nous dit : « À l’origine, je n’avais voulu écrire qu’un livre tout simple mais c’est autre chose qui est venu, c’est-à-dire ma vie même ».
... ainsi Melville, écrivant dans une lettre virtuelle (mais là, c’est réel, puisque ce texte a vraiment été écrit ; pourquoi VLB le met-il dans cette lettre ?)... ces mots qui me surprennent...
« C’est à l’Amérique qu’il appartient de créer des précédents au lieu de leur obéir... Dieu a prédestiné notre race, pour le bien du genre humain, à de grandes choses... le reste du monde sera bientôt dans notre sillage. Nous sommes les pionniers du monde... » (et bla bla bla, la lettre est longue, l’extrait a une page ; je n’aime pas cette attitude des Américains, je ne l’ai jamais acceptée, elle me révulse, aussi bien le dire. C’était une parenthèse. Mais je me demande encore pourquoi VLB a mis dans cette lettre virtuelle, ce texte réel de Melville ; mais... l’est-il réel, ce texte ?).
...ainsi Melville, toujours dans ce même chapitre, annonçant « entrer dans une nouvelle phase de ma vie, celle qui, bien avant que je ne meure le 28 septembre 1891, a tué le romancier qu’il y avait en moi ». Cette conscience chez Melville d’avoir cessé d’être un romancier... que révèle-t-elle ? Était-ce un choix voulu-déterminé... que de devenir poète ? Était-ce une démission... une veine romancière se serait-elle tarie ? Ou, tout autre chose ? Je crois très simplement que le choix de Melville indique un choix de vie, et partant, dans sa solitude-éloignement-désintérêt, montre son rejet de la société où il vit.
VLB devient aussi Melville tant VLB s’identifie à la vie, aux sentiments, aux introspections de Melville, écrivain peu sûr de lui, se trouvant parfois si médiocre, si incompris aussi... que cela, finalement, me dérange, étant un lecteur qui aime VLB. Je me dis : VLB n’est pas personne, il est un écrivain contesté certes, peu lu (il le dit lui-même), mais il est un grand écrivain. Pourquoi alors jouer ce jeu trop minimaliste-intimiste ? Ce n’est pas une simple métamorphose (le grand est petit), un changement de forme de pure forme, une transformation imaginée et virtuelle, fictive, pour les fins d’une démonstration. J’imagine plutôt VLB en quête d’une connaissance de soi (à la recherche de son soi-même, comme il le dit dans un autre livre) ; il s’agit d’un exercice salutaire parfois (se voir simplement... humblement, comme « pas si bon »), mais cela aide-t-il à quelque chose, sinon à farfouiller dans un ego qui dépasse déjà la mesure ordinaire ? Certes il ne se voit pas en un écrivain de deuxième ou de troisième catégorie, il montre plutôt métaphoriquement, dans ses ressassements intimistes-minimalistes, un état d’âme du « moment », comme s’il était en perte de sens, à la recherche de sens, à la recherche de reconnaissance, à la recherche d’une confirmation... Mais est-ce si utile de le faire si souvent ? Oui, tous ses livres, ceux de VLB, rappellent cette vision un peu noire-pessimiste qu’il aime montrer de ses qualités d’écrivain, - ses textes seraient inachevés, ils ne seraient qu’un seuil, ils seraient les pastiches de ceux de l’autre qu’il aime tant...-, alors que je lui donne d’emblée les plus grandes qualités de dire, d’écrire, de poétiser dans une langue française universelle, mais aussi si québécoise. Certes, rarement un écrivain se donnera comme pur écrivain (Milan Kundera le fait-il, peut-être ? un peu, dans ses exercices de dire ce qu’est un roman, et ce qu’il n’est pas – trois livres sur le sujet -) même s’il leur arrive fréquemment de critiquer la vacuité de certains textes de d’autres écrivains.
Mais j’aime bien voir comme il s’identifie si « profondément » à son Melville, celui du livre, qu’il invente presque parfois, tellement sa biographie n’a rien d’un texte scientifique ; c’est un texte qui relève plutôt de conjecturations forcées - et je les aime comme ça -, qu’il présente avec tellement de couleurs, de certitudes presque, de forces et d’intelligences, que je suis, lecteur, sous le charme non équivoqué de la présentation. VLB ramasse un minimum d’éléments de la vie de Melville, à travers des récits de sa vie, à travers ses lettres et celles de d’autres proches, à travers ses romans et sa poésie, et il les brasse, puis en déduit un portrait des plus vraisemblable. Quand il écrit des phrases du type... « peut-on voir autrement ce qui apparaît si simplement ? », ou « je ne vois pas comment il ne pourrait pas en être ainsi », ou « il n’y a que ceux qui n’ont pas bien lu Melville qui peuvent croire autrement que... » etc... on sait que VLB va soutenir une thèse (disons une idée) qui est peu commune, ou une idée qui va à l’encontre des idées reçues et acceptées, à l’encontre de l’histoire officielle souvent, ou simplement une idée « nouvelle » que l’on n’avait pas lue-entendue avant qu’il ne l’écrive.
« Dans les aveilles de Moby Dick, dans les ruelles de la préparation de ce livre... »
VLB a aimé lire Melville et, dès l’entrée, il nous le rappelle ; il connaît aussi le danger d’un pareil amour quand il s’apprête à écrire son livre : « Ce qui guette le livre à faire, c’est l’épuisement des images qui vous sont venues de lui, qui se sont inscrites en vous à un point tel que vous finissez par les faire vôtre, sans aucune réciprocité ».
Écrire sur un autre est aussi un prétexte, ajoute-t-il, comme par exemple, de rendre compte de quel lieu qui est en soi « qui est le vrai ». Écrire, je le crois, est toujours un prétexte, une occasion recherchée d’écrire pour soi, et sur soi.
L’écriture, finalement, ajoute-t-il encore, « il n’est que cela », lui, VLB. Melville aussi n’était que cela. Mais VLB connaît ses faiblesses, il avait peur que ce livre ne fût pas beau... Et il conclue ainsi l’introduction à cette partie du texte: « Ce que Melville a été, c’est ce que je voudrais être ».
Puis il confirme que cette sorte de « biographie » de Melville sera une « histoire » de Melville, basculant ainsi dans la fiction, afin de dire « mieux » ce que Melville a été.
Voilà, je suis, lecteur, prévenu. Mais ça me plaît.
Puis il convoque sa famille, tous ceux-là qu’il a mis dans ses livres, et leur dit qu’il passe à autre chose pour deux années et qu’il va les laisser en paix, chassant ainsi leurs appréhensions d’être fouillés psychologiquement, et de façon outrageusement réductrice, comme ils le disent.
Puis il s’enferme dans la maison de son père qui va assister à la naissance et à la concrétisation de ce livre sur Melville, surveillant parfois par-dessus l’épaule de VLB, lui enjoignant souvent d’aller se reposer quand VLB s’écrase virtuellement dans le travail d’écriture, lui offrant café et petits gâteaux, et lui rappelant ce livre, La grande Tribu, qu’il doit réaliser sur sa famille. Père attendra patiemment tout au long de la rédaction de ce Melville que VLB a mis 5 ans ( ?) à écrire.
L’incipit réel du livre, je néglige temporairement un peu ce que je viens d’écrire et qui m’a prévenu... c’est cette image de Melville (une photo) qu’a VLB et qui montre une homme vieux, l’homme Melville, enfermé dans une austérité, résigné à l’annihilation (il est inspecteur des douanes à New York et arpente les docks), qui se sent des plis amers autour de la bouche... et qui montre, pour VLB, le Melville grand écrivain du grand échec. VLB veut savoir pourquoi et comment il en a été ainsi. C’est le dessein de ce livre, la grande motivation de VLB.
Mais, dès le départ, VLB avoue être avalé par sa propre fureur. Comme Melville, il est dans l’urgence d’écrire, tout comme Joyce, dit-il, tout comme Sartre également qui se bourrait d’amphétamines pour accroître sa vitesse de travail... Voilà, c’est dit. VLB va encore parler de lui, et il en sera ainsi tout au long de ce livre, avouant, « comme si à force d’écrire je m’annulais pour ainsi dire, de plus en plus incapable de donner de l’épaisseur à ma vie... pendant un temps j’ai tout perdu, au profit du romancier en moi. Judith m’a quitté, elle est heureuse maintenant... je n’ai jamais bien compris l’espace qu’il y a entre l’imaginaire et le réel puisque ce dernier ne m’est toujours apparu que comme l’activation de l’autre ».
VLB n’est pas seul dans ce cas... (Qui, quel écrivain, n’a pas perdu sa conjointe au profit du romancier en lui, à cause d’une séparation voulue... ou imposée ?) Imre Kertész, lui, s’est séparé de sa femme, « la belle juive », pour se consacrer à l’écriture, Pierre Michon, lui, a été abandonné par Marianne...
((extrait : "La lettre vint peu après: Marianne y disait sa volonté de rompre... que m'importait que les choses exultassent, si je n'avais pas de Grands Mots pour les dire et que nul ne m'entendît les dire? Je n'aurais pas de lecteurs, et n'avais plus de femme qui, m'aimant, m'en tînt lieu. Je ne pouvais tolérer la perte de ce lecteur fictif qui feignait, avec de si tendres égards, de me croire gros d'écrits à venir " (Pierre Michon)) ; Gauguin, lui, a abandonné femme, enfants et pays pour se retrouver au bout du Pacifique, à Tahiti, puis aux Marquises, afin de réaliser son art, comme il le voulait. Blaise Cendras, lui, négligeait sa famille, femme et enfants pour Bourlinguer dans le monde (il faut lire sa biographie écrite par sa fille).
Je vois dans cet ajout un autre incipit à ce livre : fiction et réalité forment la trame du livre, mieux, elles sont à la source des nombreuses postures narratrices que VLB va adopter tout au long de son texte.
Puis VLB se met à écrire ce que je vais maintenant essayer de lire, une autre fois, « tandis que Père enfermait le sachet de Maxwell House dans le percolateur ».
Melville, pour VLB, est au centre de son œuvre, il parle de lui ; c’est toujours de lui qu’il s’agit, peu importe de quoi il parle. (Cette phrase écrite à propos de Melville sied comme un gant à VLB). Il, et lui, ont donné ainsi tout leur sens au mot fiction... ou auto fiction ?
Une phrase clé du livre de VLB est celle-ci : « Quelles perceptions voudrai-je qu’il (Melville) ait eues de sa petite enfance (de sa vie finalement) ? J’essaie de les imaginer, en remontant dans mon propre passé, mais... on dépend de son père, de sa mère et de ses proches – et c’est ce qu’ils sont que l’on devient ».
Et partant, VLB, voulant parler de Melville, nous raconte de lui-même... « chez nous, nous étions pauvres », quinze bouches à nourrir, la notion de survie toujours présente, la montée éventuelle dans l’échelle sociale, le vieillissement... il ne croît pas que « bonheur et malheur » soient des nommaisons qui existent pour l’enfant... « seule la conscience, c’est-à-dire l’expérience, fait le partage et fissure de ce fait l’univers. Avant, il n’y a qu’un être qui emmagasine du savoir pour se donner une mémoire et ainsi, par elle, se choisir. Et c’est par le langage qu’on accède au seuil, et c’est par le langage que, peut-être on peut espérer aller au-delà »...
... à LA connaissance ?
VLB est ce qu’il devient. Ce qui l’intéresse, dit-il à son père, « c’est l’image que malgré tout on a de soi, à laquelle on se tient par les mains et par les pieds et qui n’a rien à voir avec le monde extérieur ». VLB se définit aussi quand il se passionne pour Melville parce que la lecture qu’il fait de lui (leur père, à chacun, a fait faillite et s’est tué à la tâche) l’aliène, « par tous ces rapprochements qu’on y trouve et qu’on développe, à dessein, pour pouvoir avoir, même vis-à-vis de soi-même, cette pérennité qui nous fait toujours défaut... ». Qu’est-ce à dire ? L’image que l’on a de soi ? Ce qui l’aliène par tous ces rapprochements (VLB se reconnaît à travers Melville) ? Sartre disait de Flaubert qu’il ne se comprenait qu’en s’inventant, la littérature étant son salut puisqu’il « n’inventait jamais que lui-même ».
Alors ! Est-on ? Ou devient-on ? Et qu’est-ce qui, dans ce processus, nous appartient ? Et qu’est-ce que nous empruntons et qui nous aliène en même temps qu’il nous crée ? Ces images que l’on a de soi ? Réelles, ou fictives ? Père dit, écrit VLB : « On ne devient jamais, on meurt ». Comment y échapper ? NON, on n’y échappe pas, et en attendant, on devient, ou, comme VLB le dit : « je ne sais pas, ça se cherche tout simplement ». Chacun, dit-on, est amené à se déterminer ; ou, peut-on dire, comme VLB le rappelle, que « chacun est déterminé à œuvrer comme il a œuvré » ? C’est curieux de voir comme je me pose souvent cette question. Ou celle-ci : chacun ne se détermine-t-il pas... suite à des contingences, ou suite à des plans, avec volonté et avec raison, avec grâce et avec fureur, dans l’espoir et le désespoir, dans le désarroi, dans la lâcheté, dans le courage, dans l’intimité, dans l’extériorisation... ?
Cette conclusion qui suit - VLB s’adressant à son père -, et qui oppose la vie d’avant à celle d’aujourd’hui, m’interpelle-t-elle ?
« Tu avais les mains liées dans le dos (par la famille, la religion, la patrie, il oublie l’école) et tu allais là où ça s’en allait. Pour nous, c’est différent, c’est en nous que ça doit se trouver, dans les débris qui nous ont été laissés de votre monde. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? »
Je ne sais pas si le père a compris... mais je crois que je comprends VLB d’autant plus que je mène cette vie où je me suis déterminé, ou croît m’être déterminé, si jeune, quand un jour, je devais avoir 15 ans, j’ai écrit ce texte, un texte où je m’athéïse, un texte qui à l’époque irritait tant ma sœur, (mon athéisme a toujours irrité mon entourage ; même aujourd’hui, j’irrite ma femme, quand je me plais à me foutre de dieu et de toutes ces religions folles qui prétendent mettre de la spiritualité en remplacement d’une pensée religieuse reconnue retardée, avachie, et vilipendée. Oui, tout cela n’est qu’une sorte de fourberie-supercherie si hypocrite qui refuse de se dire telle) un texte que ma mère a gardé si longtemps (elle quittait dieu à son tour, encore jeune mère de 39 ans) et que j’avais intitulé « pourquoi je ne crois pas en dieu » et sous-titré « pourquoi je crois en l’homme ». Pourquoi rappeler cela maintenant ? Sinon pour réfléchir un peu à ce que je deviens !
Melville un jour quitte l’Amérique pour Londres. Pourquoi ? Il en avait assez de sa chambre, de sa maison qui se rétrécissait, des murs qui l’enfermaient. VOILÀ !
Chacun fait ou ne fait pas cela. Changer de monde, de place, de vie, d’entourage, de quotidienneté. Combien de fois l’ai-je fait ? Je ne me rappelle pas. Je dis souvent que dans ma vie, je me suis enfui plusieurs fois... quitté une vie pour une autre...
Coups de tête vs coups de cœur !
Il y eu...
* (j‘avais 22 ans) une première fois, et celle-là a orienté toute ma vie adulte de travail. J’ai, sur un coup de tête, quitté la Faculté d’Architecture, (suite à une engueulade avec mes profs) pour aller de l’autre côté de la rue m’inscrire à la Faculté de Commerce. Un choc culturel s’il en est un, à cette époque, mais que je ne su pas voir, comprendre, admettre... Trop jeune, trop bête, pas assez mur...
* (j’avais 29 ans) une autre fois, et celle-là (un coup de cœur), a été ratée, n’a pas eu de suite... quand ma femme à l‘époque a refusé de me suivre. Oui, je me suis plié... et je n’ai pas acheté une Auberge au bord du fleuve aux Boules. Quitter un poste de professeur à l’université pour devenir aubergiste ? Une chimère un peu idiote, non ?
* (j’avais 30 ans) une autre fois (coup de tête) quand j’ai décidé d’aller étudier en Urbanisme (autant dire en architecture, des études que j’avais abandonnées quelques années plus tôt - il faut le faire, après des études en Gestion Financière, ha !ha ! -), pour voir un peu si tout ne s’expliquait pas autrement, dans ce monde, que par les seules lois des Finances. Et tout de suite après, je suis allé étudier en sociologie... Je parlais alors de « développement » social et économique... de développement du sous-développement (je lisais Samir Amin, André Gunder-Franck... puis Marx...) ; quel dessein avais-je en tête ? Quelle folie me poussait à demander ce congé à mon employeur... qui y avait cru ? Jeune impertinent, me dis-je aujourd’hui. Merci au curé Parent, alors recteur de l’université, qui y avait mis son OK. Et moi qui n’aime pas les curés, quelle sorcellerie ! C’est le comique de la vie, qui vous obéit-désobéit, qui vous trahi, qui vous aime, qui se fout de vous ! Et qui, dans ce cas, a orienté toute ma vie de professeur de gestion : je devenais un prof marginal, critique, empêcheur de tourner le capitalisme en rond... Je crois bien être demeuré à l’université parce que j’ai pu faire cela.
* (j’avais 32 ans) une autre fois, (coup de tête, coup de cœur) quand j’ai décidé de m’activer sur le terrain (là où est la vraie vie économique et sociale) auprès de coopératives que je croyais être les acteurs contemporains d’une 3ième voie, entre capitalisme financier et socialisme centralisé. Que de très sérieuses années de militance qui ont abouti à... rien d’autre que cette conviction d’avoir agi sincèrement et être devenu quelqu’un d’autre, plus social, plus socialisé, plus politisé, plus empathique, plus éclairé, plus critique, plus humain tout simplement. Pour ce qui est des coop ?!
* (j’avais 35 ans) une autre fois quand, dans une sorte de revirement (en apparence seulement) je décide d’entreprendre avec un copain, un projet de fou (coup de cœur insensé) : reconstruire une vieille maison de Rimouski, une des plus belles demeures de l’époque, et la transformer en une superbe Auberge-resto-bar, très tendance (mot honni aujourd’hui, s’il en est un, pour moi), et qui se terminera très mal. Je fais une fabuleuse faillite qui emporte tout avec elle... même ces triviales ambitions capitalistes (appelons un chat, un chat).
* (j’avais 40 ans) une autre fois, (coup de tête, réfléchi, fuite après ma faillite) quand je décide d’aller travailler en Coopération en Afrique (congé de deux ans, sans solde de l’université) avec cet espoir (non, cet engagement intérieur de découvrir une autre voie d’accès à la reconnaissance de moi par moi, de confirmation d’une voie d’avenir, d’une voie qui me permette de m’exprimer, et de cesser d’exister à droite et à gauche, pour être... enfin). Nouvelle désillusion ! Oui, certes, l’expérience m’a rendu encore plus humain, mais la cruelle désillusion vis-à-vis ce monde de la Coopération, si tendance à l’époque pour qui voulait se consacrer à œuvrer « réellement, émotivement, rigoureusement, concrètement surtout » au DÉVELOPPEMENT de pays en DÉVELOPPEMENT. Quelle blague que cet immense agence de voyage qu’est l’organisme gouvernemental ACDI, agence au service de l’aide « liée » aux entreprises canadiennes qui veulent exploiter le monde en développement pour mieux se développer elles-mêmes. Je me rappelle encore ces mots du V-P de mon employeur (firme d’ingénierie) qui se demandait, qui me demandait « pourquoi nous donnions tant d’argent à ces nègres (sic) », alors qu’il oubliait que cet argent prétendument donné aux nègres lui revenait en grande partie, à lui et à d’autres entreprises canadiennes, grâce à l’aide liée.
* (j’avais 45 ans) une autre fois, (coup de tête, serein) quand je décide de retourner aux études pour me parfaire mon éducation (et oui, après quelques années d’errance, j’avais un peu perdu pied avec mes connaissances de bases, en Finance, ou en gestion des Coopératives), alors, « let’s roll » comme disait l’autre qui est mort. C’était reparti, je quittais le Québec pour la France pour deux belles années, une d’étude, très sérieuse, je fait mon DEA et remet mon mémoire en dix mois. Je suis très sérieux, je suis très bien noté, 18/20, et me suis orienté, je dois le dire, vers une recherche éperdue de nouvelles connaissances, à travers de nouvelles lectures (de Orwell, à Sartre, en passant par Stevenson, Edgar Morin... et tant d’autres... jusqu’à aujourd’hui... Kertész, VLB... et tellement d’autres... je m’y perds, et j’en suis heureux...) jusqu’à ce que je tombe en amour avec cette région du Sud de la France...
* (j’avais 46 ans) et, cette autre fois, et oui, (coup de cœur) je suis toujours au Sud de la France, et avant même le terme de ces études de DEA, la deuxième année, abandonnant temporairement l’idée d’une thèse de doctorat, je me mets à restaurer un vieux mas, et oui, j’apprends un nouveau métier, celui de maçon, travailleur de la pierre, ce matériau qui va me ruiner une santé, mais si fabuleusement, que je sors de là aujourd’hui, (mais, j’y suis, et j’y reste), « grandi » par une œuvre que je ne cesse de compléter, de parfaire, de merveilleusement continuer, sans d’autre repère que cette « foi » (plus qu’une conviction) en quelque chose d’immatériel presque, qui est l’œuvre d’art de ma vie...
* (j’avais 59 ans) et une autre fois (coup de cœur et coup de tête), tout juste comme je prenais ma première année de retraite... je glisse une information à ma femme médecin qu’une ONG recherche un candidat pour un travail humanitaire dans un pays en développement. Elle me prend au sérieux, elle me rappelle au bout de quelques jours et me dit : j’ai trois offres – Palestine – Tchad – Cambodge. Je réponds sans aucune hésitation : CAMBODGE. Ce fut non seulement le début d’une nouvelle tranche de vie (toujours la fuite ? NON !), mais aussi la réalisation de deux ou trois petits projets qui me tenaient à cœur : 1- écrire ma thèse de doctorat, j’avais gardé toutes mes notes de recherche depuis quelques années, il ne restait qu’à bien écrire les conclusions que toute ma vie d’enseignant et de chercheur j’avais construites, accumulées, enrichies... et conservées en mémoire. 2– voyager vers Angkor et d’autres sites historiques, au Cambodge, et aussi au Vietnam, au Laos, en Chine... 3– puis, l’idée la plus intéressante pour moi, expérimenter un voyage de retour vers la France par la route seulement. Cela a donné 52 jours de voyage (train, autobus, ferries, motos... à pied), 2347 kilomètres, de Phnom Penh à Montpellier.
* Aujourd’hui à 68 ans, et cela depuis le retour du Cambodge, j’en suis à ma deuxième construction, voilà je restaure aujourd’hui un mas encore plus grand, et je suis toujours seul à y œuvrer... c’est un peu inimaginable, ou fou, comme le disent mes amis. Je ne comprends pas exactement ce qui m’a amené là, jusque là, et tout entièrement là, éternellement là... dans ce projet que je veux quand même achever (dix ans que j’y suis, retraité, et travaillant comme un fou, et oui)... pour prendre... sans doute l’an prochain une retraite de ma retraite... pour, une autre fois...
* il y aura...d’autres fois où je ferai d’autres choses... AMEN ! Mais j’oubliais...
* et oui, il y eu, j’oubliais celles-là, ces quatre fois... où j’ai quitté la femme que j’avais aimée, j’aimais. À chaque fois, ce fut un coup de tête, non un coup de cœur (j’entends, je n’avais aucune aventure en cours), c’était muri, je crois, pensé, réfléchi... Puis il y avait eu un déclic...
* et oui, il y eu, je n’oublie pas cette autre fois (j’avais 15 ans), quand j’ai quitté la maison familiale, pour le pensionnat... Ce fut le plus grand événement de ma vie. Enfin, je respirais... pas de curés, pas de religion, pas de famille... et, enfin, une porte de sortie de mon quotidien et de mon rôle d’étudiant modèle. Je me sentais emmuré dans une sorte de vie que je n’aimais pas. (J’aime me le rappeler, et j’en ris : j’étais un premier de classe, j’avais toujours été un premier de classe, et, tout à coup... à la fin du premier semestre en internat, je suis l’avant dernier de la classe. Mon père est choqué et m’offre de quitter l’école... et de me trouver un emploi).
Rien n’y fit, je venais de découvrir la VIE.
Fin de la parenthèse cœur-tête.
Melville un jour quitte l’Amérique pour Liverpool. Pourquoi ?
Je ne sais pas ; mais lui le savait... Déterminé par son sort, par une ambition cachée, par son destin, par une irrépressible conviction qu’ailleurs il trouverait, retrouverait peut-être le monde de son père... !? Son père avait vécu à Liverpool.
Un jour, Melville va inventer le capitaine Achab...
En attendant, il découvre la ville de Liverpool. Que de misère et que de pauvreté il côtoie, et quand il regarde les yeux de ces pauvres gens, « hagards », réclamant leur pitance... il comprend qu’il appartient à cette autre humanité, celle qu’il aimerait renier et dont il ne veut plus être... il voit déjà ce qu’il croit être, ce qu’il est, et ce qu’il ne veut plus être, soit « blanc » comme ces autres infâmes humains-blancs. Plus tard, inventant son capitaine Achab, il découvrira, quand il prendra véritablement la mer (sur un baleinier, pendant quatre années) la « sous-humanité » que représente le monde-nègre. Ces nègres, comment les voit-il ? Comme de grands demeurés, à l’air gai, ou, de sombres esclaves soumis à la force brutale et à la cruauté pure du monde des blancs-civilisés-sournois-exploiteurs-de-la-race-humaine ? Peu importe, il y a un peu de tout cela, je crois, quand je comprends ce que VLB livre des descriptions de nègres faites par (ce Dagoo à la démarche du lion, un dieu barbare qui pourrait se transformer en « tueur ») et des autres humains étrangers-non-Anglais-non-Américains-non-blancs (ces amérindiens, Tashetego et Quequeg, canibalesquement développés ; et aussi ces Grecs pour qui les armes étaient sacrés...).
Paraphrasant VLB, je me demande bien pourquoi j’écris tout cela. OUI. Surtout quand je vois qu’à la relecture du livre de VLB, je n’en suis qu’à la 103ième page d’un livre qui en compte 572. OUI, pourquoi ? Pourquoi tant de mots ? Je ne sais pas, mais je continue.
Enfin, Liverpool aura une fin. Melville rentrera chez lui, plus fauché et plus chômeur que jamais. Il enseignera, ne secrétera que de la petite vie, dans une solitude toujours immense... pendant encore trois années... jusqu’au jour où, mû par une sorte de violent sentiment intime, d’instinct irrépressible, – Melville avait épinglé cette phrase sur le mur de sa chambre : « N’émoussez pas votre cœur : enragez-le ». (Malcom dans Macbeth) -, il va quitter tout (sa famille, sa soeur Augusta surtout, son Amérique, sa défroque d’enseignant car il ne croit pas ce qu’il lit dans ses livres de classe) et s’embarquer sur un baleinier, pour quatre longues années. Melville ne se révolte pas, non, il est un gris personnage, il est indulgent envers les autres, et complaisant envers lui-même. Et pourtant, cette aventure va orienter tout le reste de sa vie, « provoquant l’œuvre et l’échec de l’œuvre », écrit VLB.
Première astuce littéraire de VLB : il part à la chasse de Melville.
Il imagine qu’il roule sur la route des Adirondacks, au volant d’une vieille Cadillac couleur rouge sang, il est dans un état second, il va interviewer Melville... rien de moins. Puis survient ce dialogue...
VLB : « Je m’excuse d’entrer comme ça dans votre monde... »
Melville : « Vous venez de Québec, je pense... Est-ce que vous saviez aussi que notre voyage de noces, à Lizzie et à moi, c’est à Montréal et à Québec que nous l’avons fait ? »
VLB : « Bien sûr... ce n’est pas tous les jours que des étrangers de votre qualité s’y arrêtent ».
Ce dialogue aurait pu intervenir aussi dans La Grande Tribu si VLB s’était avisé d’aller rencontrer Abraham Lincoln qui lui aussi s’était aventuré au Québec à l’époque, chez les Ontariens d’abord (qu’il avait trouvé cons) et chez les Québécois (qu’il avait trouvé sympathiques, chantant, de bonne humeur, et aimant s’amuser plutôt que de travailler tout le temps... au contraire des Angliches)
Puis, VLB entre dans une sorte de réciprocité avec Melville, qui l’appelle même Nathaniel (Hawthorne, son grand ami), une sorte de magie d’intimité... le rêve de VLB se poursuit... des rêves très intimes aussi... quand Melville partage son lit avec VLB... et son QUEQUEG de Mobby Dick, ce grand lion noir, presque tueur.
Le rêve est grand, VLB croit toujours qu’il va s’embarquer avec Melville sur le baleinier qui va les amener dans les mers du Sud. Oui, ils vont ensemble à Nantucket, d’où ils doivent embarquer... Mais Melville pense que le capitaine Achab ne devrait pas rencontrer tout de suite le biographe VLB...
« Il y a certaines entreprises pour lesquelles un désordre soigneux est la vraie méthode » (Herman Melville)
Bien sûr, VLB ne fera pas partie du voyage. Quand il se réveille-sort du rêve fou... VLB ressent une « pitoyable pesanteur au niveau de l’estomac »... comme s’il avait bu ; mais il a tout simplement trop écrit... une sorte de coma l’atteint-l’attend dans ce cas, à chaque fois.
Père lui prépare des œufs durs et du café... il le presse de se reposer, il a peur que VLB, comme il le lui dit, se remette au travail d’écriture sur Melville « comme un véritable mangoua : ces gens-là sciaient du bois, la sciotte dans une main et le sandwich dans l’autre. À quarante ans, ils étaient morts ». Mais VLB n’a jamais écrit autrement... et il a toujours honte de ce qu’il écrit... des mots qu’il juge indignes « de celui à qui je les adresse ». Il y a toujours cette timidité, cette retenue chez VLB, cette sorte de complaisant auto-mépris de ses mots et de ses écrits. Pourquoi ?
Je me sens d’autant plus timide, moi, que j’essaie de commenter les mots de VLB. Qui suis-je pour cela ?
Le projet de voyager sur un baleinier cache un autre projet : celui, pour Melville, d’écrire. Il a peur de faire rire de lui – il sait qu’il ne sait pas écrire, avoue-t-il -, et n’en parle alors qu’avec sa sœur Augusta, elle-même sceptique vis-à-vis ce projet. Mais le projet tient pour deux bonnes raisons : - un, il va écrire à partir de ce qu’il a vécu, - deux, il va lire énormément, et piller abondamment les livres de ceux qui l’ont précédé dans les mers du Sud (Sam Cook, La Pérouse, Bougainville...). Melville n’a jamais été un véritable marin, il détestait le travail et aimait les « doux plaisirs de la fainéantise ».
Deux récits de voyage inaugureront sa carrière littéraire (bien avant Moby Dick) : Taïpi et Omoo ou le vagabond du Pacifique. Dans cette partie de son livre, VLB prend prétexte de ces aventures racontées par Melville pour nous raconter d’autres grandes aventures dans les mers du Sud.
Telle celle de Bougainville, qui était obsédé par les bons sauvages dont il vante les mérites à la cour du roi... qui s’en moque bien évidemment. Qu’à cela ne tienne, Bougainville va décider d’agir seul, et, avec d’autres Canadiens français, va tenter – inutilement, ce sera un échec -, de fonder un « nouveau monde » aux Malouines ; puis il ira à Tahiti, un Paradis terrestre, dira-t-il, mais qu’il découvrira toutefois... peu amène, hostile, et aimant se livrer à des sacrifices humains.
Puis celle de James Cook...
Puis celle de La Pérouse...
Puis celle du célèbre Porter...
En fait, toutes ces aventures - c’est le prétexte qu’a choisi VLB -, comme celles que vivra Melville, racontent toutes la même histoire : le blanc apporte dans ces terres du Sud le pire de notre monde dit civilisé... alcool, maladies, dieu de pacotilles, moralisme débilitant... corruption infinie... et la MORT.
Ainsi, Melville, pas plus en Nouvelle Angleterre qu’à Nuku-Hiva, où il erra, « n’est arrivé à trouver un sens à sa vie ». Melville écrit : « Je sus que la civilisation apportée aux quelques naturels restants avait consisté à les transformer en chevaux de trait et leur évangélisation à en faire des bêtes de somme... On les a littéralement pliés aux traits et attelés comme des bêtes brutes aux véhicules de leurs éducateurs spirituels ». Bref, Melville ne pouvait croire à la civilisation blanche fondée sur le capital... il n’avait pas besoin de Karl Marx pour savoir cela.
Dans la poursuite de son Melville, VLB, qui passe des heures sur sa table de pommier, se sent maladroit, impuissant à dire le meilleur de Melville – « quelle niaiserie que mon écriture ! » -, d’autant que des images de sa propre vie (toute femme lui manque, à VLB) sont à l’image des propos de Melville qui n’a jamais bien su parler des femmes (ainsi, on perçoit cette naïveté lorsqu’il parle des yeux bleus de cette Faïawaï qui, lorsque « une émotion vive les illuminait, il s’en échappait un rayonnement d’étoile ». Melville se compare à un béotien, à quelqu’un qui ne sait rien – comment peut-il alors écrire, croît-il -, VLB se voit comme un pauvre gribouilleur qui noircit des pages sur Melville – est-ce pour ne pas sombrer dans la solitude, croît-il - ; ces deux écrivains ressassent sans arrêt leur incapacité singulière à écrire... et leur crainte de devenir comme « fou », oui, comme deux fous déambulant sur les quais de Harlem (dans ce rêve que VLB poursuit).
Mais Melville a écrit Taïpi (c’est le constat d’un échec, celui de cette industrie que l’homme blanc est pour lui-même et pour les autres), puis Omoo (les bon prêtres chrétiens jouent le grand jeu du pouvoir pour s’attirer les faveurs des nouveaux roi-nègres),
L’écriture de Melville progresse ; il intègre de plus en plus ses nombreux emprunts dans le corps de ses textes..., VLB dit de lui qu’il intuitionne peu à peu qu’il est en train d’accéder à un autre niveau d’écriture. Puis vint Mardi, ce livre énorme qu’il écrit « dans une spontanéité qui confine presque à l’innocence ». Pour VLB, Mardi « c’est tout à la fois l’Odyssée d’Homère, l’Énéide de Virgile, La Divine comédie de Dante, Le paradis perdu de Milton, Le Pantagruel de Rabelais et le Don Quichotte de Cervantes, c’est-à-dire une création totalisante dont l’écriture pose la vraie question : « le savoir peut-il se transformer en connaissance ? » Melville lui-même avoue, dans sa préface, qu’il essaie de voir, en écrivant ce pur roman d’aventures polynésiennes, « s’il ne serait pas possible que la fiction passât pour la vérité ». En fait, le livre est un acte profondément autobiographique... tout en étant véritablement le procès de la civilisation de son époque. VLB est dithyrambique à propos de ce livre, rien de moins...
« un ensemble inextricable parce que global, une queste passionnée qui confine au vertige et fait venir les seules vraies questions qu’un homme doit se poser : de quoi est constitué le monde ? Quels sont les principes qui le font agir ? Qu’y a-t-il de fondé dans le progrès ? Quel est le sens de l’histoire lorsqu’elle s’écrit avec un H majuscule ? Qu’en est-il de l’individu perdu dans ce maelström délirant ? N’est-il toujours qu’un esclave ... ? Qu’est-ce donc que la vérité et que signifie le simple fait de vivre ?
La vérité des réponses à ces questions, oui, la VÉRITÉ, se trouve peut-être dans cette parole d’un personnage du livre, Babbalanja : « La vérité se trouve dans les choses et non dans les mots ; la vérité est sans voix... ce qu’on nomme vulgairement des fictions contient tout autant de réalité qu’en découvre la pioche grossière de Dididi, le fouisseur de tranchées... la vérité ? cette question plus que toute réponse, est un point final ». Babbalanja ajoutera un peu plus loin : « Plus nous apprenons et plus nous désapprenons ». Et, plus loin encore, un des plus beaux morceaux de Mardi, au dire de VLB...
« Nous ne sommes que petits tas de sensations burlesques, nous jonglons avec nous-mêmes, nous nous escamotons. Nous voici air, vent, souffle, bulle... un rien, une chiquenaude ».
Suite à la lecture de ce texte de Melville, VLB, qui le commente, se rapetisse à nouveau...
« Je ne suis, face à Mardi, qu’un pauvre scribe sans envergure, condamné à la chronique – alors que c’est l’épopée que j’appelle, la création mythologique des pays québécois, ce qui n’a pas encore été écrit, mais qui ne demande qu’à l’être, qui est comme une furie au-dessus de Montréal-Nord et de tout ce qui fait que j’existe ».
Melville, quand il a écrit ce Mardi, avait trente ans, tout comme VLB quand il écrit ce livre, tout étonné de comprendre qu’il n’épuisera jamais ce livre qui n’a pas encore tout révélé... VLB se sent désespérément pris... par ce livre, sombrant je ne sais où, tellement qu’il ne sait plus, écrit-il, qui il est, ni de quoi il parle. Mais Melville n’est pas moins « fou » quand il écrit : « Tandis que j’écris, je pâlis, je tressaille au grincement de ma plume, ma couvées d’aigles fous me dévore et je voudrais renier mon audace ; mais un gantelet de fer serre ma main dans un étau et trace chaque lettre malgré moi ».
Mais moi ? Oui, Moi ? Qui suis-je écrivant, chroniquant, commentant ces deux auteurs ? Peu de mots me viennent et je crois bien que je erre, et que ma plume se fourvoie, d’autant que je... ; mais j’aime continuer de lire et relire ce texte de VLB qui, comme il le dit « avait sa vie propre », et qui me hante maintenant quand je continue d’écrire.
« Je m’appelle Herman Melville. Mettons. Au moment où nous en sommes, c’est l’année 1849 pour tout le monde. Mardi vient d’être publié et déjà je sais que ça ne sera pas un succès ».
C’est la nouvelle posture de VLB dans ce livre. Il est maintenant Melville qui écrit à Abel Beauchemin, son biographe capricieux, l’avatar de VLB, le narrateur de ce livre... suit alors une sorte de confession « imaginée » par VLB. Ainsi, à propos de Mardi, Melville écrit « À l’origine, je n’avais voulu écrire qu’un livre tout simple, mais c’est autre chose qui est venu, c’est-à-dire ma vie même ». C’est dans cette curieuse lettre que l’on retrouve cette assertion « Dieu a prédestiné notre race (les Américains), pour le bien du genre humain ». Je me demande encore pourquoi VLB a mis ces mots dans le texte confession de Melville...
Quand VLB revient avec son père...
...celui-ci lui dit que son frère, Jos, dit de VLB qu’il s’occupait de Melville parce qu’il voulait se donner du talent, ce à quoi VLB répond « rien d’autre que, sur ce point particulier, Jos a raison. De moi-même, je ne ferai jamais rien parce que je suis invertébré. C’est pourquoi j’admire par dessus tout, les tours de force. Écrire Moby Dick, c’en était un. Écrire Mardi, c’en était un autre ». Et ses histoires hallucinées d’écrivain raté se poursuivent... et puis, à un moment donné, il rappelle cette rencontre avec Jacques Ferron, un personnage qu’il met au-dessus de tout, « et qui l’a pris en main », et dont il buvait les paroles quand celui-ci venait le voir et lui parler, soliloquant gravement et le ramenant « à hauteur d’homme », comme il l’écrit. C’est Ferron qui lui recommanda de lire les textes de l’ami de Melville, Nathaniel Hawthorne, pour qui « le réel n’est plus que de l’imaginaire ».
Melville a de l’admiration pour son ami Hawthorne dont, vous ne pouvez, écrit-il, « connaître la grandeur par un examen ; vous n’en aurez aucune idée sauf par l’intuition ».
VLB poursuit son rêve au pays de Moby Dick... à Arrowhead... dans la maison où a vécu Melville, là où il y a cette fameuse et énorme cheminée qui occupe tout un mur (photo à l’appui dans le livre de VLB), et ce vivoir où Hawthorne et Melville ont conversé, et cette pièce là-haut, la plus importante, où Melville a travaillé, lui aussi, sur une table en pommier, écrivant son Moby Dick. Désormais, souligne VLB, Melville n’écrira plus « sans que, quelque part entre deux pages, n’intervienne Shakespeare ». Il est, pour Melville, le maître suprême qui, muselé pourtant – c’est l’époque Élisabéthaine, une époque sans liberté -, dans ce monde où la liberté est forcée de fuir, a pu dire la vérité sans la dire, « à la dérobée et par éclairs », dans des textes d’une violente passion (le Roi Lear, par exemple). La folie de Shakespeare inspire Melville dont les textes hantent VLB dans ce qu’il y a de fascinant dans le mal, et « dans ce qui fait qu’on se sente attiré par lui comme un papillon par la lumière ».
Tout le monde a lu Moby Dick. Moi, pas.
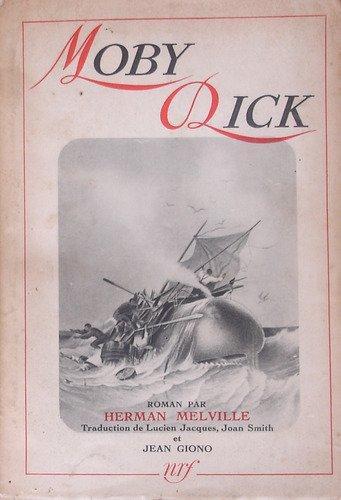
Je ne connais pas ce Ishmaël, ce père Mapple, ces Starbuck, Stubb et Falsk, ni ce ce héros tragique qu’est le capitaine Achab. Je les lirai bientôt tant mon envie est grande de voir, dans les descriptions de Melville, ce « prolétariat cosmopolite, le grand troupeau aveugle », et, pour la démocratie américaine, cette masse indifférenciée – à peine lui permet-on de rêver -, qui n’a aucun pouvoir sauf celui de sa force de travail, « aussi bien dire presque rien ».
Je retiens ce commentaire de VLB : « Je défie quiconque de lire le chapitre quarante-troisième de Moby Dick sans en être bouleversé et fasciné ».
La suite est mon début. Le chapitre 3 du livre de VLB, à la page 367, titre : « Monsieur Melville. L’après Moby Dick ou la souveraine poésie ».
Et dans l’entrée en matière de ce chapitre, VLB choisi de nous parler de la traduction de Moby Dick écrite par Giono, la seule valable à ses yeux, et de cette « belle », toute « simple », histoire d’amour que Melville a vécue avec une dame appelée Adelina White et qui s’est terminée quand celle-ci, malade, est décédée avant de ne pourvoir lire Moby Dick. Pourquoi raconter cela ? Je le fais parce que VLB l’a fait, et parce que cette histoire, toujours selon Giono, a eu une influence démesurée dans l’écriture et dans la vie littéraire de Melville. À ce sujet, Giono raconte que Nathaniel Hawthorne, qui trouvait son ami Melville malheureux au lendemain de la publication de Moby Dick (pourtant un succès de librairie) lui en avait demandé la raison. Et Melville lui avait répondu :
« Mais comme livre, comme objet créé, non, ça n’a pas d’existence (j’allais écrire pas d’importance ; je crois même que cela revient au même). J’ai été dégoûté après Moby Dick. Ce livre dans le quel je suis allé carrément, tout entier, d’un seul coup, eh bien, il est arrivé en retard ». Et oui, en retard d’une lecture par la femme aimée. Je trouve cela incroyable. Giono ajoute : « Melville mourra après trente-quatre ans de silence ». C’est la théorie de Giono : « on écrie un grand livre pour un seul lecteur ». Mais... VLB n’est pas d’accord sur ce point avec Giono. Mais moi... j’aime bien les fables... et celle-ci en particulier. Pour VLB, Melville était plutôt désabusé, et se voyait acculé à une sorte de mur et... dans l’impossibilité d’arriver à la connaissance ( ?). Pour lui, le Melville de Moby Dick était mort, et un autre Melville allait naître, celui de la poésie, une fois écrit Pierre, avec un « il », plutôt qu’un « je », parce qu’il veut indiquer la distanciation qu’il veut prendre vis-à-vis de lui-même (c’est dans ce livre qu’il révèle sa double vie incestueuse, avec sa mère, avec sa soeur). « Par le personnage de Pierre, c’est Melville lui-même qui s’interroge, qui essaie d’appréhender son propre mystère », écrit VLB, et surtout quand Melville, poussé à l’extrême limite de son questionnement, dit de son narrateur : « Finalement il reçut une terrible intimation intérieure, l’intimation de s’arrêter, de suspendre sa lutte contre nature ». La fin de cet invraisemblable roman ? La Mort ? Oui, celle des personnages.
La suite ? Melville a trente-cinq ans, « il va rendre ses enfants à leurs grosseurs ».
Il va écrire – il veut faire vivre bien sa famille, il accepte un poste d’inspecteur des douanes -, il va définitivement abandonner la prose pour la poésie, une démarche qui fascine VLB, car écrit-il, Melville renverse les données traditionnelles de l’écriture (on va plutôt de la poésie vers la prose).
Melville écrit d’abord Bartléby l’écrivain. Un authentique chef-d’œuvre pour VLB. Chacun se souvient sans doute de cette phrase sublime, sinon célèbre: « I would prefer not to », une phrase qui va obséder le patron de Bartélby, une phrase qui m’envoute personnellement dans ce qu’elle a d’irrationnel. Je pense alors au « je t’aime, moi non plus » de Gainsbourg... j’aime ces mots qui nous amènent « plus loin que moins ». Bien sûr, Bartélby aimerait faire autre chose. Mais quoi ? Tout le mystère est là. Ce langage-silence, comme l’écrit VLB, rendrait fou, si on s’y arrêtait trop. Non ? Ou est-ce tout simplement ce que vivait Melville à l’époque ? C’est-à-dire, sa vie, toute sa vie, « rien de plus que cette fureur de connaissance, de toute la connaissance » ? Pourquoi faudrait-il alors résoudre cette équation posée dans la phrase de Bartélby ? Ainsi, moi, auteur imaginé, pourquoi essaierai-je de « résoudre le problème des contraires qu’il y a en moi » ? Oui, pourquoi ? Et c’est bien de cela qu’il s’agit quand je m’obstine à être ce que je ne suis pas, et que pourtant j’aimerais être (I would prefer to be), un auteur-écrivain ? Je suis obsédé par la lancinante musique du « I would prefer not ».
Puis, Melville écrira encore bien d’autres livres, dont Les îles enchantées et Benito Cereno, deux autres authentiques chefs-d’œuvre.
La suite de mon commentaire ? Je m’arrête là. Autrement, il faut revoir le début !
Et pour moi-même... je comprends que...
...lire un livre, c’est comme aller au théâtre, c’est demander qu’apparaisse « quelque chose de plus réel que ce que la vie réelle peut offrir ». Mais il n’y a pas plus de cohérence dans la fiction que dans la vie. Comment alors distinguer l’une de l’autre ? Ce n’est pas trop possible, à mon avis... non ? Pour Melville, « aucun homme ne peut posséder une expérience à la mesure de tout ce qui est (souligné par lui), on serait peut-être mal avisé de s’en remettre à elle dans chaque cas ». Voilà sans doute pourquoi la lecture me passionne tant, que je lise bien, ou que je lise mal, que j’entende bien ou que j’entende mal, que je comprenne bien ou que je comprenne mal... les mots, la langue écrite, les raisons et sentiments exprimés, je ne m’en soucie guère. Déjà, j’ai amalgamé les mots à ma vie et fait aussi l’inverse. Je me suis depuis longtemps DonQuichotétisé, j’expérimente, je n’arrête pas d’expérimenter, et je me porte assez bien, avec d’incommensurables incongruités et incohérences parfois, en ce qui a trait à ce que je comprends de la vie.
