Avec cette première année passée totalement à l'étranger, à cheval entre deux pays (Nouvelle-Zélande et Australie), difficile d'avoir le même accès aux sorties telles que programmées en France. On propose donc un top encore plus disparate et hétérogène qu'à l'accoutumée, fait de ces moments de cinéma qu'on aura réussi à attraper. J'ai raté tellement de films (il y a des oublis indécents - Tarantino, Malick, Bigelow, PTA, Linklater) que je revisiterai ce top dans le futur ; en attendant le décompte est seulement là pour se faire plaisir. Il faut aussi en profiter pour relever l'incroyable présence et diversité des personnages féminins dans les meilleurs films de l'année, signe des temps sans doute...
11. John Dies at the End, de Don Coscarelli
 On avait laissé Don Coscarelli en 2002 avec son joli Bubba Ho-Tep où l'on apprenait que Elvis et JFK ne sont pas morts, ils combattent une momie dans une maison de retraite - true story. Mais je m'égare. Seul signe d'activité du réal depuis, un épisode de l'anthologie Masters of Horrors en 2005. Depuis, plus rien.
On avait laissé Don Coscarelli en 2002 avec son joli Bubba Ho-Tep où l'on apprenait que Elvis et JFK ne sont pas morts, ils combattent une momie dans une maison de retraite - true story. Mais je m'égare. Seul signe d'activité du réal depuis, un épisode de l'anthologie Masters of Horrors en 2005. Depuis, plus rien. Puis déboule John dies at the end, financé de façon indépendante, car on imagine mal le réalisateur débouler chez les studios, pitcher son script taré de drogue envoyant ses usagers à travers le temps et les dimensions. C'est un film bien monté, bien filmé, il est presque surprenant de revoir Don Coscarelli dans un film qui pète autant le feu, avec des concepts et des intrigues incroyables, qui auraient certainement mérité d'être mieux encadrés. Dans son humour et son rythme, le film rappelle parfois Detention de Joseph Khan, qui n'est pas le meilleur ami des critiques - sauf ici. Et Coscarelli fait appel à un humour de plus en plus navrant à mesure de son développement, pourtant, l'atmosphère est exemplaire : il s'y développe une empreinte à la bizarrerie assez originale et subtilement paranoïaque, un peu comme dans le They Live de Carpenter. Le film rappelle aussi volontiers le Cronenberg du Festin Nu ou de Existenz, avec ses lueurs blafardes de néons et de diners pourris et abandonnés. C'est un parent congénital dont on ne sait pas quoi faire, mais qui intrigue. Le récit s'empêtre malheureusement dans de l'incrustation hasardeuse et des péripéties tellement grand-guignolesques qu'il en perd toute lucidité dans son dernier acte, mais le film a cette envie d'aller au-delà du pitch, du rythme, du montage, de créer sa propre narration, bref, il est étrange, imparfait et passionnant.Sorti en France indéterminée (probablement jamais).
10. Pacific Rim, de Guillermo Del Toro

Le blockbuster de l'année si on ne s'en contente que d'un. La déférence de fanboy inégalée et des idées de mise en scène bluffantes, toutes au service d'une jouissance régressive. Le film-concept de Del Toro se tient totalement et demande absolument de laisser tout cynisme à l'entrée de la salle. Les vrais savent. L'avis en entier ici.
Aussi considérés : Star Trek Into Darkness pour son côté fun et immédiat, Man of Steel pour son What if? assez gênant et Kevin Costner, Iron Man 3 pour sa verve totalement outrancière et son final incluant Pepper Potts.
Pas vu : The Lone Ranger, dont j'entends pourtant de très bonnes choses.
9. Frances Ha, de Noah Baumbach

C'est l'année du jeune adulte paumé ; ils sont partout et certains sont plus intéressants que d'autres. Frances Ha est indéniablement fascinante. Tourné en noir et blanc dans cet espèce de grain particulier, celui des souvenirs et peut-être de la mélancolie, le film suit Frances, 27 ans, pas vraiment mâture et en tous cas, aux choix indéfinis. Elle vit avec sa meilleure amie, Sophie, qui n'éprouve en fin de compte pas le même attachement qu'elle quant à leur amitié - elle souhaite aller de l'avant en s'engageant dans une vie d'adulte, ce qui est aussi perçu comme une trahison.
Entre petites déceptions et fausses opportunités, le personnage tente d'avancer sans toutefois prendre les bonnes décisions. Et c'est parce que ce personnage est tellement vrai qu'on accepte toutes ces fantaisies : difficile de résister aux dialogues crues entre copines, à ces saynètes foirées de discussions embarrassantes, aux coups de têtes et autres petits jobs pour survivre. Les personnages ont tous leurs défauts et n'en sont pas vraiment conscients ; Sophie comme Frances ont des failles (des côtés égoïstes exacerbés) mais le processus de maturité, de se trouver et de décider de ce qui est bon pour soi n'arrive pas du jour au lendemain. Et c'est précisément parce qu'il n'essaie pas tant d'être malin qu'il l'est très naturellement, que le film de Noah Baumbach est aussi agréable à regarder, avec son atmosphère si particulière dans laquelle se lover.
Le film trouve au passage l'illustration la plus parfaite pour le Modern Love de David Bowie : une jeune fille un peu paumée, qui court et danse dans la rue.
8. Short Term 12, de Destin Cretton
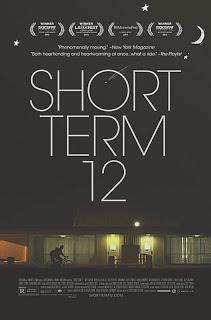
Cela fait maintenant des années que je clame à qui veut l'entendre que Brie Larson est une grande actrice, et malheureusement l'annulation de la série United States of Tara trois ans auparavant ne lui a pas offert depuis de rôles substantiels, susceptibles de le prouver. C'est maintenant chose faite avec le rôle d'éducatrice qu'elle tient dans Short Term 12, où le personnage de Grace lutte au quotidien auprès d'enfants défavorisés pour leur offrir un foyer temporaire. Sans être trop forcé, le film est poignant et émouvant, avec un passage en revue d'un certain spectre de l'émotion humaine (on s'y brise le cœur comme on y trouve l'inspiration), témoigne de la détresse de ses pensionnaires, revisite la lutte infini contre les éléments et l'investissement personnel de jeunes adultes paumés incapables car trop humains, de se détacher de leurs protégés. Un petit film miraculeux porté à bout de bras par Brie Larson et tout un casting de jeunes premiers.
Sortie en France en avril 2014.
7. Silver Linings Playbook + American Hustle, de David O. Russell

Oui, je sais, c'est triché mais cette année nous a offert deux films de David O. Russell et comment dire, ce fut un plaisir. Dans le premier film, honteusement renommé Happiness Therapy "en français", l'intrigue est classique, mais l'exécution est parfaite. David O. Russell aime les récits de personnages et ça se voit : il offre à Bradley Cooper un premier rôle de haut vol, s'empare du prodige Jennifer Lawrence et la régule parfaitement. Le reste est à l'avenant, classique mais touchant avec des séquences de dialogues ultra-dynamiques : cette année, on a pas vu meilleur metteur en scène de brouhaha, agençant ses dialogues jetés à l'écran avec un sens parfait du rythme, gérant ses acteurs avec minutie et obtenant d'eux exactement ce qu'il veut.
American Hustle est aussi un gros film d'acteurs et de personnages, déguisé sous la reconstitution d'un New Jersey des années 70. Et attention les yeux, on croit assister un moment à un enfant monstrueux né des amours sordides de ce qui se faisait de mieux dans ses années folles. Christian Bale s'est détruit la santé pour le rôle, Bradley Cooper en fait des caisses (et ça passe), Amy Adams (partout en 2013) est phénoménale et Jennifer Lawrence compose un monstre bipolaire passionnant (vous l'aurez lu ici en premier : l'année prochaine, tout le monde parlera d'une certaine séquence rythmé par le Live and Let Die de Paul McCartney & the Wings). Chacun des membres du casting a droit en bonus à son petit moment capillaire très cocasse.
Le film tire un peu sur la corde mais un humour bizarre et constant rallie tous ses personnages et les situations, une constante incroyable vu ce qu'il se passe à l'écran, entre swag vintage incongrue, relations fusionnelles entre personnages paumés et ce désir brûlant qui guide tout un chacun, dans les errances et les doutes. Les reprises de chansons connues qui parsèment le film sonnent comme un écho aux arnaques du couple Adams/Bale et rappellent brièvement cette ligne de Jarvis Cocker : "A bad cover version of love / is not the real thing".
David O. Russell est un putain de romantique !
Sortie française le 5 février prochain.
6. Spring Breakers, de Harmony Korine

Le film qui prend totalement à revers. Ses "héroïnes" sont détestables et il faut un moment pour véritablement s'accrocher et se demander ce qu'on fait devant ce qui nous rappelle le Piranha de Alexandre Aja, mais tout le sujet du film est ailleurs. Entre ballade gangsta, porno soft, fantasmes consumériste et peinture outrancière de l'American way, Harmony Korine adresse un monumental doigt d'honneur à l'industrie et réalise un film plein de substance, à tous les niveaux, avec des séquences incroyables.
5. Only God Forgives, de Nicolas Winding Refn
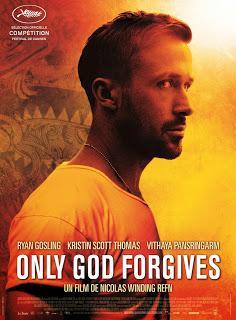
(This one's for you, Raffi)
Mon binôme de séance a détesté, j'ai beaucoup aimé ; avec Nicolas Winding Refn, tous les points de vue se valent. Kristin Scott Thomas est incroyable (sa première apparition est mémorable) et malgré les détours que le film prend, il y a une sublime envie de se perdre dans les néons chauds de cette ville anonyme. Toute la hype autour du film a fait oublier que Ryan Gosling n'est pas le héros du film mais bien celui qui lui court après, un policier du genre intraitable, luttant à son niveau contre la corruption et l'injustice. Sur les pas de Jodorowsky, Refn est hypnotique.
 4. Stocker, de Park Chan-Wook
4. Stocker, de Park Chan-Wook"I wear my father's belt tied around my mother's blouse, and shoes which are from my uncle"L'unité familiale en prend une nouvelle fois pour son grade chez Park Chan-Wook, qui n'en finit pas de polir le vernis rayé de son portrait de famille (d'autant plus sur la superbe affiche américaine). Certains n'apprécient pas l'exercice de style, mais pour sa première réalisation américaine, le réalisateur a réussi à se distinguer du reste des réalisateurs tentant leur chance à l'étranger avec un style bien particulier, sans se faire absorber par la masse du tout-venant habituel. Stoker est plastiquement éblouissant dans sa construction et reste suffisamment intriguant pendant toute sa durée pour maintenir un intérêt palpable quant aux enjeux qui se mettent très doucement en place : à vrai dire, le fantôme de L'Ombre d'un doute (1943) de Hitchcock se fait de plus en plus pressant à mesure que le glacial Matthew Goode pénètre l'intimité de la famille de son défunt frère et même si l'on estime l'hommage déplacé, on a vu pire modèle. Totalement ludique car réalisé avec un plaisir communicatif et une envie constante de traduire à l'écran les tumultes de ses personnages grâce à des permutations des intrigues et des espaces-temps, le film est aidé d'une mise en scène qui tente tout (décadrages et gros plans, énorme travail sur le son), racontant la parte de l'innocence et le passage à l'âge adulte d'un être très particulier.
Mia Wasikowska est incroyable d'intensité dans un rôle de fille marginale proche de celui qu'elle campait dans Restless de Gus Van Sant ; il est à vrai dire difficile d'imaginer un talent aussi protéiforme chez une "débutante" aussi jeune. Loin de se laisser impressionner par les thèmes très inquiétants du scénario, elle déploie des trésors de jeu pour laisser transpirer toute l’ambiguïté du rôle et les nuances de gris l'animant. La place du spectateur devient quasiment gênant dès lors qu'on s'intéresse à la jeune fille, témoin qu'on est du moindre de ses émois.
Cette élévation se fait au détriment de Nicole Kidman (ici volontairement en retrait), qui semble jouer son rôle d'actrice engoncée dans le souvenir de ses vertes années après lesquelles elle court toujours ; son rôle de mère émotionnellement instable va dans le même sens où Mia Wasikowska supplante Kidman sur tous les plans, semblant annoncer un changement d'ordre.Stoker est un beau film formaliste et cadré, qui permet à Park Chan-Wook de canaliser une partie de sa douce folie et de donner par ses cadres, une profondeur inattendue à un récit parfois boiteux, mais qui ne cesse jamais d'être entêtant et magnétique dans le doux souvenir qu'on en garde.
3. Gravity, de Alfonso Cuaron
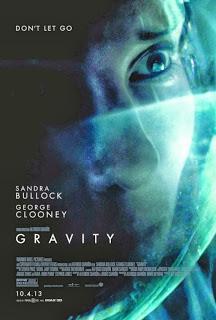
Assisté d'une technologie de pointe ahurissante, Cuarón arrive en une poignée de plans à nous introduire à son concept de haute-voltige, et nous démontre comme la vie dans l'espace est inhospitalière. Mais le réalisateur a encore beaucoup de choses à nous montrer, et cette entrée en la matière en forme de plan-séquence de 12 minutes (qui introduit ses personnages et sa situation) est un sommet du genre, un tour de force, en somme, une sacrée séquence dont on reparlera pendant encore des années. Le reste du film est à l'avenant, si on s'autorise un symbolisme parfois exagéré.
L'avis en entier ici.
2. Blue Jasmine, de Woody Allen

Très immédiatement, le personnage de Cate Blanchett n'apparaît pas comme une héroïne à laquelle on aimerait se rattacher en tant que spectateur. Woody Allen développe une structure solide, dont il s'écarte uniquement pour conter les aventures extravagantes de ses personnages secondaires, et ce faisant, influe directement sur notre ressenti pour Jasmine. Elle n'est pas à proprement parler un personnage qu'on apprend à vraiment aimer, mais elle évolue tellement grâce à la structure à rebours qu'elle en devient tout simplement désarmante dans la solitude développée et l'impasse décrite à longueur de scènes.
Le procédé est classique, et on pourrait aisément reprocher au réalisateur cet effet de petit malin, mais le gimmick fait sens dans la narration, brisant continuellement le rythme des saynètes par l'instruction d'un humour ou d'une rupture de ton toujours plus osés : Woody Allen bat le chaud et le froid avec une agilité qui laisse pantois. Au moyen d'une comédie très efficace où s'affiche en filigrane des airs de tragédie si brutale qu'elle en devient extrêmement douloureuse à gérer psychologiquement pour le spectateur, Cate Blanchett et Sally Hawkins souffrent et vivent, se prennent le bec avec des bons mots qui font mouche. Le double niveau de lecture est incroyable d'efficacité : à 10 secondes de la fin, certains rient encore avant que ne s'installe un malaise perturbant qui ne lâche plus. La tragédie intrinsèquement liée à Jasmine ne trouve pas de répit et ne pouvait s'achever que dans la lente aliénation de son propre personnage (le vrai, derrière les faux-semblants) esseulé et errant dans les rues.
Blue Jasmine est un crève-cœur caché sous des airs de comédie.
1. Upstream Color, de Shane Carruth

Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais c'était merveilleux. Une expérience sensorielle incroyable à ranger à côté des Malick, à éplucher et à décortiquer à l'infini comme ici.
Le premier quart d'heure est possiblement l'un des morceaux de pellicule les plus intriguants de l'année, avenant et repoussant, une énigme à plusieurs niveaux. Comme son prédécesseur (Primer - 2009), Upstream Color est un objet terriblement abstrait qui offre malgré tout une jouissance de visionnage sans pareil. Shane Carruth repense le média par ses idées, son écriture et un sens du montage unique (et il est sur tous les fronts, du scénario à la composition du score). Les acteurs (dont le réalisateur fait aussi partie) offrent une performance sublime (Amy Seimetz est électrique) et le film hante l'esprit de façon tenace pendant très longtemps. Une expérience hautement recommandée, aux effets formels tous plus beaux les uns que les autres, dégageant de son récit une perspective de narration sensible et sublime.
Sortie en France encore indéterminée mais en rotation lourde ici dans le parc art-et-essai !
L'horreur de l'année : Trance, le scandale. Merci Danny Boyle.Pas encore sorti ici-bas : La Vie d'Adèle, la Grande Beauté, To the wonder, Cloud Atlas (jamais?), 12 years a slave, Nebraska, Inside Llewyn Davis, The Wolf of Wall Street, Her, Like Someone in Love, The Act of Killing, The Immigrant. 2014 s'annonce à la fois belle et inquiétante, dans tous les cas, on a hâte !

