On a bien retrouvé, dans ce cru 2013 du PIFFF, la patte du directeur artistique du festival, Fausto Fasulo, désireux de mettre en lumière le genre fantastique dans toute sa diversité, toute sa richesse.
Rien que pour la section compétitive, on a eu : un drame intimiste sur la mort, un buddy movie sur fond d’apocalypse zombie, les rapports curieux d’un homme avec son ours en peluche, un délire autour de cheerleaders voraces, un médium qui doit déjouer les plans d’un mass-murderer, un film de SF/de fantômes/de monstre qui n’est finalement rien de tout cela, un trip sensoriel dans la tête d’un tueur, et une critique sociale au vitriol du système capitaliste américain…
Mais, à la différence de l’an passé, la sélection était d’un bien meilleur niveau, proposant des oeuvres plus abouties, plus intéressantes sur le fond comme sur la forme.
Voici nos critiques des différents films en compétition, sauf Animals, de l’espagnol Marçal Forés, que nous avons hélas raté (ou pas, selon l’avis cinglant de quelques confrères…)
_______________________________________________________________________________
“Love eternal” de Brendan Muldowney
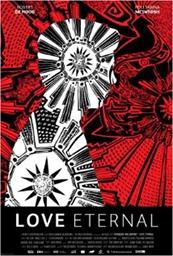
On y suit un jeune homme, Ian (Robert De Hoog), obsédé par la mort et le suicide.
Traumatisé par la découverte du corps d’une jeune fille de son âge, pendue dans la forêt, le garçon s’était replié sur lui-même et vivait cloîtré chez lui, juste protégé par sa mère. A la mort de cette dernière, Ian se retrouve livré à lui-même, seul et déprimé. Il décide de se supprimer, mais, alors qu’il est sur le point de commettre l’irréparable, il assiste au suicide d’une jeune femme qui a eu la même idée que lui. Troublé par la beauté de la jeune femme et ému par sa lettre de suicide, il décide de revivre la même expérience en accompagnant de jeunes femmes dépressives et en les aidant à réussir leur suicide. Notamment la belle Naomi (Pollyanna McIntosh), une femme dévastée par la perte d’un enfant.
C’est de cette façon qu’il finira, enfin, par retrouver un rapport normal aux choses qui l’entourent, et à reprendre sa vie en main.
Le film n’est pas un vrai film fantastique. C’est juste une variation autour du thème du deuil et du passage à l’âge adulte, une fable morbide qui peut s’apprécier en tant que telle, à condition de supporter le rythme de l’oeuvre, lent et indolent, et l’ambiance dépressive qui s’en dégage. Ce qui, disons-le tout de suite, n’est pas une mince affaire…
On n’en gardera probablement pas un souvenir éternel. A peine nous rappellerons-nous du regard de chien battu du comédien principal, Robert De Hoog et de la belle présence de sa partenaire, Pollyanna McIntosh (déjà remarquée dans The Woman de Lucky McKee).
Notre note : ●●●○○○
_______________________________________________________________________________
“The Battery” de Jeremy Gardner

Tout simplement en concentrant l’action exclusivement l’action sur le quotidien de deux personnages, survivants de l’infection zombiesque, entre recherche d’eau potable, de vivres et d’endroits sûrs pour y passer la nuit. Et en faisant se dérouler l’intrigue dans la campagne profonde ou les sous-bois, en tout cas dans un endroit à faible densité de population où, c’est statistique, on a moins de chance de tomber nez-à-nez avec un mort-vivant enragé qu’à New-York ou Los Angeles. C’est pratique. Pas besoin de nombreux décors, pas besoin de nombreux figurants pour jouer les cohortes de zombies, pas de budget monstrueux alloué aux maquillages et effets spéciaux…
Il fallait y penser…
Cette idée, c’est Jeremy Gardner qui l’a eue. Le cinéaste – qui joue aussi l’un des deux rôles principaux du film, signe une oeuvre profondément atypique, qui se distingue des nombreux films d’infectés qui ont été produits ces dernières années. La présence de zombies, ici, est presque anecdotique. Ce dont traite le film, c’est de la façon dont les hommes tentent de s’organiser après l’apocalypse. Il faut économiser les vivres, l’énergie, les munitions, trouver des abris de fortunes où on peut se reposer sans risquer de se faire croquer par un enragé. Il faut aussi essayer d’entretenir l’illusion d’une vie normale, pour ne pas perdre complètement la boule, et se raccrocher à tout contact humain, pour ne pas crever de solitude.
Ben (Gardner) et Mickey (Adam Cronheim) n’étaient pas amis avant cette invasion de zombies. Juste deux joueurs de baseball évoluant dans la même équipe, mais se connaissant à peine. Ils ont été assiégés pendant trois mois quand l’épidémie a débuté, et ont finalement réussi à fuir. Depuis, ils parcourent les routes ensemble, de façon à éviter les morts-vivants. Ils ont des caractères radicalement opposés, le premier étant plutôt heureux de pouvoir vivre en pleine nature, loin de tout, le second, plus fragile, refusant cette vie d’errance loin de tout autre contact humain. Ils ont parfois du mal à se supporter, mais ils n’ont plus personne d’autre à qui parler dans ce monde désert, juste peuplé par des morts-vivants pas très causants et quelques survivants illuminés, guère plus diserts.
Le récit étant plutôt chiche en action spectaculaire et en attaque de monstres, on a tout le temps de s’attacher aux personnages et à leurs considérations philosophiques sur le sens de l’existence dans un monde dévasté. Il en ressort un film de zombies “zen” et solaire, surprenant.
Le seul moment de suspense que s’autorise le cinéaste correspond à la fin du film, quand les deux héros se retrouvent piégés dans leur véhicule, encerclés par des morts-vivants furibards. Là aussi, le cinéaste compense son manque de moyens par un sens de la mise en scène intéressant. Toujours focalisé sur ses deux héros, il montre le temps qui s’écoule dans l’habitacle de la voiture, les vivres et l’eau qui s’amenuisent de jour en jour, et la tension et la peur qui, à l’inverse, grimpent en flèche. La scène dure, s’éternise au-delà du supportable, jouant avec les nerfs des héros et ceux des spectateurs.
Derrière son physique de nounours barbu hirsute et rigolard, entre Zach Galifianakis et Evan Glodell, Jeremy Gardner est un vrai cinéaste, inspiré et sensible. Et très drôle, comme le prouve la vidéo qu’il a tournée pour le public du PIFFF, où il se débat pour faire passer son message en français et en anglais.
On espère que son film, qui se forge une petite réputation de festival en festival, trouvera son public et lui permettra de financer d’autres projets aussi intéressants que celui-ci, avec un budget un peu plus confortable.
Notre note : ●●●●○○
_______________________________________________________________________________
“All cheerleaders die” de Lucky McKee et Chris Siverston

Prenez une demi-douzaine de jeunes pom-pom girls affriolantes. Choisissez-les bien sexy, un assortiment de blondes et de brunes aux visages craquants et aux formes généreuses. Ajoutez à peu près le même nombre de sportifs crétins, obsédés sexuels et fêtards invétérés. Choisissez un assortiment bien représentatif de la population mâle des campus de l’oncle Sam : un capitaine black musclé, un quaterback blondinet bien bâti, un brouteur de gazon, un fumeur de moquette…
Pour commencer, cassez une pom-pom. Poum! La tête éclatée lors d’une figure périlleuse mal exécutée. Remplacez-la par une fille canon aux motivations troubles. Saupoudrez d’histoires de coeur adolescentes et de manipulations perverses destinées à assouvir une vengeance amoureuse. Epicez de quelques chastes baisers lesbiens.
Jusque-là, le soufflé monte tranquillement, mais est aussi fantastique qu’un épisode de “Beverly Hills” ou “Dawson”.
Faites basculer le récit en faisant grimper l’érotomètre, puis la tension d’un cran. Une coucherie entre filles, une dispute avec ces messieurs, pas très contents d’être les dindons de la farce, des coups échangés, puis une poursuite en voiture qui s’achève au fond de la rivière, avec le décès de quatre donzelles.
Rassurez-vous, on ne va pas les laisser là, ce serait gâcher…
Prenez une sorcière wicca, bien gothique, avec piercings et maquillage de raton-laveur, qui passe son temps à jouer avec une poignée de pierres colorées. Faites lui dire une incantation qui redonne vie aux belles cheerleaders, mais les condamne à devenir des sortes de vampires, ne régénérant leur beauté qu’en consommant du sang humain.
A partir de là, remettez en contact les pom-pom girls avec leurs bourreaux. Mixez le tout dans un déluge d’effets spéciaux ringards, dont vous aurez pris soin de les détourner du regard des spectateurs en dévoilant les charmes des demoiselles.
Vous pouvez vous occuper du glaçage et de la finition : un dénouement complètement foireux dans un cimetière, et, cerise sur le gâteau, un ultime rebondissement absurde annonçant une deuxième partie…
Voilà, la recette parfaite d’un joyeux foutoir. Certains estimeront cela assez appréciable, avec son petit fumet de dixième degré jouissif, raillant les clichés des films de campus US. D’autres trouveront que l’ensemble a un petit goût de navet assez décevant.
Il est vrai que si Lucky McKee et Chris Siverston avaient fait illusion avec May et The Lost, leurs premiers films respectifs, ils peinent aujourd’hui à confirmer. Après les échecs de The Woman et I know who killed me, ils tentent un retour aux sources avec un petit film, remake, en plus pro, de leur oeuvre de jeunesse. Pas sûr que ce All Cheerleaders die les aide vraiment à remonter la pente et à leur donner accès à des oeuvres plus ambitieuses… Mais c’est un “petit” film de festival délirant et sexy, qui se laisse regarder, comme on dit…
Notre note : ●●●○○○
_______________________________________________________________________________
”Odd Thomas” de Stephen Sommers

Enfin “petite”, c’est vite dit… Le budget de 27 M$ reste quand même confortable et permet au cinéaste de s’offrir quelques effets visuels dignes d’un blockbuster. Quelques explosions, des apparitions spectrales, deux ou trois effets gore-soft… Et surtout, l’animation des bodachs (Tiens, voilà du bodach… Hum… pardon), d’impressionnantes créatures fantomatiques translucides attirées par la perspective du carnage, que seul Odd Thomas est capable de percevoir. C’est amplement suffisant pour en mettre plein les yeux au spectateur. Et cela laisse plus de marge de manoeuvre au cinéaste pour développer son récit et ses personnages, pour notre plus grand plaisir.
Le héros, déjà, est attachant. Odd Thomas (Anton Yelchin) est un as des fourneaux, capable de faire sauter des pancake d’une main et de dresser un hamburger de l’autre. C’est aussi un médium surdoué. Les fantômes viennent fréquemment lui demander de l’aide pour coincer leur meurtrier, ce qui agace prodigieusement son père (Willem Dafoe), flic à l’esprit très cartésien. Le jour où il s’aperçoit que les bodachs s’accumulent dans le sillage d’un type étrange, Robert Robertson, il comprend que quelque chose d’horrible va avoir lieu et que cet homme y sera mêlé. Il décide donc de mener son enquête, soutenu par sa petite amie, Stormy (la craquante Addison Timlin). Mais le temps presse. Car s’il a bien senti l’imminence du drame, il ne sait ni quand, ni où, ni comment il va avoir lieu.
Le scénario, plutôt bien mené, alterne péripéties surnaturelles et jolis moments d’humour. C’est du fantastique plutôt “familial”, malgré les quelques macabres découvertes qui jalonnent l’enquête. Le ton est plutôt léger et délicatement sucré, à l’instar des glaces concoctées par la belle Stormy, si bien que la fin du film, prenant tout le monde à contrepied, s’avère assez surprenant. Comme si le scénario faisait le grand écart entre la gentillette série Ghost whisperer et le sombre Soudain le 22 mai de Koen Mortier.
Le film fonctionne bien, mais on peut lui reprocher son rythme trop régulier. Ce n’est pas que l’on s’ennuie. Au contraire, on entre tout de suite dans le vif du sujet et les péripéties s’enchaînent à un train soutenu. Un peu trop. Il manque des pauses qui permettent aux spectateurs de souffler un peu pour apprécier pleinement le récit.
Mais Odd Thomas n’en demeure pas moins une sympathique série B, sans prétention, devant laquelle on passe un agréable moment. A vrai dire, on préfère que Stephen Sommers réalise ce genre de film plutôt que des navets à gros budget, comme Van Helsing ou G.I.Joe.
Notre note : ●●●●●○
_______________________________________________________________________________
”Real” de Kiyoshi Kurosawa

Cela commence comme un film d’anticipation : la science a progressé au point de permettre à une personne de pénétrer dans le cerveau d’une autre, via une console médicalisée. Le personnage principal, Koichi, peut ainsi entrer en contact avec la femme qu’il aime, Atsumi, une jeune dessinatrice de mangas plongée dans un profond coma suite à une tentative de suicide, un an auparavant. Le jeune homme espère comprendre les raisons de son geste désespéré. A-t-elle tenté de mettre fin à ses jours à cause de lui? A cause d’un soudain manque d’inspiration? Il espère également pouvoir l’aider à sortir de ce long sommeil, afin qu’ils puissent reprendre une vie ordinaire.
Le premier contact se passe bien. Koichi trouve Atsumi attablée à sa planche à dessin, dans une copie conforme de leur appartement. Ils peuvent discuter normalement, comme si de rien n’était. Mais la jeune femme semble obnubilée par deux choses. D’une part un dessin de plésiosaure qu’elle lui avait offert, l’année de leur rencontre, alors qu’ils étaient encore enfants tous les deux. D’autre part, le manga sur lequel elle travaillait juste avant sa tentative de suicide, “Roomi”, une histoire de tueur en série particulièrement sombre et violente.
Pendant le contact, Koichi voit se matérialiser les images macabres issues du recueil, ce qui ne manque pas de lui filer une frousse bleue.
Le problème, c’est que ça continue une fois qu’il revient dans le monde réel. Il a des hallucinations inquiétantes. Des effets secondaires de la rencontre, négligeables, selon les médecins. Mais une des visions persiste : celle d’un petit garçon fantomatique, constamment trempé…
On pense alors que le récit va bifurquer vers l’histoire de fantômes japonais classique, comme Kiyoshi Kurosawa a pu en tourner par le passé. Mais ce n’est qu’une fausse-piste de plus. Ou plutôt, une pièce du puzzle.
Koichi doit continuer à explorer la psyché de sa bien-aimée pour comprendre le blocage qui l’empêche de se réveiller. La clé de tout cela se situe au delà des murs de l’appartement, au-delà de la partie consciente du cerveau d’Atsumi, dans les limbes de sa mémoire et de son inconscient. C’est le dessin du plésiosaure et ce qui y est rattaché…
On s’attend à un périple de plus en plus fou, comme pouvait l’être un film comme Re-cycle des frères Pang, autre plongée fantasmatique dans un univers mental tourmenté. Mais Kiyoshi Kurosawa prend encore un autre chemin. Le scénario s’emballe, change de perspective. D’autres thèmes apparaissent, autour des schismes de la société japonaise, partagée entre tradition et modernisme, monde rural et métropoles urbaines. Et, surtout, les cartes sont complètement redistribuées à mi-parcours. Tout ce qu’on vient de voir est remis en question, tout en continuant de former un ensemble cohérent, un mélodrame axé autour du thème de la culpabilité.
Mais Real est avant tout une histoire d’amour très forte et poignante. Celle qui unit, depuis l’enfance, Koichi et Atsumi. C’est cela qui permet au récit de progresser, contre vents et marées. Et c’est sur ce squelette scénaristique (de plésiosaure) que viennent se greffer les nombreux autres éléments du récit, les autres thématiques, avec la grâce poétique et le foisonnement d’un roman d’Haruki Murakami.
Kiyoshi Kurosawa signe là un très beau film, qui confirme, si besoin était, qu’il est l’un des meilleurs conteurs du cinéma nippon contemporain, doublé d’un cinéaste particulièrement doué pour mêler récits intimistes et fables sociales plus amples.
On regrettera juste que la fin du film traîne un peu en longueur et soit plombée par un énième rebondissement, assez dispensable. Ce qui n’empêche évidemment pas Real d’être l’un des meilleurs films de ce cru 2013 du PIFFF.
Notre note : ●●●●●○
_______________________________________________________________________________
”L’Etrange couleur des larmes de ton corps” d’H.Cattet & B.Forzani

Ils confirment avec L’Etrange couleur des larmes de ton corps, film encore plus abouti esthétiquement, et plus labyrinthique pour le spectateur.
Si on voulait résumer le film de façon rationnelle, on pourrait dire qu’il s’agit d’une sorte de giallo érotique.
Dan Kristensen (Klaus Tange) rentre chez lui après un voyage d’affaires et découvre que son épouse a disparu. En enquêtant auprès de ses voisins, il apprend que la jeune femme avait des moeurs plutôt légères en son absence et qu’elle a peut-être fait une mauvaise rencontre dans cet immeuble étrange, théâtre de nombreux faits inexpliqués. Sa quête de vérité va être pour le moins éprouvante…
Ca, c’est pour l’angle narratif accessible facilement. Mais le film passe son temps à échapper à ce schéma rationnel. A cette trame policière classique viennent se greffer d’autres petites histoires, plus étranges les unes que les autres, des séquences fantasmées, rêvées – ou plutôt cauchemardées. La mise en scène, étrange, saturée de bruits et de couleurs, et le montage, chaotique, n’arrangent rien.
Le film donne constamment l’impression d’un glissement, ou de glissements successifs du réel au fantasme, du désir à la souffrance, comme chez Alain Robbe-Grillet. On bascule du giallo pur au fantastique italien des années 1970, entre Dario Argento et Mario Bava, puis dans un univers proche de celui du Locataire de Roman Polanski revu et corrigé par David Lynch.
C’est un peu comme si le film cherchait son identité propre, derrière toutes les influences de leurs auteurs. Est-ce un thriller? Un film d’épouvante? Un trip psychanalytique? Un drame autour d’un couple qui se défait? Un peu tout ça en même temps…
Le titre du film lui-même se transforme, passant de “L’étrange couleur des larmes de ton corps” à “l’étrange douleur”, si l’on en croit le panneau final (à moins que l’on ait rêvé ce détail?)
En tout cas, la définition que sa réalisatrice, Hélène Cattet, donne du film suit cette logique : “un film qui commence comme un whodunit et se termine en un who am I?”
Mais le meilleur moyen d’appréhender le film est peut-être de le voir comme une plongée dans un univers mental, celui d’un tueur en série schizophrène ou d’un type ordinaire dont l’inconscient refoule des pulsions morbides et érotiques.
Plusieurs scènes vont dans ce sens, à commencer par le plan d’ouverture, un zoom avant vers le front de Kristensen, en train de dormir dans un train, comme si on entrait dans son cerveau.
Pour le côté schizophrène, il y a cette scène de la rencontre entre le flic et Kristensen, découpée en split-screen particulier, façon puzzle, reformant un visage à partir d’éléments du faciès des deux hommes. Ou encore cette séquence, rappelant fortement Lost Highway, où Kristensen, alternativement éclairé de rouge et de vert, se voit sonner à sa propre porte, en boucle.
La maison elle-même, combinaison de deux vieilles bâtisses de Nancy, évoque un gigantesque crâne, avec ses fenêtres en demi-cercle et ses pièces en hauteur. Et les secrets cachés derrière les murs des appartements peuvent être vus comme l’inconscient de l’individu, celui qui sert à abriter le refoulé, les fantasmes, les parts d’ombre…
Le film est donc un étrange trip cérébral. Une expérience sensorielle souvent à la limite du supportable, tant les cinéaste aiment à nous perdre dans les méandres de leur narration complexe, labyrinthique, à nous agresser avec les images violentes, les distorsions de l’image et les sons stridents, le volume poussé au maximum. Mais cela en vaut la peine, assurément.
L’Etrange couleur des larmes de ton corps est un film d’une extraordinaire richesse, qui ne décèlera tous ses trésors qu’au prix de plusieurs visionnages. Comme un Lynch grand cru. Autant dire qu’on est assez fans…
Notre note : ●●●●●●
_______________________________________________________________________________
“Cheap thrills” de E.L. Katz
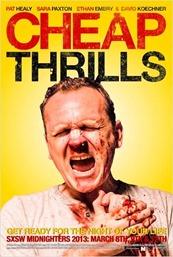
Deux amis de lycée, Vince (Ethan Embry) et Craig (Pat Healy), se retrouvent, plusieurs années après, dans un bar de nuit et font le point sur leurs vies respectives. Pas brillantes…
Le premier a toujours été un cancre. Il n’a pas fini ses études et a fini par s’orienter vers un métier où les muscles comptent plus que la tête : recouvreur de dettes pour des prêteurs sur gages patibulaires. Pour gagner son salaire, il doit aller casser la figure à des personnes aussi modestes que lui.
Le second a terminé ses études, s’est marié, a eu un enfant, mais il n’est guère mieux loti. Il est menacé d’expulsion s’il ne paie pas son loyer sous huitaine. Pas facile quand on vient de perdre son job, qui n’étai de toute façon que faiblement rémunéré…
Aussi, quand un couple apparemment plein aux as leur propose de passer la soirée avec eux, ils se laissent séduire. Peu à peu, l’homme leur propose de relever des défis en échange d’une petite somme d’argent. Au début, rien de bien méchant, des conneries de mec bourré, qui vont de celui qui boit son verre le plus vite à celui qui réussira le premier à se faire gifler par la fille accoudée au bar. Mais les actes à accomplir se font de plus en plus durs à mesure que les sommes mises e jeu augmentent.
D’abord complices, les deux amis de lycée se retrouvent rivaux, forcés de se livrer une bataille féroce pour empocher le maximum de billets verts au cours de la soirée. Ils doivent accepter des sévices psychologiques et corporels, mettre à mal leur sens de la morale et de l’honneur. Et leur avidité va les mener loin, très loin, au-delà des barrières éthiques qui définissent l’être humain civilisé.
Le film est une critique féroce de la société américaine actuelle et du système ultralibéral où seul compte le profit. Directement ou indirectement, le film traite aussi de sujets tels que la lutte des classes, les dérives de la téléréalité ou les conséquences sociales de la crise économique et financière.
Ici, les riches ne savent plus comment dépenser leur argent, ni comment profiter des loisirs conventionnels. Leur seul plaisir est la recherche de sensations fortes, obtenues en regardant des malheureux s’humilier sous leurs yeux. Et les pauvres sont prêts à tout pour gagner plus d’argent, quitte à perdre leur âme. Ils pourraient arrêter à tout moment la mascarade, mais ils en veulent toujours plus et ne valent finalement guère mieux que les instigateurs de ces jeux cruels. La vision de la société par E.L.Katz est profondément misanthrope…
Cheap thrills est plutôt bien ficelé. On s’attache assez vite aux personnages, avant d’assister impuissants à leur délitement moral. Les acteurs sont plutôt bons, l’humour cinglant du cinéaste fait souvent mouche et le propos ne manque pas d’intérêt. C’est un grand prix tout à fait honorable pour ce PIFFF 3ème opus, même si nous aurions préféré voir triompher Real ou L’Etrange couleur…
Notre note : ●●●●○○
_______________________________________________________________________________
Compte-rendu : Antoine Bordat (Boustoune) & Laura Minichino

