Surveillé : la lente atténuation du globe gazeux qui occupe encore mon œil. Il diminue, petit à petit, amorçant au fur et à mesure la netteté d’une vision correcte. Hier, il partageait l’espace avec 2 ou 3 autres petites bulles qui roulaient autour du globe, comme des satellites collés à une planète irisée. Aujourd’hui, ce n’est plus qu’une naine. Peut-être que demain, elle aura disparu dans les limbes de la vitrée oculaire. Aimcy, qui se charge d’écouler quelques gouttes médicamenteuses sur mon œil m’a dit qu’elle l’avait vue, comme un second sombre iris. Une lune peut-être ?

Craqué : sur un bouquin relatif à l’un des locataires de mon Panthéon. Jack London est, pour bon nombre, un écrivain de récits d’aventures glorifiant la nature sauvage. Il fut bien entendu plus que cela, notamment par les idées qui sous-tendent nombre de ses livres, des opinions politiques bien ancrées à gauche. Profondément marqué par une enfance misérable et une adolescence de vagabondage et d'errance à travers le monde (Sibérie, Japon, Klondike), de petits boulots (balayeur, menuisier, chasseur de phoques, agriculteur, éleveur de poulets, pilleur d’huîtres, blanchisseur, chercheur d'or), il se définissait lui-même comme socialiste.
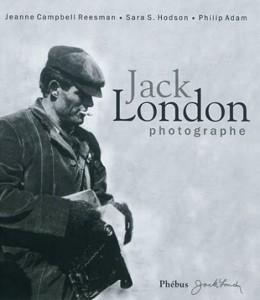


Souvenu : que l’une de ces photos londoniennes avait une relation avec Elizabeth Stokes, un personnage symbolique d’une activité curieuse et pittoresque de certaines femmes au début du 18e siècle en Grande Bretagne ; la combattante des rues. Ne nous trompons pas, il s’agit plus d’un "jeu" de cirque que du noble art, même si les matchs n’étaient pas truqués. D’ailleurs, lorsqu’Elisabeth Stokes devint célèbre en Grande-Bretagne et qu’elle fut alors honorée du surnom de "Lady Bare knuckles", elle exerça ses combats dans une enceinte que l’on ne pouvait franchir que contre quelques guinées. Voir ici http://georgianlondon.com/post/49461276531/elizabeth-stokes-lady-bare-knuckles
Cette activité permettant de survivre dans les bouges des villes où régnait le sordide et la pauvreté avait le mérite de conserver un semblant d’orgueil. De ce point de vue, Elisabeth Stokes ne sombra pas dans la déchéance de la mendicité.
Rappelé : que le monde miséreux de la cloche est le thème qu’affectionna Robert Giraud, un ami de Robert Doisneau. C’est d’ailleurs Giraud qui introduisit Doisneau, qui travaillait alors pour Vogue[1], dans le monde des clochards et des clodos, l’accompagnant dans les quartiers du marais et des Halles de Paris, lui faisant rencontrer les ombres que l’on n’appelaient pas encore des SDF, près de la place Maubert ou de la rue Mouffetard.

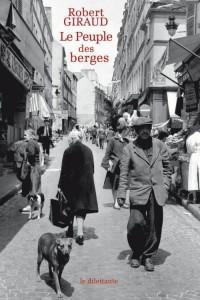

Promené : ici pour ces photos revisitant un passé, une histoire, des souvenirs. Désuet et nostalgique mais sans doute important pour que le jour ait ce besoin de retrouver l’hier…
Assisté : au Théâtre Ducourneau d'Agen, à un spectacle de mise en musique de films muets par Les Frères Méduses, un duo de guitaristes, composé d’un américain Randall Avers et du français Benoît Albert. Une façon de rejouer les débuts du cinéma, de se retrouver tels les tous premiers spectateurs des salles obscures d’autant que la séance débuta par la projection en boucle du « Panorama d'un train pris en marche » et « Un Homme de Têtes » tous deux de 1898, du « voyage à travers l’impossible » de 1904. Musique certes originale mais quelque peu lancinante que ne sauvaient pas les films de Méliès dont l’intérêt se limite à l’histoire du cinéma. La seconde partie était beaucoup plus intéressante. Tant par la musique des frères Méduses auxquels s’était joint la violoniste britannique Katharine Gowers que par le film projeté, « The Unknown » de Tod Browning, tourné en 1927. Une sombre et intense histoire d’amour fou mettant en scène les formidables Lon Chaney (dans le rôle d'Alonzo le manchot, un lanceur de couteau) et la très jeune Joan Crawford (dans celui de sa partenaire de cirque qu’il rêve d’épouser). Un film époustouflant dans lequel Lon Chaney, bien qu’y interprétant un criminel fou, donne une épaisseur à son personnage telle que l’on se prend de sympathie pour lui. Un film considéré comme l’un des meilleurs de Tod Browning qui sauve la soirée.

Adoré cette « manipulation », pour le souvenir nostalgique et l’inventivité désuète.
[1] C’est probablement par l’entremise de Robert Doisneau que Robert Giraud rencontra Irving Penn, également photographe de Vogue, lorsque l’américain eut la volonté de réaliser ses célèbres portraits de parisiens typiques connus sous le titre « Small trades » qu’un catalogue regroupe, présenté par Virginia A. Heckert et Anne Lacoste et publié par J. Paul Getty Publications, Los Angeles, 2009.
[2] Réédité depuis chez Stock dans la formidable collection « Ecrivins ».
[3] Après « Carrefour Buci » « Faune et flore argotiques » « Les Lumières du zinc » et « Paris, mon pote ». A noter également qu’Olivier Bailly a consacré une biographie à « Bob » Giraud sous le titre « Monsieur Bob » chez Stock (également dans la collection « Ecrivins ») en 2009.
