Du 8 au 11 novembre se déroule la 17e édition de l’Académie des Entrepreneurs, un événement formidable qui accueille quelques dizaines d’entrepreneurs français de tous horizons, patrons de PME, de grands groupes, etc. Tout au long de ces trois jours se sont succédé ateliers de réflexion animés par des professionnels (j’y animai celui sur la communication digitale et les réseaux sociaux), des séances plénières avec des penseurs hors pairs (Daniel Cohen, Edgar Morin, Erik Orsenna) autour d’un thème (Le bonheur, source de croissance?), et des événements d’exception comme une visite privée du Palais des Doges, ou une promenade nocturne en gondole (nettement mieux qu’une balade diurne, car tous les sens sont en éveil, et surtout l’ouie).

Daniel Cohen
Daniel Cohen aborde le thème par le chemin inverse : la croissance est-elle source de bonheur ? Pour commencer, il rappelle un paradoxe dont le constat est attribué à Malthus : jusqu’au 18e siècle, le progrès n’a absolument pas contribué à l’accroissement des richesse, l’ouvrier ou le paysan de son époque n’est pas plus riche que l’esclave romain qui l’a précédé plusieurs siècles auparavant. Deuxième paradoxe, celui d’Easterlin : quand bien même on augmenterait nos possessions, notre niveau de satisfaction reste inchangé.
Pourquoi ? Pour la simple raison que le progrès, contribuant à un accroissement de la population global, conduit à une moindre de richesses par individu : la croissance ne peut conduire au bonheur. En fait, pour Daniel Cohen, le bonheur est inaccessible. A cela deux raisons : adaptation et comparaison.
Nous n’avons de cesse de nous adapter à nos nouvelles conditions, et à oublier celles qui précédaient. Ainsi, alors que la majorité des individus déclareraient se satisfaire d’une augmentation de 30% de leurs revenus, une telle augmentation n’agit en fait pas sur l’accroissement de leur bonheur, car une fois acquis, on espère poursuivre cette croissance. C’est ce qui, explique-t-il, correspond à l’insatisfaction permanente dans laquelle nous sommes, quand bien même nous serions capables d’acquérir de plus en plus de biens : seul le moment où l’acquisition se produit correspond à un moment de bonheur.
L’autre raison, de notre déprime permanente, c’est que nous n’avons de cesse de nous comparer. Selon le pays et la culture, on se compare à son voisin, à son collègue, à ses proches. Aux États-Unis, c’est nos voisins, les « Jones », qui nous font enrager : ont-ils acquis une nouvelle voiture qu’il nous faut la même, voir e un modèle plus puissant, et nous de redoubler d’efforts et de faire travailler madame pour gagner le différentiel. En France, ce ne sont pas nos voisins, mais nos proches : le beau-frère, commente-t-il avec humour : une des raisons qui inciteraient les femmes au foyer à se remettre au travail, c’est le différentiel de revenus avec sa sœur, qui, elle, a fait un mariage économiquement plus réussi.
Enfin, Daniel Cohen rappelle que le sentiment de bonheur suit une courbe en U : élevé au sortir de l’adolescence lorsque nous sommes prêts à croquer le monde, il s’effondre vers les 50-55 ans, avant de remonter, une fois que nous avons atteint l’âge de la sagesse qui nous incite à ne plus nous comparer avec les Jones ou nos beaux-frères. A moins que ce ne soit, simplement, l’âge où ces derniers sont passés de vie à trépas…
Edgar Morin
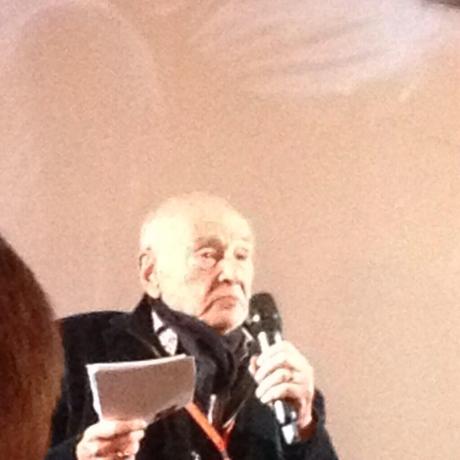
Avec Edgar Morin, on change de registre. Pour le philosophe et ancien résistant âgé de 93 ans (mais pourquoi diable tient-il à le rappeler à tout bout de champ, il a fait bien d’autres choses depuis qui lui permettraient de se valoriser !), le bonheur consiste à remettre du « je » dans le « nous », à penser moins pour soi et plus pour la communauté, à inscrire son action dans une démarche de groupe, de communauté. Pourtant, constate-t-il, les communautés ne durent pas, ou plutôt, seules celles basées sur une foi religieuse persistent. Le bonheur, c’est retrouver l’accomplissement communautaire, qu’il a connu, rappelle-t-il encore, au sein de la résistance à l’occupation allemande.
La suite de son intervention est beaucoup plus diffuse (n’ayant pas pris de notes, je retrace de mémoire en m’appuyant sur les quelques tweets échangés). Malgré un départ un peu en demi-teinte, le philosophe trouve sa vitesse de croisière en seconde partie avec quelques formules choc comme « ce qui ne se régénère pas dégénère », « chaque religion a ses héros et ses bourreaux », ou encore « Toute crise n’a que deux solutions: l’imagination ou la régression ».
A une question d’un des participants lui demandant quels enseignements on pouvait tirer de la remarquable stabilité de la république vénitienne, qui dura près de dix siècles d’affilée, il répond avec intelligence, que les démocraties des cités (Venise, Athènes) étaient éminemment plus facile à gérer que les républiques des états, en raison simplement du plus faible nombre de personnes à administrer. Les républiques étant basées sur la diversité des opinions émises, elles sont de fait plus fragiles, et peuvent facilement tomber dans la violence. 89 a conduit à la Terreur, à deux empires, à une restauration monarchique, qui durèrent bien longtemps avant que la fragile république française ne prenne définitivement corps.
Alors, le bonheur est-il réellement source de croissance ? Probablement non. Hélas.
Erik Orsenna
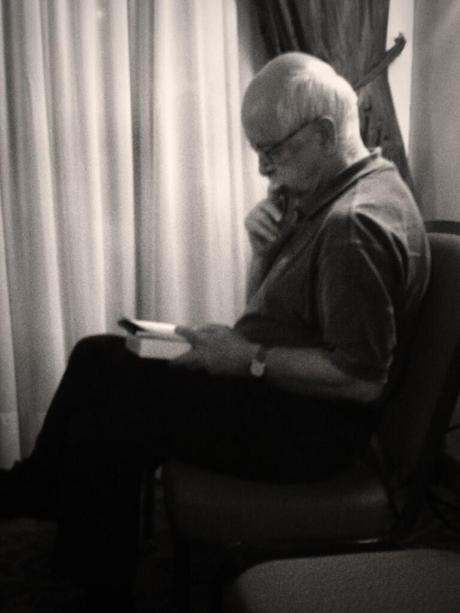
Erik Orsenna met le doigt sur quelque chose de difficile et de délicat: c’est le bonheur différé qui crée la croissance. En effet, tous ces créateurs, chefs d’entreprise, génèrent autour d’eux de l’absence.
« La meilleure façon d’être libre vis a vis des honneurs, c’est de les avoir trop » (Jean d’Ormesson).
Pourquoi les séducteurs séduisent-ils? Parce qu’ils sont totalement là. L’articulation de la vie, c’est l’articulation de temporalités. Si on est toujours occupé, on sera certes dans la croissance, mais on ne sera pas dans le bonheur. Le bonheur, c’est aussi une question de temps.
Les gens qui ne sont pas heureux racontent toujours la même histoire. C’est le bonheur qui est inventif.
Roueïda Ayache rejoint Erik Orsenna sur la scène pour parler des villes, et des traces du bonheur au sein des villes. Elle distingue trois catégories de villes.
- La première, c’est le modèle d’Utopia. Son bonheur est un bonheur protégé: on reste sur le thème de la fermeture, même si on y intègre une part de géométrie. Il aboutit à plusieurs modèle de villes, comme celui de structures à damier déployé par Rome, ou Philadelphie qui a inspiré bien d’autres villes américaines.
- Les villes en mobilité, partent de villes existantes, qui peuvent évoluer, se modifier, au fil de l’histoire. Le meilleur exemple, c’est le Paris de Hausmann, qui a modernisé Paris en créant des boulevards qui sont des modèles de mixité: du commerce en rez-de chaussée, mais aussi une mixité de communautés et de profils socio-économiques au sein du même bâtiment. Haussmann relie, coupe, crée un réseau entre des centres névralgiques à l’intérieur d’une ville.
- Les villes de l’ »organicité », c’est l’approche contemporaine. Ce qu’on demande aujourd’hui aux villes, c’est la qualité de vie, et rien n’est plus complexe.
Rendez-vous l’année prochaine pour la 18e édition!
