La dèche : les Français fuient un pays en proie au désespoir
Publié Par Contrepoints, le 29 octobre 2013 dans PolitiqueDans la nation assiégée de François Hollande, la paralysie de l’économie et la sévérité des impôts conduisent des milliers de Français à faire leurs bagages en direction de côtes britanniques plus accueillantes.
Par Anne-Élisabeth Moutet.
Une tribune publiée dans The Telegraph du 20 octobre 2013.
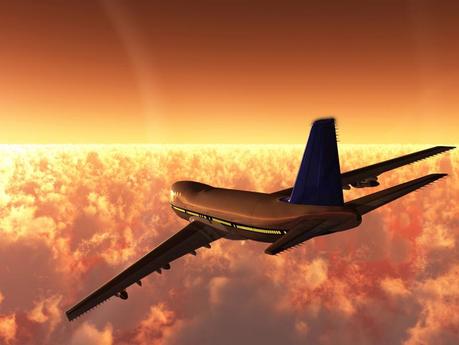
Un sondage sur la page d’accueil du Monde de mardi dernier, la bible de l’establishment de la gauche française (imaginez un Guardian à la fois ennuyeux et autoritaire), a traduit en chiffres bruts « l’hiver du mécontentement » de François Hollande.
Plus de 70% des Français pensent que les impôts sont « excessifs », et 80% croient que la politique économique du président est « malavisée » et « inefficace ». Cela va bien au-delà des exilés fiscaux tels Gérard Depardieu, les membres de la famille Peugeot ou les propriétaires de Chanel. Pire encore, après des décennies passées dans l’un des systèmes les plus redistributifs d’Europe occidentale, 54% des Français estiment que les impôts – dont 84 ont été créés au cours des deux dernières années, passant de 42% du PIB à 46,3% cette année – creusent maintenant les inégalités sociales au lieu de les réduire.
C’est un tournant notable, dans un pays où la valeur tant vantée d’« égalité » a toujours été teintée d’envie et de ressentiment vis-à-vis des plus fortunés. Il y a moins de deux ans, l’accusation la plus odieuse portée à l’encontre de Nicolas Sarkozy était d’être le « président des riches », en favorisant ses copains PDG, à voiliers ou à yachts, avec des allégements fiscaux et autres offres alléchantes. En revanche, Hollande, le candidat sans « bling-bling », a été élu sur un programme d’augmentation des dépenses de l’État en promettant de créer 60 000 postes d’enseignants, ainsi que 150 000 emplois subventionnés de bas d’échelle dans les services publics, pour les chômeurs de longue durée et les jeunes, sans prévoir d’importantes économies ailleurs.
D’ici 2014, les dépenses publiques de la France vont dépasser celles du Danemark pour devenir les plus élevées du monde : 57 % du PIB. En effet, pour simplement rester à la même place, comme un hamster dans sa roue, et veiller à ce que la Banque Centrale de Francfort ne soit pas trop mécontente de nous, Hollande a besoin de liquidités. Les technocrates, députés, et ministres ont été chargés de trouver chaque euro qu’ils pouvaient collecter – en allocations différées, en crédits d’impôts annulés, et en prélèvements supplémentaires. Comme ils ignorent le concept de coupes budgétaires sérieuses (évoquées à intervalles réguliers par le FMI, l’OCDE et la propre Cours des Comptes de la France), le résultat pourrait être quelque peu désordonné.
D’une part, le morose ministre de l’économie et des finances Pierre Moscovici a récemment reconnu qu’il « comprenait » l’« exaspération » des Français et de leur lourd fardeau fiscal. Cela lui a valu un coup sec sur les doigts de la part du président et de Jean‑Marc Ayrault, son premier ministre menacé de toute part. D’autre part, de nouvelles taxes continuent d’être annoncées, de manière chaotique, presque chaque semaine. « Annoncées » ne signifie pas « mises en œuvre » : la troupe de Hollande a développé un style à la Vil Coyote de fuites, problèmes techniques, réglages de dernière minute et marchandages de champ de courses, où presque personne ne connaît, à un moment donné, qui sera la prochaine cible du fisc, ni comment. Sans surprise, ceci n’est aimé par personne d’autre que nous, reptiles de la presse, désireux de rendre compte de la plus longue série d’intérêts particuliers de l’histoire de la communication étatique.
Prenez la fameuse supertaxe de 75% de l’an dernier sur les personnes qui gagnent plus d’un million d’euros par mois. Elle n’a pas encore été mise en œuvre. Tout d’abord, elle a été frappée par une décision du Conseil Constitutionnel français sur un point de détail. Des fuites ont suggéré que le taux tomberait à 66%. Elles ont été confirmées puis niées. Hollande a finalement promis que cette taxe serait payée par les employeurs des personnes ciblées, pour avoir osé proposer des salaires si « indécemment » élevés. Cela vient d’être approuvé par l’Assemblée nationale et doit encore passer devant le Sénat. Jusqu’à présent, elle n’est censée s’appliquer qu’aux revenus 2013 et 2014, mais on ne sait pas si le projet de loi sera prolongé, tué ou transformé.
Ce que nous savons, c’est que cette taxe inexistante (à ce jour) a été l’argument décisif qui a envoyé des centaines, voire des milliers, de citoyens français à l’étranger : non seulement « les riches », dont François Hollande a dit durant sa campagne victorieuse que personnellement « il ne les aimait pas », et qui font maintenant monter le prix des maisons dans South Kensington et se battent âprement pour les 1 200 nouvelles places du lycée Charles de Gaulle ; mais aussi les jeunes ambitieux, qui estiment que leur propre pays se retourneront contre eux dès qu’ils auront atteint quelque mesure de réussite personnelle.
Au cœur de la rive droite de Paris où je vis, seuls les étrangers semblent acheter des appartements à des prix totalement déconnectés de la réalité. Dans ma rue, j’ai repéré trois nouvelles Maserati. Même avant de voir leurs plaques qataris, je savais qu’elles ne pouvaient appartenir à des propriétaires locaux : elles sont un aveu ostentatoire de richesse que personne ne veut faire dans la France de Hollande (une voiture de luxe est l’un des « signes extérieurs de richesse » que votre inspecteur des impôts a été spécialement entraîné à reconnaître. La leçon a été retenue : l’an dernier, Rolls Royce n’a vendu aucune automobile en France). Sur la rive gauche, d’élégantes Américaines achètent des appartements miniatures sur la place de Furstenberg, à 30 000 € le mètre carré et s’aventurent dans le raffiné Café de Flore pour une pause café.
« Ce n’est pas seulement le fait que les gens n’aiment pas être traités comme des criminels parce qu’ils ont réussis, » me dit un ami banquier français qui a récemment déménagé à Londres, « mais cette incertitude dans tous les aspects du système fiscal signifie qu’il est impossible de faire des affaires : vous ne savez pas ce que seront vos coûts futurs ou ceux de vos clients. Vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas embaucher, vous ne pouvez pas licencier. »
Même si je suis toujours heureuse à Paris, je lui envie sa situation : le dynamisme de Londres, le sentiment que tout est possible, le sens de la fête qui me rappelle les années 80 et 90 où j’y ai vécu et que je retrouve avec plaisir à chaque fois que je file à toute allure dans l’Eurostar. Paris, ma ville de naissance, est un élégant musée, où toute idée nouvelle, peu importe le contexte, semble vouée à être abattue par une combinaison de vieux conformisme structurel et de désenchantement blasé.
Aujourd’hui, une personne sur quatre diplômées de l’université française veut émigrer, « et ce chiffre atteint 80 à 90% dans le cas des diplômes recherchés », explique le professeur d’économie Jacques Régniez, qui enseigne à la fois à la Sorbonne et à l’Université de New-York à Prague. « Dans l’un de mes séminaires sur la finance, chaque étudiant français a l’intention d’aller à l’étranger ».
« La main-d’œuvre française est maintenant à deux vitesses », explique un chasseur de têtes qui fait la navette entre Paris et Londres. « Parmi les jeunes, peut-être un tiers parlent anglais, sont prêts à déménager, et veulent travailler. D’abord, leurs employeurs rêvés sont les grandes multinationales françaises, presque toutes celles du CAC40, qui font plus de la moitié de leurs profits à l’étranger, parfois plus de 90% – des entreprises comme, par exemple, L’Oréal, Schneider ou Danone. C’est pourquoi les universités françaises ont choqué l’Académie Française et dispensent maintenant de nombreux cours en anglais. »
« Mais j’ai aussi vu des jeunes déterminés à accepter des emplois dans des pays comme le Vietnam, avec des contrats locaux et rien de comparable avec le niveau de protection offert par la législation du travail française, afin d’acquérir une première expérience convenable de l’entreprise dans un environnement compétitif. Et ensuite vous avez le large groupe de ceux dont l’ambition est simplement de rester en dehors de l’économie ».
Cela signifie un compromis avec lequel n’importe qui en France est familier : les jeunes, et beaucoup de leur parents, rêvent d’obtenir n’importe quel type de poste dans l’administration locale ou nationale, généralement mal payé et très souvent frustrant, mais qui garantit une sécurité de l’emploi totale, totalement déconnecté de la situation économique, du marché, ou de leur propre performance.
Plus d’un quart de la population active française est employée par un organisme public ou un autre : écoles, hôpitaux, conseils régionaux ou locaux, la police, la fonction publique à proprement parlé – ou encore ces nouveaux emplois publics aidés que le gouvernement Hollande aime tant.
Tandis que les jeunes générations de France aspiraient à se dorloter loin des réalités du monde, nos plus proches voisins suivaient la tendance inverse. En 2000, sous un chancelier socialiste, Gerhard Schröder, les entreprises allemandes ont versé un taux hallucinant de 51,6% d’impôt sur les sociétés – destiné en grande partie à payer la réunification de la décennie précédente. Aujourd’hui ce taux est descendu à 29,8%, alors que l’équivalent français, le plus haut d’Europe, est à 38%. En 2003, Schröder avait lancé un programme de réformes généralisées, diminuant les impôts, réduisant drastiquement les avantages sociaux, limitant l’influence des syndicats, et finalement faisant fondre le chômage allemand de 10 à 7% (il est de 11% en France).
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela ne fonctionnerait pas en France, notamment parce que les socialistes français ont comme par hasard remarqué que Schröder et son parti s’étaient réformés eux-mêmes, se retrouvant sans emploi. Une autre raison est la très faible représentativité des syndicats français : moins de 8% de la main‑d’œuvre française est syndiquée, un chiffre qui tombe entre 3 et 5% dans le secteur privé. Les syndicats français sont néanmoins mandatés pour jouer un rôle dans un certain nombre de structures de négociations et d’allocations, le système d’indemnisation chômage, de formation professionnelle, et la co-administration du système de santé publique et des retraites. C’est cela, et non pas les contributions de ses membres, qui les maintient à flot. La loi prévoit également que les amendes accordées dans le cadre des conflits du travail doivent être versées aux organisations syndicales.
Les syndicats français considèrent comme leur principal objectif le maintien du statu quo : de la législation du travail surprotectrice, rendant les licenciements si difficiles que les patrons français font quasiment tout pour éviter d’embaucher de nouveaux employés (qui leur coûtent 70% en charges sociales), aux règlements archaïques datant de la France de Vichy, comme l’interdiction d’ouverture des commerces le dimanche et du travail le soir.
Les récentes actions en justice portées par les syndicats ont forcé certaines entreprises à fermer le soir et le dimanche, de la chaîne de produits cosmétiques Sephora – dont les salariés ont protesté pour pourvoir continuer à travailler le soir – à la chaîne de bricolage Bricorama, propriété du britannique Kingfisher : pas étonnant que Ian Cheshire, directeur général de Kingfisher, s’est plaint vendredi dernier que cette décision nuisait à l’économie française tout autant qu’à ses magasins. « Le président a dit que la reprise est en vue : je ne sais pas où il la cherche en ce moment. L’humeur s’améliore en Grande-Bretagne, pas en France. »
Ce n’était pas destiné à se produire. « En 2000 » explique Jacques Régniez, « les multinationales françaises avaient atteint un très haut niveau de compétitivité. S’étant engagé dans la vigueur du franc, dans la perspective de l’euro, elles ont été forcées à devenir compactes et efficaces. Elles ont rationalisé la production et les travailleurs français sont devenus parmi les plus productifs au monde. « Les services publics français, les assureurs, les responsables de l’aérospatiale, les conglomérats du luxe étaient là-haut avec les meilleurs. Si vous vouliez la meilleure centrale nucléaire, les meilleurs avions commerciaux ou trains à grande vitesse, vous achetiez Français. »
Ce qui a mal tourné, selon Régniez, est la loi adoptée par le gouvernement socialiste de l’époque dirigé par Lionel Jospin, réduisant la semaine de travail à 35 heures. « Là où nos concurrents, en particulier les Allemands, ont vu la nécessité de baisser les prix et les coûts, la France a dépensé des sommes qu’elle ne pouvait pas se permettre. » L’ensemble du système, explique-t-il, a inévitablement penché vers la hausse des salaires, des avantages, et vers une baisse de l’âge de la retraite, et ce malgré toutes les tendances démographiques observables. Les investissements se sont ralentis dans le secteur privé, et se sont presque arrêtés dans le public. « Chaque année, la France a manqué 4 points de PIB de dépenses d’investissement. À l’heure actuelle, après une décennie et demie, nous ne sommes pas seulement en retard, il n’est même pas certain que nous puissions rattraper ce retard. Il en coûterait une hausse de 4,5% de TVA, et d’autres hausses importantes des cotisations sociales. C’est tout simplement irréaliste. »
Même les infrastructures vantées de la France – les trains, les routes, les réseaux de télécommunication, le réseau électrique autrefois ultra-performant, les centrales nucléaires, le réseau 4G retardé – ont pris un choc sévère.
Un homme d’affaires français qui a déménagé à Londres l’an dernier et qui a demandé à ne pas être nommé, « parce que mon contrôle fiscal serait encore plus empreint de représailles que celui auquel je suis déjà soumis », compare l’accident du train de Brétigny de juillet, la pire catastrophe ferroviaire en France depuis un quart de siècle qui a tué six personnes et en a blessé cent autres, aux déraillements de Paddington et de Potters Bar. « Le matériel roulant est vieillissant, les voies sont dans un état de constant délabrement, même les TGV ont maintenant des retards réguliers en raison des défaillances de caténaires. »
Malgré leur contestation des allégations de négligence, la SNCF a annoncé qu’elle va renforcer les travaux de maintenance « sans attendre les conclusions de l’enquête ». Des critiques ont aussi été faites sur les énormes sommes allant aux salaires, avantages sociaux et retraites.
Mais la plupart des analystes partagent la responsabilité entre les gouvernements français de gauche et de droite des deux dernières décennies. Un banquier d’investissement, qui a également déménagé à Londres récemment, situe ces mauvais choix au premier mandat de Jacques Chirac en 1995. Chirac et son premier ministre Alain Juppé, tous deux Gaullistes, décident de réformer l’imposant système de retraites du secteur public français, pour aligner les retraites par répartition des fonctionnaires, qui étaient (et sont toujours) bien plus favorables, sur celles du secteur privé.
Il s’en est suivi trois semaines de grèves dures, arrêtant l’ensemble du pays, des écoles aux transports publics, des services publics à la poste. Juppé était prêt à tenir le coup, mais Chirac a fléchi. La réforme a été abandonnée, et durant les 12 années suivantes de son mandat, Chirac n’a jamais au grand jamais essayé d’entrer à nouveau en conflit avec des intérêts personnels.
Sarkozy avait de grands projets après son élection en 2007. Il croyait aux entreprises, à un bon salaire pour un dur labeur, et était terriblement franc à ce sujet. Cela se serait – peut-être – bien passé en période de prospérité : un an après, la crise financière s’abattit ; son style brusque et son amour du bling-bling se sont heurtés à la fois aux anciennes et nouvelles préférences françaises (la France est un vieux pays catholique qui, durant plus d’un siècle, a été influencé par un marxisme sans vergogne. Elle est hostile à l’argent de manière atavique.). Les réformes que Sarko a réussi à faire passer, beaucoup plus douces que nécessaires, ont tout de même assuré son impopularité. Il a parié sur le réalisme français, et a perdu.
Le réalisme – le vrai, celui de la vie réelle – n’est pas une accusation que vous pouvez lancer à Hollande. Comme Chirac – qui l’a soutenu à la fois à cause d’une aversion profonde et personnelle à l’encontre de Sarkozy et parce qu’ils sont à bien des égards très similaires – l’improbable septième président de la Ve république est un politicien professionnel, diplômé de l’école supérieure d’’administration, l’ENA, et n’a jamais occupé un emploi dans le secteur privé. Chirac comme Hollande sont tout deux originaires de Corrèze, une région du centre de la France qui a régulièrement fourni à la politique française un certain type d’opportunistes habiles. Tous deux apparaissent faciles à vivre et amicaux, et tout deux sont de complets cyniques, avec peu d’idéaux et une capacité à manigancer pour rester au pouvoir infinie.
Chirac, comme Hollande, a su cultiver un réseau d’alliés politiques : dans le cas de Hollande, cela signifie garder la gauche de son parti ainsi que ses alliés verts heureux avec un certain nombre de mesures symboliques, de la supertaxe de 75% à la récente loi anti-fracturation hydraulique.
Peu intéressé par l’impact du moral et de l’image sur la politique et l’économie, Hollande croit que le cycle économique doit inévitablement se retourner (il a déjà dit de nombreuses fois que la récession est derrière nous), et que tout ce qu’il a à faire est de rester au pouvoir jusqu’à ce que les choses aillent mieux – grâce aux Chinois, aux Américains, cela a peu d’importance. Il ne se soucie même pas des incursions de Marine Le Pen aux élections locales : assistant débutant à l’Élysée de Mitterrand il y a 25 ans, il croit que le Front national, produit par son ancien patron, est un accessoire pratique, conçu pour diviser la droite et l’aider à remporter un second mandat en 2017.
Le professeur Régniez pense que c’est très dangereux. « Sarkozy a perdu de justesse en 2012 pour des raisons personnelles – son style a ennuyé des électeurs qui auraient pu s’entendre sur sa politique, mais qui voulaient le punir : 18% d’entre eux ont voté pour Marine Le Pen, contre seulement 5% pour son père en 2007. »
« Ceci devrait être un avertissement aux autres pays, comme la Grande-Bretagne – c’est très bien de punir un politicien conservateur dont vous êtes mécontent en votant pour un franc-tireur, Le Pen ici, Farage là. Mais cela fait élire des gens comme Hollande. Pensez-y bien : est-ce un avenir comme le nôtre que vous souhaitez pour votre pays ? »
—
Down and out: the French flee a nation in despair par Anne-Élisabeth Moutet, paru dans le Telegraph du 20 octobre 2013. Traduction : Éclipse/Contrepoints.

