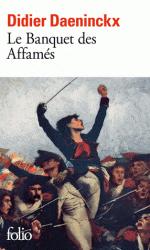 Didier Daeninckx écrit et publie beaucoup. Trop? Ne me faites pas dire ce que je ne pense pas. D’un ouvrage à un autre, des lignes de force se dessinent et se recoupent. Dans Le banquet des affamés, on croise Ataï encore vivant en Nouvelle-Calédonie, avant le départ de son corps pour la France métropolitaine puis, plus tard, Le retour d’Ataï, un autre livre de ses livres.
Il ne s’agit pourtant pas de ressasser, mais plutôt de construire la cohérence d’un vaste ensemble – plus de quatre-vingts titres peuplent sa bibliographie, et chacun y est à sa place, comme le détail d’un tableau qui embrasse notre monde, avec ses zones d’ombre.
Dans Le banquet des affamés, Daeninckx imagine l’autoportrait de Maxime Lisbonne, personnage haut en couleurs mû par un idéal révolutionnaire autant que par le goût du spectacle. Né en 1839 et mort en 1905, il a été militaire, forçat, directeur de théâtres, colonel de la Commune, condamné à mort, déporté en Nouvelle-Calédonie, ami de Louise Michel, puis journaliste et à nouveau homme de théâtre après l’amnistie. Il a inventé l’équivalent des restos du cœur (d’où le titre du livre), il s’est battu toute sa vie pour ses idées et pour faire partager ses plaisirs, il s’est souvent attaqué de front à plus fort que lui.
Son existence était déjà un roman, il n’était pas nécessaire d’intégrer de nouvelles péripéties au milieu de celles qu’il a accumulées tout au long de sa vie. Il fallait, en revanche, leur donner la forme adéquate. L’autobiographie permet à Lisbonne d’insister sur ses convictions et la manière dont il les met en pratique. Il s’enthousiasme pour ses réalisations, incapable de calmer le jeu au moment où cela deviendrait raisonnable. Mais il est le contraire d’un homme raisonnable, heureusement pour le romancier. Et pour nous.
Didier Daeninckx écrit et publie beaucoup. Trop? Ne me faites pas dire ce que je ne pense pas. D’un ouvrage à un autre, des lignes de force se dessinent et se recoupent. Dans Le banquet des affamés, on croise Ataï encore vivant en Nouvelle-Calédonie, avant le départ de son corps pour la France métropolitaine puis, plus tard, Le retour d’Ataï, un autre livre de ses livres.
Il ne s’agit pourtant pas de ressasser, mais plutôt de construire la cohérence d’un vaste ensemble – plus de quatre-vingts titres peuplent sa bibliographie, et chacun y est à sa place, comme le détail d’un tableau qui embrasse notre monde, avec ses zones d’ombre.
Dans Le banquet des affamés, Daeninckx imagine l’autoportrait de Maxime Lisbonne, personnage haut en couleurs mû par un idéal révolutionnaire autant que par le goût du spectacle. Né en 1839 et mort en 1905, il a été militaire, forçat, directeur de théâtres, colonel de la Commune, condamné à mort, déporté en Nouvelle-Calédonie, ami de Louise Michel, puis journaliste et à nouveau homme de théâtre après l’amnistie. Il a inventé l’équivalent des restos du cœur (d’où le titre du livre), il s’est battu toute sa vie pour ses idées et pour faire partager ses plaisirs, il s’est souvent attaqué de front à plus fort que lui.
Son existence était déjà un roman, il n’était pas nécessaire d’intégrer de nouvelles péripéties au milieu de celles qu’il a accumulées tout au long de sa vie. Il fallait, en revanche, leur donner la forme adéquate. L’autobiographie permet à Lisbonne d’insister sur ses convictions et la manière dont il les met en pratique. Il s’enthousiasme pour ses réalisations, incapable de calmer le jeu au moment où cela deviendrait raisonnable. Mais il est le contraire d’un homme raisonnable, heureusement pour le romancier. Et pour nous.
Magazine Culture
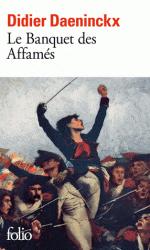 Didier Daeninckx écrit et publie beaucoup. Trop? Ne me faites pas dire ce que je ne pense pas. D’un ouvrage à un autre, des lignes de force se dessinent et se recoupent. Dans Le banquet des affamés, on croise Ataï encore vivant en Nouvelle-Calédonie, avant le départ de son corps pour la France métropolitaine puis, plus tard, Le retour d’Ataï, un autre livre de ses livres.
Il ne s’agit pourtant pas de ressasser, mais plutôt de construire la cohérence d’un vaste ensemble – plus de quatre-vingts titres peuplent sa bibliographie, et chacun y est à sa place, comme le détail d’un tableau qui embrasse notre monde, avec ses zones d’ombre.
Dans Le banquet des affamés, Daeninckx imagine l’autoportrait de Maxime Lisbonne, personnage haut en couleurs mû par un idéal révolutionnaire autant que par le goût du spectacle. Né en 1839 et mort en 1905, il a été militaire, forçat, directeur de théâtres, colonel de la Commune, condamné à mort, déporté en Nouvelle-Calédonie, ami de Louise Michel, puis journaliste et à nouveau homme de théâtre après l’amnistie. Il a inventé l’équivalent des restos du cœur (d’où le titre du livre), il s’est battu toute sa vie pour ses idées et pour faire partager ses plaisirs, il s’est souvent attaqué de front à plus fort que lui.
Son existence était déjà un roman, il n’était pas nécessaire d’intégrer de nouvelles péripéties au milieu de celles qu’il a accumulées tout au long de sa vie. Il fallait, en revanche, leur donner la forme adéquate. L’autobiographie permet à Lisbonne d’insister sur ses convictions et la manière dont il les met en pratique. Il s’enthousiasme pour ses réalisations, incapable de calmer le jeu au moment où cela deviendrait raisonnable. Mais il est le contraire d’un homme raisonnable, heureusement pour le romancier. Et pour nous.
Didier Daeninckx écrit et publie beaucoup. Trop? Ne me faites pas dire ce que je ne pense pas. D’un ouvrage à un autre, des lignes de force se dessinent et se recoupent. Dans Le banquet des affamés, on croise Ataï encore vivant en Nouvelle-Calédonie, avant le départ de son corps pour la France métropolitaine puis, plus tard, Le retour d’Ataï, un autre livre de ses livres.
Il ne s’agit pourtant pas de ressasser, mais plutôt de construire la cohérence d’un vaste ensemble – plus de quatre-vingts titres peuplent sa bibliographie, et chacun y est à sa place, comme le détail d’un tableau qui embrasse notre monde, avec ses zones d’ombre.
Dans Le banquet des affamés, Daeninckx imagine l’autoportrait de Maxime Lisbonne, personnage haut en couleurs mû par un idéal révolutionnaire autant que par le goût du spectacle. Né en 1839 et mort en 1905, il a été militaire, forçat, directeur de théâtres, colonel de la Commune, condamné à mort, déporté en Nouvelle-Calédonie, ami de Louise Michel, puis journaliste et à nouveau homme de théâtre après l’amnistie. Il a inventé l’équivalent des restos du cœur (d’où le titre du livre), il s’est battu toute sa vie pour ses idées et pour faire partager ses plaisirs, il s’est souvent attaqué de front à plus fort que lui.
Son existence était déjà un roman, il n’était pas nécessaire d’intégrer de nouvelles péripéties au milieu de celles qu’il a accumulées tout au long de sa vie. Il fallait, en revanche, leur donner la forme adéquate. L’autobiographie permet à Lisbonne d’insister sur ses convictions et la manière dont il les met en pratique. Il s’enthousiasme pour ses réalisations, incapable de calmer le jeu au moment où cela deviendrait raisonnable. Mais il est le contraire d’un homme raisonnable, heureusement pour le romancier. Et pour nous.
