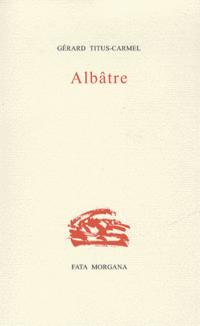 On sait Titus-Carmel attentif à
l’architecture du livre, du volume. Toujours soucieux d’un ordre, d’une
symétrie, classique ou parnassienne ou simplement géométrique, comme on voudra.
C’est peut-être pour lui façon d’endiguer ou contraindre ou former un élan
lyrique qui serait sans cela débordement, crue, avec ce que cela peut avoir
d’enrichissant et de dévastateur : Nil, pyramides. Donc ce livre est composé, bâti, édifié ;
le hasard peut se loger dans le détail, pas dans l’ensemble. Ainsi, le premier
et le dernier textes, en prose, renvoient clairement à l’Égypte. La partie
« I. » se compose de 25 poèmes numérotés en vers libres souples, tout
comme la partie « II. ». Au centre du livre, cinq textes en prose, en
italiques, développent une veine plus directement autobiographique.
On sait Titus-Carmel attentif à
l’architecture du livre, du volume. Toujours soucieux d’un ordre, d’une
symétrie, classique ou parnassienne ou simplement géométrique, comme on voudra.
C’est peut-être pour lui façon d’endiguer ou contraindre ou former un élan
lyrique qui serait sans cela débordement, crue, avec ce que cela peut avoir
d’enrichissant et de dévastateur : Nil, pyramides. Donc ce livre est composé, bâti, édifié ;
le hasard peut se loger dans le détail, pas dans l’ensemble. Ainsi, le premier
et le dernier textes, en prose, renvoient clairement à l’Égypte. La partie
« I. » se compose de 25 poèmes numérotés en vers libres souples, tout
comme la partie « II. ». Au centre du livre, cinq textes en prose, en
italiques, développent une veine plus directement autobiographique.
L’Égypte. Plus précisément « la grande table d’embaumement de Memphis (…)
taillée dans un bloc d’albâtre de près de cinquante tonnes » (p.9), et on
retrouve « Sobek », le « dieu crocodile » (p.69) à la fin
du livre. Ceci justifie ou éclaire certaine références égyptiennes au cours du
livre. Mais ce n’est pas son enjeu véritable, le titre Albâtre l’indique assez nettement, même si la mort est présente et pourrait
renvoyer à la « table d’embaumement initiale : « tu reconnais au loin
une mort lente et amie// transparente lumineuse à l’image de ta peine » (p.60).
Plutôt que l’interrogation spirituelle ou mystique à partir de la religion de
l’Égypte ancienne, le livre pose davantage un rapport direct à une matière,
l’albâtre, roche étrange parce qu’elle semble enclore la lumière. On rejoint
ici la question posée dans un livre précédent, Ressac : la séparation
entre le vivant et l’élémentaire : « le « non-je »de la nature » (p.28),
« la mutité immémoriale du monde » (p.37), « tout cela qui a
échappé à l’histoire / comme énigme refermée au cœur de la pierre / étrangère
en si froide indifférence » (p.64).
« La tendre indifférence du monde » écrivait Camus à la fin de L’Étranger. Le rapport à l’albâtre pourrait être
celui-là : une conscience apaisée de ce qui nous sépare, une acceptation
de l’énigme du dehors qui continue très bien sans nous qui cessons vite. Il
n’en va pas ainsi chez Titus-Carmel : il reste « l’âpre travail de
durer / si loin de la lumière » (p.35) : autrement dit, vivre. Autant
l’albâtre, rétractée dans sa clarté opaline, dit une forme d’éternité minérale,
autant cet hors-temps nous reste inaccessible : « j’ai usé mon regard
à cette aube / et me suis perdu car ici trop de blanc / pour mes os je ne me
reconnais pas » (p.55)
Au bout, match nul : on pourrait dire que l’humain et l’élémentaire se
regardent en chiens de faïence. D’un côté, l’intemporel de la pierre (Albâtre) ou de la mer (Ressac), et de l’autre la peau de
chagrin, la perte, la mort. Mais par un retournement (pascalien ?)
Titus-Carmel fait pencher la balance du côté de l’humain : « Aussi cherche-t-on à creuser toujours plus
avant ce blanc dur et vitreux, espérant reconnaître en lui le lieu d’une
origine cachée au cœur de sa matière ; et l’on affouille mémoire &
légende en ces tréfonds où l’on risque de se perdre à jamais. Mais par chance,
revenus de là, rien n’entache plus notre langue ; notre périple au sein de
cette blancheur n’a fait qu’allumer le grand salon d’absence à l’intérieur, et
rien d’autre. Pourtant ce n’est pas la déception qui nous submerge, mais un
soudain sentiment d’irréparable qui annule tout l’espace en nous, fendant la
croûte terrestre et l’ouvrant jusqu’au sommeil : c’est une reconnaissance,
au contraire, un clair vertige mêlé à la joie diffuse de reparaître au monde
après avoir côtoyé d’aussi près sa mort sculptée à l’envers… »( p.39)
[Antoine Emaz]
Gérard Titus-Carmel, Albâtre, Editions
Fata Morgana, 70 pages – 14€

