L’application d’un programme authentiquement libéral devrait avoir pour effet de rendre impossible le développement du "grand capitalisme".
Par Christian Laurut.
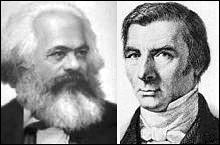
Le capitalisme est un concept à la fois économique, sociologique et politique, mais sa définition donne lieu à des variations dans l'espace et dans le temps, en fonction des sensibilités politiques des personnes qui emploient le terme. C’est ainsi que l’une de ses composantes de base, à savoir la recherche du profit et l'accumulation du capital par la propriété privée des moyens de production, s'accompagne de « l'exploitation de l'homme par l'homme » selon Karl Marx, ou résulte de « l'éthique des premiers entrepreneurs refusant le luxe et la consommation » selon Max Weber. Le mot commença à être employé au début du 19ème siècle par des penseurs aussi différents que l’économiste David Ricardo et le poète Samuel Coleridge, puis repris un peu plus tard par Pierre-Joseph Proudhon, Karl Marx, Friedrich Engels, le politicien Louis Blanc, l’économiste Werner Sombart et le sociologue Max Weber. Cette diversité d’utilisation et, par voie de conséquence, cette ambiguïté de signification perdurent encore aujourd’hui, où le terme, loin d’être doté d’une acception consensuelle, fait l’objet de multiples caricatures souvent destinées à argumenter un propos dénonciateur. Car contrairement au terme « libéralisme », le capitalisme se trouve, la plupart du temps, employé dans un sens péjoratif aussi bien par l’économiste distingué que par l’individu anonyme, avec une accentuation dépréciative nettement plus marquée à l’encontre du disciple qu’envers l’idéologie générique.
Ainsi, depuis la chute du mur de Berlin, le capitalisme ne semble plus avoir de rival sur la planète en tant que système socio-économique recevable et, bien qu’obscurci en permanence par l’ombre portée marxiste de l’ «exploitation de l’homme par l’homme », il jouit d’une position de fait dominante et incontestable, même si un consensus commun s’est peu à peu établi pour en atténuer les soi-disant rigueurs. Si l’idéologie, donc, est considérée, bon an mal an, comme légitime pour présider à l’organisation des échanges marchands entre les hommes, il n’en va pas de même pour ceux qui la mettent en œuvre au quotidien, c’est-à-dire les capitalistes, dont la simple évocation rappelle l’ancienne et terrible renommée des bolcheviks, couteau entre les dents, monstres assoiffés de sang et mangeurs d’enfants. Le capitaliste cumule dès lors sur sa tête tous les non-dits et les refoulés collectifs dont il semble politiquement incorrect d’accabler son géniteur. C’est ainsi que l’opinion publique veut bien ignorer les vices habituellement attribués au capitalisme, mais pas ceux affectés au capitaliste, lequel se voit publiquement et quotidiennement dénoncé en tant qu’exploiteur, profiteur, spéculateur, égoïste, milliardaire insolent, prédateur, fasciste, ou autre dénomination repoussante et stigmatisatrice… Le capitaliste est généralement supposé être un chef d’entreprise, mais n’importe qui peut être affublé du terme pour peu qu’il soit en litige financier avec un individu qui s’estime floué par le corps social dans son ensemble. Le terme lui même est porteur d’une telle opprobre populaire que bien peu d’individus agissants osent se l’attribuer publiquement pour définir leur activité.
La contestation du capitalisme doit donc nécessairement passer par une définition très précise de la notion, sous peine d’adopter une posture politique relevant, au mieux, de la démagogie populiste ou, au pire, de l’inculture historique. Si nous nous accordons sur une définition du capitalisme constituant le plus petit commun dénominateur des principales acceptions du terme, il semble que la formule : « propriété privée des moyens de production » soit à retenir, et de nature à recueillir un consensus minimal chez les utilisateurs, toutes tendances politiques confondues. Il convient toutefois de tempérer immédiatement cette notion en adjoignant au mot composé « moyens-de-production » le complément « des-grandes-entreprises », car aucun anti-capitaliste sérieux ou déclaré n’envisage même une seconde la collectivisation de tous les moyens de production, ce qui reviendrait à considérer que l’atelier de l’ébéniste ou le bureau du consultant doive devenir propriété de l’État, ou, en toute logique, être fourni par lui dans le cas d’une création. Même dans le programme du NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) d’inspiration trotskiste, l’appropriation par le peuple (lire l’État) des moyens de production ne concerne que les grandes entreprises du CAC 40 !….
Pour les défenseurs du capitalisme, il importe donc de ne pas tomber dans un travers de simplification identique à celui de leurs opposants en caricaturant la pensée de ces derniers par cet abrégé trop facilement répudiable : « la collectivisation de toute l’activité économique ». Une autre composante essentielle du programme anti-capitaliste, dérivée naturellement du principe de propriété collective des moyens de production, est celle de l’extension des services publics gratuits à une liste incluant (selon le NPA toujours) la santé, l’éducation, l’eau, l’énergie, les transports, les télécommunications, la poste, l’enfance et le quatrième âge. Là encore, il convient de bien étudier la notion de service public gratuit, avec la prise en compte de ses avantages et de ses inconvénients, à savoir la problématique de son financement, ses limites d’application et sa pertinence dans un contexte de déplétion prochaine des ressources fossiles et minérales, avant de rejeter en bloc et par principe toute idée de gestion collective de certaines fonctions économiques ou sociales.
Un autre aspect de la question à prendre en compte est celle de l’interaction de l’État avec le capitalisme, ou, plus précisément, du rôle joué par l’État moderne dans le développement du capitalisme. En étudiant ce problème de plus près, et en se démarquant aussi bien des idées politiquement correctes que des raccourcis populaires, il apparaît que l’État moderne, cible justifiée des libéraux convaincus, se révèle, à l’analyse, le plus fidèle allié du grand capital, voire son garant juridique et financier. Il est en effet manifeste que la grande entreprise est largement favorisée par le pouvoir étatique, au détriment de la petite entreprise, et encore plus à celui de la très petite entreprise (celle du travailleur indépendant) qui cumule ainsi le double handicap de la vindicte populaire (image du sale petit patron capitaliste) et du mépris étatique. Une analyse détaillée du sujet fait même apparaître que l’État français détient des participations majoritaires dans les plus grandes entreprises dites « capitalistes » du territoire. C’est ainsi que le RECME (Répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l'État) recense 1217 sociétés, dont 93 dites de premier rang, qui sont contrôlées directement par l’État, ce qui explique en partie l’orientation du pouvoir en faveur du grand capital.
Un autre argument d’importance réside dans le fait que cette nouvelle notion de « capitalisme d’État » ne s’oppose pas, contrairement aux apparences, au socialisme radical et endémique qui imprègne notre société, car c’est bien dans les cohortes salariées, en bon ordre de marche, des grandes entreprises que les partis de gauche recrutent leurs supporters, plus que dans les éléments dispersés et atomisés du « small business ». En l’absence de grandes entreprises capitalistiques (dont le capital lui-même, ne l’oublions pas est souvent contrôlé par l’État), les tenants de la société étatisée et du réglementarisme tous azimuts se retrouveraient privés de leur base populaire et de leur fonds de commerce électoral, et opposés à une masse généralisée de petits entrepreneurs plus convaincus de libéralisme économique et d’entreprise individuelle que d’interventionnisme étatique et de gestion collective. En toute objectivité, l’existence du grand capital est donc nécessaire au développement des idées socialisantes, comme l’arrosage est nécessaire à la croissance des plantes et il participe à l’étiolement de la libre entreprise puisque les mastodontes économiques ainsi créés étouffent toute concurrence naissante. Constitués la plupart du temps en monopoles économiques avec l’agrément de l’État, ils se révèlent les plus féroces ennemis de la petite et moyenne entreprise, qui représentent pourtant l’expression la plus naturelle et évidente du libéralisme économique.
Cette collusion manifeste de l’État avec la grande entreprise ne s’exprime pas seulement par ses participations en capital et ses faveurs législatives, mais également par sa récente politique financière qui a délégué aux seuls établissements bancaires le monopole de la création monétaire. Avec l’abandon historique de son droit régalien de frapper monnaie et l’adoption du tout scriptural, l’État laisse désormais le système bancaire créer la monnaie par l’octroi du crédit, l’argent devenant tout simplement de la dette qui circule. De ce fait, les banques, qui ne sont pas en situation de libre concurrence et de libre exercice, qui n’engagent pas leur responsabilité sur leurs fonds propres, et qui, en fin de compte, sont contrôlées par l’État constituent la sève qui irrigue l’organisme du grand capital dominateur, omnipotent, et fossoyeur souvent constaté de la libre entreprise.
Le lecteur aura bien compris que mon propos est de bien dissocier l’hydre multiforme regroupant les grosses boites oligopolistiques, d’une part, et le tissu décentralisé des petites et moyennes entreprises en situation de concurrence réelle, d’autre part, afin de pouvoir associer à la première le terme de capitalisme et au deuxième celui de libéralisme. Ce distinguo ne pourra manquer de faire grincer quelques dents libérales, généralement peu enclines à mastiquer du capitalisme au quotidien, mais devrait se montrer utile dans le cadre d’une clarification terminologique salutaire et susceptible, par ailleurs, de rendre plus persuasif le discours libéral auprès de certaines audiences.
D’autant que l’application d’un programme authentiquement et strictement libéral aurait pour effet de rendre très difficile, voire impossible le développement du grand capitalisme. En effet, le démantèlement du pouvoir étatique dans l’économie aurait pour effet conjoint de saper les rouages de la méga-entreprise en leur ôtant la protection législative et juridique dont elles bénéficient aujourd’hui. L’accessibilité non contrôlée à tous les types d’activités rendrait plus difficile l’instauration de situations de monopole dans un secteur donné. La liberté d’exercice du métier bancaire et sa responsabilité financière rendue identique à celle des autres activités commerciales marquerait la fin de la création monétaire par les banques et freinerait la libre circulation des capitaux virtuels qui alimentent le grand capitalisme mondial. Enfin, la privation du pouvoir législatif de l’État rétablirait l’égalité de traitement entre les entreprises de toutes tailles, et affaiblirait considérablement les grandes entreprises. On remarquera que l’ensemble de ces dispositions ne consiste pas en un catalogue de mesures coercitives, réglementaires ou législatives, visant à modifier par la force de la Loi le fonctionnement de la machine économique, mais tout simplement en une liste de lois existantes à abolir afin de laisser le champ libre à l’ordre spontané, cher aux libéraux classiques. Il convient, à ce propos, de rappeler que n’est pas libéral qui veut et que nombre d’hommes ou de partis politiques se réclamant plus ou moins du libéralisme n’utilisent en fait ce terme que pour teinter leur étatisme convaincu d’un léger courant d’air pur et de liberté.
Frédéric Bastiat, dans les quatorze lettres qu’il échangea avec Pierre-Joseph Proudhon dans les colonnes de la Voix du Peuple en 1949, fut amené, pour les besoins de son argumentation, à bien préciser sa position sur les affaires monétaires et bancaires face au représentant le plus prestigieux de l’anarchisme naissant. Il ressort de cet échange passionnant, initié sur le thème proudhonnien de la « gratuité du crédit », que c’est Proudhon, l’anti-autoritaire, qui défendait la création monétaire illimitée par une banque d’État (la fameuse Banque d’échange ou Banque du peuple), alors que Bastiat, le partisan de la liberté économique, prônait tout simplement la liberté des banques (formule nommée seize fois dans la seule douzième lettre), c’est-à-dire la régulation de la circulation monétaire par la dérèglementation du métier de banquier (soit la liberté d’accès à la profession) assorti d’une nécessaire responsabilité sur ses fonds propres. Ce petit retour en arrière illustre parfaitement l’imposture de certains libéraux actuels qui, loin d’appliquer les principes libéraux historiques, se situent objectivement dans la filiation d’un PJ Proudhon, dans la mesure où ils soutiennent un État qui contrôle en fait le secteur bancaire et favorise la création monétaire par la simple circulation irresponsable des crédits. Car il ne faut pas se laisser prendre à la farce de l’État soi-disant « à la merci des banques ». Il en est du secteur bancaire, comme de celui de la sécurité sociale, l’État avance masqué derrière un rideau de fumée en faisant mine de déléguer des pouvoirs qu’il exerce en réalité par sa toute puissance législative. Le réseau bancaire n’existe que par la volonté de l’État et son activité est soigneusement réglementée par lui. l’État est donc totalement responsable de son fonctionnement et porte l’entière paternité de la circulation financière qui irrigue le grand capital. Or, nous venons de voir que ce système est contraire aux véritables idées libérales…
En conclusion, il apparaît que la stigmatisation des grandes société capitalistes, souvent multinationales, est loin d’être contradictoire avec la défense d’idées authentiquement libérales. Tout au contraire, les véritables libéraux gagneraient certainement en influence, tout en désamorçant plus aisément les critiques réductrices de leurs adversaires, à prendre soin de se démarquer résolument du grand capitalisme, qui, comme démontré plus haut, fait quotidiennement le lit du réglementarisme et du monopolisme, deux des plus sérieux obstacles au développement du libéralisme économique ordinaire.

