À propos/autour de : Jockum Nordström au L.A.M. – Marieta Chirulescu à la Galerie Messen de Clercq – Dominique Quessada, L’inséparé, (PUF, 2013), Josep Pla, Le cahier gris, (Gallimard, 2013)

C’est un saut dans le temps, une manière inattendue de revivre les premières couches géologiques de ce qui forme et individue un brin de ce dont je procède, c’est retrouver le souvenir de quelque chose que je ne fais plus depuis longtemps, dont j’ai perdu la moindre once de savoir-faire malgré que, jadis, rien ne semblait plus important, vital. C’est renouer avec le comment je dessinais quand j’étais enfant, quand je passais des heures et des heures, crayons ou pinceaux en main, sans pour autant nourrir quelque ambition artistique, simplement pour le plaisir de faire, l’avidité d’éprouver, apprendre. Un état d’esprit d’observation et de reproduction de ce qui semblait relier ce qui retenait mon regard, capter mon attention. Entravé certes par une technique rudimentaire mais dont les limitations ne m’empêchaient pas d’avoir le sentiment de saisir ce dont j’avais besoin de retenir en moi. Graver les frayages correspondant à ce qui m’émouvait, me parlait. À partir de cela, probablement, de tous ces traits approximatifs imitant ce que je sentais de proche et désirable dans les choses, je me suis accroché à la vie, au tout, par cette action de tracer puérile, inlassablement essayée, échouée, répétée. Un trop plein et une hâte de rentrer en contact avec les surfaces, les volumes, les sèves. Tout d’un coup, dans les grandes salles du musée, brillantes d’une pénombre gris perle, je replonge dans un monde tissé d’images membranes de cette espèce primaire (comme on parle de forêts primaires), de dessins qui ont la facture de cet âge perdu et qui semblent immenses, comme s’ils étaient le réel originel. Une manière d’éprouver très vite et très fort le sentiment d’une perte, le rappel d’une expropriation d’un savoir, en tout cas quelque chose d’interrompu, de repris. Au fond, je savais dessiner, je ne sais plus, j’ai désappris parce que la manière était enfantine, dépassée ; elle me plaçait en décalage avec ce qu’est censé connaître un adulte en termes de savoir-vivre culturel. Pour continuer à dessiner, il aurait fallu apprendre des règles, se conformer à certaines techniques, passer à un autre langage, ne pas persévérer dans les voies approximatives. Évidemment, je ne prétends pas que je serais devenu aussi bon dessinateur que cet artiste reconnu que je découvre pour la première fois et qui, lui, a cultivé cette persévérance jusque dans ses moindres retranchements. Mais il y a une communion dans la manière de disposer les êtres, de les représenter dans l’espace, de mettre les différentes espèces du vivant en relation entre elles. Une communion avec toutes les enfances et qui ébauche un système de représentation dont, avec l’âge, on doit s’exclure. Ce sont donc les dessins d’une enfance. Celle de cet artiste précis, mais aussi celle d’un peuple auquel il appartient et qui le nourrit, son histoire et ses rêves, ses mythes, ses fascinations, ses conquêtes. Les images d’une genèse jamais achevée, toujours en cours, et l’on y aspire les molécules qui viennent régénérer le plaisir vital de se réinventer sans cesse des origines, en variantes continues. Ce sont des environnements imagés, des milieux associés que l’on absorbe comme sous perfusion. Des scènes de chasse. Des chevaux et des chiens. Des cavalières amazones en crinoline. Des cavaliers droits avec hauts-de-forme. Des bateaux qui appareillent ou s’installent dans les criques de nouveaux horizons, des relents de conquêtes, des escouades colonisatrices. Gloriole typiquement ressassée par des entités patriotiques. Et comment des germes de tout ça, histoire officielle collective probablement rabâchée dans les manuels scolaires et dans les contes déclinés sous toutes les formes, colonisent les esprits, produisent du même jusqu’à, un jour, rencontrer quelqu’un qui s’en empare, les déforme simplement en voulant extérioriser la manière dont ça grouille en lui, en rappeler l’insoutenable naïveté, l’agencement de violence native comme scène originelle d’une nation, à exorciser. « Tout ce que j’ai appris puis oublié », c’est le titre de l’exposition. L’inculcation et la libération. C’est exactement ce que j’ai le sentiment de contempler – l’inculqué oublié – quand mon regard vogue, à l’intérieur d’une des grandes planches de Nordström, sur les lisières des forêts, ou des bosquets plantés au milieu de prairies et si parfaitement saisis dans leur tremblement, dans leur manière de tomber en rideau abrupt. Il s’en dégage un climat qui me soutient pour reprendre un terme de Josep Pla quand il se décrit sous le charme d’une atmosphère potagère : « En ces fins d’après-midi de printemps, une des rares choses qui me soutienne un peu – je veux dire qui me divertisse – est la vue d’un potager, comme ceux qu’on trouve aux alentours du village. Admirablement cultivés, ce sont de purs, d’exquis délices de travail. J’entends la marche rythmée d’un vieil animal faisant tourner une noria mal huilée, qui grince. C’est la misérable musique d’une pauvreté émerveillée par des légumes tendres. Un homme, manipulant la corde d’un puits, remplit un bassin. Un gamin, la houe à la main, retouche un sillon. Une fraîcheur venue de la terre règne dans ces potagers. Le vert des feuilles, la pression de la sève, la souplesse des tissus végétaux semblent transmettre douceur et sérénité à l’esprit. La puissance de la récolte combat l’agonie de la lumière et de la journée. Observer le ciel, écouter les hirondelles, rêvasser, contempler l’imprécision de la vie des choses, calme les nerfs. » (Josep Pla, Le cahier gris, p. 75, Gallimard, 2013) Dans une nouvelle sorte de tables des savoirs – anatomiques, chimiques, alchimiques, biologiques -, et avec une précision articulée, exponentielle, rendre ses droits à la fondamentale imprécision de la vie des choses. Un effet de grande aération, malgré l’âge, ressentir le goût des premières avidités.
Certaines aventures artistiques offrent ainsi au sensible des champs d’exercices dont les secousses nous libèrent des valeurs sûres et des essences fixes, nous infiltrant dans les trames mouvantes, jamais assignées à quelque métaphysique que ce soit, du relationnel entre l’humain, les techniques, les choses, les environnements. Dans les salles du LAM tapissées des dessins et collages de Jockum Nordström, c’est exactement ce que je ressens : quelque chose de notre enveloppe – « notre », parce que l’on sait la partager avec de nombreux autres individus en dépit de son adaptation singulière à notre configuration – qui nous tient séparés des autres éléments du réel – et doit rester séparé pour entretenir la fiction que l’homme est d’une autre trempe que le reste de la nature -, se met à vaciller, à s’évaporer, en même temps que l’on entend au loin s’effriter quelques « bastilles ontologiques protégées par un fort mur d’enclos » (Dominique Quessada, L’inséparation, PUF, 2013). On se retrouve dans le faisceau rayonnant d’actions de l’esprit qui pratiquent et nous engagent à pratiquer sur nous-mêmes la déclôturation de l’en-soi occidental. D’abord par le choix d’une mise en question des savoirs liés à la représentation en perspective, libérant la prolifération de grilles de lecture complètement différentes du réel, de la manière de cohabiter entre humains, insectes, plantes, chevaux, images du présent, vestiges fantasmatiques du passé, hommes, femmes, sexe, chimères, maison, building, reproduction de l’ensemble et de ses parties, intra-actions disséquées de ce qui fabrique les mille-feuilles d’un imaginaire. Et de l’investissement de cet imaginaire dans une construction commune du monde qui brasse les interprétations singulières en un tout hétérogène individuant. Ensuite, surtout, le côté dessin d’enfant empreint d’une grande maturité décalée – l’enfance de l’art préservée dans l’expérience - bouleversant la hiérarchie entre l’important et le futile, dont les rouages figuratifs sont exposés dans des montages presque rupestres, presque sans âge, déconnectés de toute normalité surplombante, à la dynamique abstraite, conceptuelle. Des rêves saisis sur le vif et non décryptés. Tout cela bouleverse, comme une entomologie onirique pratiquée sur les formes imprévisibles que prennent nos désirs, faits de multiples fragments de rouages impromptus, parfois fresques de métonymies incongrues, qui nous échappent en même temps qu’ils sont ce en quoi nous consistons. Et l’on redécouvre la gestuelle érotique, à l’intersection des leçons de choses rurales et de dispositifs pervers, déjantés, habités par la neurasthénie urbaine trépidante, dans des collages d’une verdeur oubliée, parsemés de floraisons héraldiques, terminaisons nerveuses mutantes.
C’est pour cela, – pour ce lyrisme chaotique de l’inséparé – que, j’imagine, certains s’empressent de quitter ces salles, n’y voyant rien qui les accroche ou les raccroche à ce dont ils ont besoin de croire pour conforter leur exception humaine. Je me représente sans peine qu’un individu radicalement contre le mariage pour tous, comme on a pu récemment en voir les figures calamiteuses relayées par les médias, se sentira agressé, scandalisé par une telle exposition, en jugera l’esprit inconvenant et fondamentalement obscène, sacrilège. Parce que ces éléments radicaux sont absolument au service de la clôture des choses, dans la défense constante des bastilles ontologiques occidentales irriguées du sang pur de leur race supérieure où la « Nature » définit une bonne fois pour toute le rôle et l’usage des sexes, la place des uns et des autres dans une hiérarchie au bénéfice de ceux qui fantasment cette « pureté » comme étant leur qualité, leur bien le plus précieux à défendre coûte que coûte. Or, là, ce que Jockum Nordström montre, c’est que prime l’impureté, sans elle pas de vivant, hors l’impur c’est l’entropie. « La logique de la pureté, celle d’imaginer résider dans un en-soi défini ou garanti par une frontière, quelle qu’elle soit, est nécessairement une option ouvrant à la défense paranoïaque de son territoire. La pureté de l’en-soi est, au fond, ce qui a fait que l’Autre a toujours constitué le problème le plus inéradicable de la pensée métaphysique de la substance, l’essence antagoniste de toutes les essences. La pureté est captive, par les rets de sa propre logique, d’une obligation de matérialiser un Autre qui la met en danger, un allogène lui permettant d’espérer maintenir sa pureté dans le combat qu’elle mène contre lui. » (Dominique Quessada, L’inséparé, p.290) Ce que confirment les aberrations raciales de l’idéologie coloniale que décortique méticuleusement Ann Laura Stoler : « Les documents juridiques témoignent d’une tension entre, d’une part, la croyance dans le caractère immuable et fixe de l’essence raciale et, d’autre part, la conscience quelque peu gênante de la porosité et de l’inconstance des catégories raciales. Ils montrent aussi que les essences définissant le colonisé et le colonisateur étaient asymétriques. Si les Javanais ou les Vietnamiens pouvaient à tout moment retourner à leurs affiliations indigènes naturelles, la fragile essence hollandaise risquait au contraire de devenir chose javanaise par accident. » (Ann Laura Stoler, La chair de l’empire. Savoirs intimes et pouvoirs raciaux en régime colonial. La Découverte, 2013) L’attitude de ces opposants au « mariage pour tous » cristallise à propos de l’homosexualité tout ce délire sur la pureté de la race ainsi que sur la distinction entre les genres, sur une culture et une civilisation érigées contre la dégénérescence. C’est cela que dénouent les collages de Nordström, c’est cela, le bien fou qu’ils font au sensible, sans pour autant occulter les menaces que représente toujours et tous les jours la tentation paranoïaque de la pureté. Elle est tapie dans les recoins des compositions, complexes sous leur apparente naïveté. Dans les reliefs hachurés, marqueteries surprenantes de languettes de cartons et papiers, frappés de bouts de textes, spasmes d’encre brute, cris typographiques en morse haletant, pâmé, comme des bandelettes de cartes mémoires cérébrales transformées en parchemins, par dessus flottent une souche d’arbre araignée, des nuages lombrics ou batraciens, des silhouettes de sapins sorcières, des mobiliers retournés, des outils de bûcheronnage, des gentlemans attardés, des corsaires égarés, des femmes nues qui prennent les choses en mains, des livres empilés ou ouverts à la bonne page. Et ces tapisseries striées de ce qui se grave dans les plis du vivant ont le même rythme que ces sculptures en carton reproduisant des ensembles de logements sociaux, d’urbanisme empilé, ou encore à ces autres peintures/collages d’organologie où fonctionnent ou dysfonctionnent ensemble des usines, des leçons de piano, des bungalows alignés, des organes génitaux, des croupes, des seins nus et des fantômes de chevaux, des tables scolaires, des bureaux d’ingénieurs, tout ce passage de l’artisanat à l’industrialisation des espaces mentaux, de la fabrique des cadres de vie et des schémas intérieurs, entrecroisement d’intimes et de structures collectives, encadrement et canalisation des pulsions qui fument au sommet des grandes cheminées en briques. Enfin, rien n’est jamais montré – paysage naturel, montagne, paysage urbain ou industriel, intérieurs de logis, scènes de mœurs, tranches de vie mémorielles – sans le froissement de murmures pouvant le lézarder, le basculer dans les précipices géologiques où tout retourne aux entrailles pour rejaillir autrement, forcément hybridifié. C’est un fabuleux entrelacs de ces murmures ombrés, au repos, en attente, que l’on contemple dans la vitrine où sont accumulées les formes peintes et découpées que l’artiste prépare en série, faisant des provisions d’objets et de sujets qu’il utilisera dans ses futures compositions.
D’une autre manière, en se concentrant sur des aspects microscopiques de ce qui militarise la narrativité hyper technologique, alors que Jockum Nordström nous lance à la figure l’haleine vivifiée des grands récits en bouffées différenciées, Marietta Chirulescu s’attaque à l’impersonnalité mécanique qui dénature et sature notre capacité à voir, sentir, lire. Elle puise dans la grande marée numérique des signes et des codes que l’on ne distingue plus, subliminaux comme on dit, et qui, pourtant, conditionne et strie, encombre notre mental, l’ensevelit dans cette surabondance qui devient un horizon indépassable, quelque chose d’impensable et que l’on renonce effectivement à déchiffrer et contre quoi il est inutile de s’opposer. Une marqueterie de signes congestionnée, asphyxiée. Un point de non-retour où l’on devient consommateur de soi-même dans la naturalisation de l’accélération technologique comme un rythme de vie dont plus personne ne peut refuser la synchronicité. Mais dans cette saturation lisse, Marietta Chirulescu isole les défauts, les ratés imperceptibles, les retouches insoupçonnées qui sortent des multiples machines autour de nous, produisant à l’infini les images imprimées, les tableaux de données qui rationalisent les informations sur toutes nos habitudes de consommateurs, ce que l’on fait passer pour la vie. Elle fouille les poubelles du numérique, le hors champ technologique, elle « utilise comme sources des documents recadrés, photos trouvées, images scannées, archives imprimées et remaniées… » (feuillet de la galerie Messen De Clercq). Elle les transforme en images esthétiques gratuites, minimalistes, imprimées sur toiles – ce support ancien, presque anachronique par rapport au matériau qu’elle exploite -, les hybridant quelques fois avec des techniques picturales anciennes, comme des vrais coups de pinceaux… Elle extrait de la grisaille dense du binaire des signes qui, dans les flux pressurés, ont déraillé, elle les récupère, en inverse la valeur en les passant au crible de sa machinerie imaginaire solitaire, individuelle et individuante. Elle les recycle dans une économie mentale différente, sans finalité marchande, hors circuit, elle casse la rapidité du flux en exposant, grossis considérablement, des détails, des moignons de logo tout puissants, des bribes cabalistiques de cette langue machinique qui nous traverse en permanence. Des accidents, respiratoires. Dans ce qui est censé se transmettre à la vitesse de l’éclair pour éviter le temps de réflexion et de traduction/transformation, elle repère des accrocs, des frictions ou dérapages et en tire des images qui met l’accélération en arrêt, le cerveau sur pause face à de petites toiles énigmatiques dont l’esthétique graphique est celle de bugs salutaires, isolés. Comme de nouvelles synapses perdues dans le vide, devant chercher à quoi se connecter, se réinventer. Comme une vue imprenable sur le sol d’une planète lointaine, aride, dépouillée d’imaginaires anarchiques, relationnels. Dans les pièces blanches de la galerie, les petites toiles rares sont des hublots sur l’incommensurable bactériologique de ces signes machiniques industriels qui font table rase des autres écritures/lectures à la manière d’antibiotiques détruisant une flore intestinale. Simultanément, la force picturale des fenêtres minimales constitue un contrepoison, installe dans le cadre l’espoir d’une réappropriation symbolique. La réversibilité, par les vertus du déchet, de l’écriture/lecture industrielle à quoi s’offre alors la régénération, de nouvelles inventions, l’espace libre de l’interprétation. Sous une autre forme que chez Nordström, ici aussi, les techniques d’aération par déclôturation. (Pierre Hemptinne) - Jockum Nordström au L.A.M - Marieta Chirulescu -
















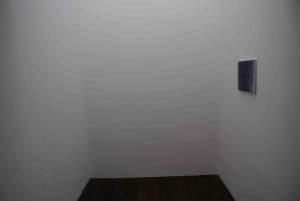
Tagged: collage, environnement numérique, héritage colonial, lecture numérique
