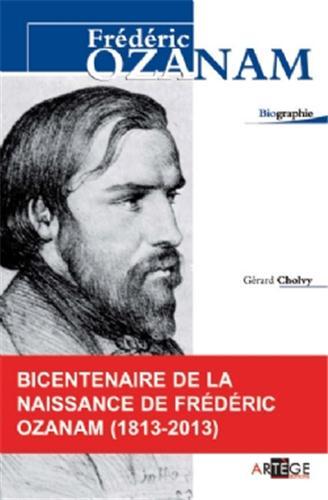
Frederic Ozanam, Gérard Cholvy, Ed. Artège, 2012, Perpignan, 317 p.
Ce mardi 23 avril, nous fêtons le bicentenaire de la naissance du bienheureux Frédéric Ozanam. Gérard Cholvy, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université Paul Valéry, auteur d’une excellente biographie de ce grand laïc catholique du XIXe siècle, nous dresse un exceptionnel portrait de ce champion de la charité.
Dans le langage courant la charité a plutôt mauvaise presse, « faire la charité » ou … donner la petite pièce à un pauvre. Aujourd’hui, nous préférons parler de solidarité, un mot popularisé, dans le vocabulaire catholique, par Solidarnosc dans les années 1980. On peut aussi invoquer la fraternité qui fait partie de la trilogie républicaine.
Une telle répugnance n’est pas nouvelle. On pouvait lire sur une affiche d’un groupe d’ouvriers parisiens, en 1848, « Nous ne sommes pas des gens qui demandons l’aumône ». Frédéric Ozanam était alors pleinement conscient de cet obstacle : « la charité est devenue suspecte aux yeux du peuple […] pour lui en parler il faut des détours. Ah ! que la charité fut compromise par ceux qui la pratiquèrent mal », déclare-t-il, lors de l’Assemblée générale de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, le 2 août 1848. De fait, la Révolution parisienne de février n’avait pas pris au dépourvu celui qui venait d’inviter à « passer aux Barbares ». Dans la 24e leçon de son Cours de droit commercial, professé à Lyon, en 1840, on peut lire que « La charité c’est le samaritain qui verse l’huile dans les plaies du voyageur attaqué. C’est à la justice de prévenir les attaques ». Ne pas séparer l’une de l’autre, la réflexion est en avance sur son temps : l’auteur ne va-t-il pas alors jusqu’à demander que l’ouvrier ait « droit à une retraite » : la première loi les concernant sera votée en France en… 1910.
Alors la fraternité ? Dans sa Lettre aux électeurs du département du Rhône (15 avril 1848) Ozanam, qui propose le droit d’association et l’impôt progressif sur le revenu – celui-ci ne sera voté qu’en 1914 – écrit que la fraternité « se rapproche de la plus grande vertu chrétienne, la charité ». Se rapproche oui, et cette trilogie lui semble sortir tout droit de l’Évangile, mais la charité c’est plus que la fraternité « car tous les frères ne s’aiment pas » (22 octobre 1848). De la charité ce chrétien instruit, cet excellent latiniste et helléniste, se fait la plus haute idée : il n’ignore pas que des trois vertus théologales, la plus grande c’est bien la charité. L’exemple concret lui en a été donné par ses parents. Sa mère avec la Société des veilleuses, ancêtre de nos congrégations de garde-malades à domicile[1], son père, médecin, qui gravissait les étages où logeaient des pauvres pour les soigner gratuitement.

Frédéric Ozanam fut à l’initiative des sociétés de Saint-Vincent de Paul.
Dans le combat social qu’il mène en 1848, il entend donc réhabiliter la charité. Oui, l’assistance « humilie quand elle prend l’homme par le bas, les besoins terrestres seulement. Oui, elle humilie si elle n’a rien de réciproque, si vous ne portez à vos frères qu’un morceau de pain, un vêtement, une poignée de paille. Mais l’assistance honore quand elle prend l’homme par le haut, quand elle joint au pain qui nourrit, la visite qui console, le soleil qui éclaire, le serrement de main qui relève le courage abattu ; quand elle traite le pauvre avec respect, non seulement comme un égal, mais comme un supérieur parce qu’il souffre ce que peut-être nous ne souffririons pas » (« De l’assistance qui humilie et de celle qui honore », L’Ère Nouvelle, 22 octobre 1848). Il n’en oublie pas pour autant la justice, lui qui félicite le député Armand de Melun, confrère de Saint-Vincent-de-Paul, luttant, à contre-courant pour faire adopter quatre lois, sur les logements insalubres, les caisses de retraite, les sociétés de Secours mutuels, et les contrats d’apprentissage. Grandes étaient les résistances à ce programme « socialiste », parmi les partisans de la seule charité privée : « votre zèle, Dieu le bénira » écrit cependant Ozanam le 13 octobre 1849 à son auteur.
Il ne s’agit chez lui, en aucun cas, d’une conversion récente, car « la question qui divise les hommes aujourd’hui […] c’est une question sociale. Une lutte se prépare […] d’un côté la puissance de l’or, de l’autre la puissance du désespoir […]. Notre titre de chrétiens nous rend obligatoire [le] rôle de médiateurs. Voilà l’utilité possible de notre Société de Saint-Vincent-de-Paul » (à Louis Janmot, 13 novembre 1836). À l’origine, dans l’esprit d’Ozanam il s’agit d’une « association d’encouragement mutuel pour les jeunes catholiques où l’on trouve amitié, soutien, exemple » (à Léonce Curnier, 4 novembre 1834). Ces jeunes gens, ce sont des étudiants montés à Paris, cette « Babylone de l’Europe ». Or, poursuit Frédéric, « le lien le plus fort, le principe d’une amitié véritable c’est la charité ; et la charité ne peut exister dans le cœur de plusieurs sans s’épancher au-dehors […]. Ainsi c’est dans notre intérêt d’abord que notre réunion a été fondée, et si nous nous donnons rendez-vous sous le toit des pauvres, c’est moins pour eux que pour nous, c’est pour devenir meilleur et plus ami ».
Les pauvres ? Ils sont « pour nous les images sacrées de ce Dieu que nous ne voyons pas […] nous les voyons des yeux de la chair » (à Louis Janmot, 16 novembre 1836).
À la pensée d’Ozanam la Société de Saint-Vincent-de-Paul doit beaucoup. En quoi était-elle novatrice ? Tout d’abord en ne pratiquant pas la règle du secret, celui des congrégations mariales et des loges maçonniques : sans pour autant « se faire voir » comme les confréries paroissiales dont les membres défilent derrière leur bannière, il faut « se laisser voir ». « L’apostolat des laïcs dans le monde » (1835, bien avant la reconnaissance par Vatican II) est une nécessité dans le Paris des débuts de la Monarchie de Juillet. La Société va donc être une œuvre créée par des laïcs, dirigée par des laïcs et n’engageant pas la hiérarchie de l’Église avec laquelle il conviendra d’entretenir de bonnes relations. Ceci évitera toutes les difficultés qu’ont rencontré les mouvements de l’Action catholique spécialisée au xxe siècle, avec la question du « mandat ». Ozanam précurseur du catholicisme social avant l’impulsion que lui donnera Léon XIII avec Rerum novarum (1890).
Lors de la visite des pauvres chez eux – ce n’était pas une nouveauté absolue – certains vont découvrir l’ampleur de la « Question sociale », concrètement, par exemple, la crise de l’apprentissage avec les conséquences du machinisme. Quelques-uns, dont Ozanam, sont amenés à rechercher des solutions entre libéralisme économique et dirigisme étatique… ou la difficile « troisième voie ». Les confrères « des médiateurs entre le riche et le pauvre ». La Société devient alors, dans le monde urbain, le principal vecteur du retour à l’Église d’une frange instruite du monde masculin : ne pas oublier que le nombre des bacheliers est inférieur à 3 000 par an. Ceci avant que l’application de la loi Falloux (un confrère…) après 1850, ne permette l’ouverture de collèges secondaires, dont ceux des Jésuites.
Frédéric Ozanam, un apôtre qui sut concilier dans sa courte existence la philia, l’amitié ; l’agapè, le partage, celui qui donne reçoit plus que celui qui reçoit ; sans oublier la troisième dimension de la charité, l’eros au sein d’un couple qui parvint à tout partager : c’est Amélie qui traduisit les Fioretti de saint François d’Assise, point de départ du franciscanisme en France.
Un apôtre dont on ne saurait oublier l’apostolat en Sorbonne, avec ses recherches (Dante ou les Germains) son enseignement, ses contacts avec les étudiants et ses collègues : relever le défi de l’évangélisation de l’intelligence. Concilier la religion et la liberté avec les grandes espérances nées chez lui du « Printemps des peuples » et qui furent terriblement déçues. Une liberté qui n’est pas l’absence mais l’intelligence de la loi. Ozanam eut le souci de l’Église locale et le sens de l’Église universelle, c’est un « Européen » en avance sur son temps. Comme une Madeleine Delbrêl au XXe siècle, l’objectif qui l’habitait de bâtir des ponts fait de lui un passeur, de ceux dont le christianisme a besoin. Un modèle, et toujours actuel. Non le modèle car on peut lui préférer, selon sa sensibilité un autre modèle, celui de son contemporain, le journaliste intransigeant Louis Veuillot[2].
Gérard CHOLVY
[1] « Les Garde-malades » chap. 8, Le XIXe Grand siècle des religieuses françaises, Artège, 2012 et du même auteur.
[2] Gérard CHOLVY, Frédéric Ozanam. Le christianisme a besoin de passeurs, Artège, 2012.

