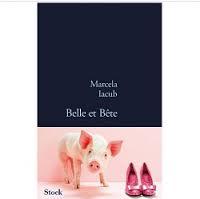 Iacub. La littérature a tous les droits – pas un auteur. La nouvelle affaire DSK s’appelle donc Belle et Bête, livre à vocation médiatique publié chez Stock, dans lequel la juriste Marcela Iacub raconte jusqu’au sordide ses sept mois de liaison avec l’ancien patron du FMI, de janvier à juillet 2012. Jamais le nom de l’ancien ministre socialiste n’est écrit noir sur blanc. Mais pas de doute: «J’étais persuadée que si un autre politique français avait été arrêté à l’aéroport de New York à ta place, tu aurais crié avec la foule.» Le tutoiement pour forme. La vulgarité et le lynchage public comme objection. Car nous lisons, atterrés, la longue chronique d’une passion avec celui qu’elle nomme l’«homme-cochon». Ainsi: «Même au temps où ma passion était si fastueuse que j’aurais échangé mon avenir contre une heure dans tes bras, je n’ai jamais cessé de te voir tel que tu étais : un porc. C’est ma compassion pour ces animaux si dénigrés qui a éveillé mon intérêt pour toi.» Plus précis: «C’est parce que tu étais un porc que je suis tombée amoureuse de toi.»
Iacub. La littérature a tous les droits – pas un auteur. La nouvelle affaire DSK s’appelle donc Belle et Bête, livre à vocation médiatique publié chez Stock, dans lequel la juriste Marcela Iacub raconte jusqu’au sordide ses sept mois de liaison avec l’ancien patron du FMI, de janvier à juillet 2012. Jamais le nom de l’ancien ministre socialiste n’est écrit noir sur blanc. Mais pas de doute: «J’étais persuadée que si un autre politique français avait été arrêté à l’aéroport de New York à ta place, tu aurais crié avec la foule.» Le tutoiement pour forme. La vulgarité et le lynchage public comme objection. Car nous lisons, atterrés, la longue chronique d’une passion avec celui qu’elle nomme l’«homme-cochon». Ainsi: «Même au temps où ma passion était si fastueuse que j’aurais échangé mon avenir contre une heure dans tes bras, je n’ai jamais cessé de te voir tel que tu étais : un porc. C’est ma compassion pour ces animaux si dénigrés qui a éveillé mon intérêt pour toi.» Plus précis: «C’est parce que tu étais un porc que je suis tombée amoureuse de toi.» Ou encore: «La liste de tes conquêtes d’un jour, de tes victimes, de tes putes successives et concomitantes dont la presse ne cessait de s’horrifier et de se régaler montrait un autre aspect émouvant de ta vie de cochon. Ces femmes étaient laides et vulgaires. Comme si en chercher des jolies était déjà une manière d’être plus homme que cochon.» Le but de Iacub, ne plus être une «humaine véritable». Car il lui révèle «à quel point c’est beau d’être une truie dans le rêve interminable d’un porc». Car le cochon aime tout: les grosses, les sales, la souillure, la salissure et même les bouts d’oreille. D’autant que la truie n’est jamais loin. Son épouse l’aurait en effet laissé «se promener» car «il n’y a pas de mal à se faire sucer par une femme de ménage». Stop. Arrêtons-là le récit nauséeux…
Morale. Est-ce de l’art ou du cochon? S’il ne s’agissait que de se dire, comme Fernando Pessoa, que «la littérature est la preuve que la vie ne suffit pas», nous pourrions nous contenter de rigoler en silence sans nous demander de quelle schizophrénie procède ce livre, apparaissant soudain comme une pièce supplémentaire versée au procès dont le visiteur du Sofitel et du Carlton est l’accusé ad vitam aeternam. Sauf que cette schizophrénie se fonde également sur une répartition des rôles de type incestueuse entre la presse et le livre. Six pages laudatrices dans le Nouvel Observateur, trois dans Libération. Et aucune réponse à cette question: sommes-nous prêts à vivre dans une société où la prostitution morale et le profit du papier vite vendu deviennent la règle? Quand le cynisme et le nihilisme tiennent lieu de morale civile, nous préférons citer Flaubert : «Le difficile en littérature, c’est de savoir quoi ne pas dire.»

Marcela Iacub.
Angot. Et puis Christine Angot s’en est mêlée... N’était – pour le coup – l’intelligence du propos, l’affaire serait presque devenue gaguesque. Sauf qu’elle a mis dans le mille. Irritée, choquée et pour tout dire carrément révoltée d’avoir été comparée à Marcela Iacub, la romancière et dramaturge a signé un long texte cette semaine dans le Monde sur le principe du «Non, non, non et non». Contestant l’idée de participer à toute «littérature expérimentale», parce que «l’expérience n’a rien à voir avec la littérature», Angot déclare préférer «la vie oui, la vie vécue, la vie pensée, la vie subie, la vie non pas ‘’traversée’’ mais vécue sans avoir été ‘’calculée’’», ce qu’elle appelle «la corne du taureau qui vient vers vous et pas le contraire», histoire de répondre vertement à Philippe Lançon, qui, dans Libération, évoquait à propos de Iacub «une littérature expérimentale, violente comme ce qu’elle traverse, inspirée par un esprit de risque et de performance, qui cherche à approcher au plus près de la corne du taureau». Christine Angot s’insurge. Elle n’a pas tort. Le bloc-noteur ne redira pas ici tout le mal qu’il avait pensé de son dernier livre, Une semaine de vacances (Flammarion), lecture aussi éprouvante que choquante. Néanmoins, Angot nous donne raison, en quelque sorte, quand elle écrit: «Marcela Iacub jusqu’à présent n’a sauvé personne, malgré ses intentions de départ. Arrêtons de nous prendre pour des nonnes sauvant des hommes perdus, malheureux, faibles comme des petits garçons, arrêtons de nous prendre pour des mamans corrompues, c’est juste dégueulasse.» Pour avoir elle-même abusé de ce mode de narration, Angot le sait mieux que personne : l’imaginaire est délaissé au profit du vrai-vécu par lequel nous ne savons plus éclairer la réalité. Car la frontière est ténue entre l’autofiction et le voyeurisme obscène et racoleur. «Oui, la littérature pense, écrit Angot. Oui, la littérature pense quelque chose.» Voilà pourquoi la littérature a tous les droits. Voilà pourquoi l’auteur ne devrait jamais oublier que la littérature peut mener à tout, pourvu qu’on ne s’en serve pas…[BLOC-NOTES publié dans l'Humanité du 1er mars 2013.]

