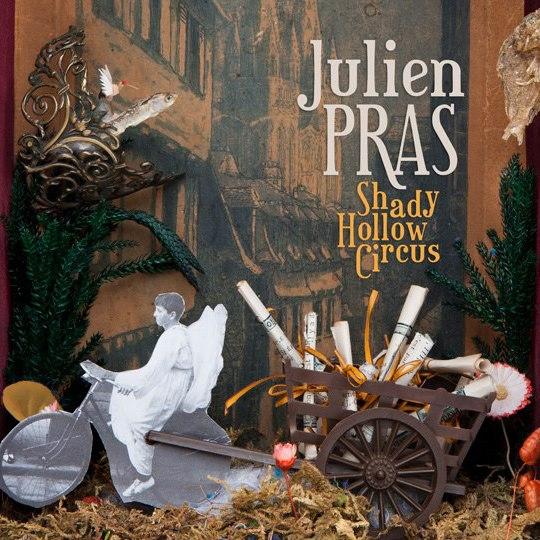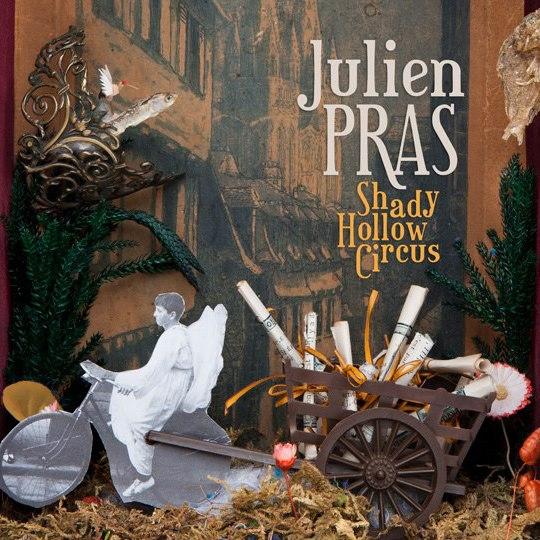Petit bonhomme de chemin.
On connaît Kerouac, l’homme, l’écrivain, le mythe. Son obsession de la route qu’il sillonnera des années durant sous drogues et dont il tirera un manifeste littéraire, bref, son plus fameux roman. Ce n’est pas tant le voyage qui nous intéresse ici mais cette vision têtue, cette démarche ressassée, cette envie, ce besoin de parcourir les mêmes foutus kilomètres dans un sens comme dans l’autre et au hasard des villes, des circonstances, lier des amitiés profondes, indéfectibles. Finalement, l’auteur réussit à créer une intimité avec son matériau, un bout de bande fumante, granuleuse, dépliée à l’infini jusqu’à l’horizon. Il en va de même de Julien Pras et de la musique. Sa musique. Il a beau l’arpenter depuis plus d’une décennie, en maîtriser les moindres recoins, il parvient toujours à trouver de nouvelles directions, des chemins vicinaux reliant une chanson, un album à l’autre. Lui aussi possède cette hantise, vécue ici pour la Chanson. Pas tant la chanson courte et directe, mais celle qui tout en séduisant d’emblée cache des trésors insoupçonnés. Comme un pays dont on serait imprégné sans l’avoir entièrement visité : il reste toujours une parcelle inconnue à découvrir. Il faut dire que le background du musicien lui en offre le luxe. En effet, la musique de Julien Pras est à la croisée des genres et des mondes : un savant mélange de pop, pour l’immédiateté, les refrains que l’on entonne, et la folk, plus intellectuelle et spirituelle qui sait se jouer du temps. De plus, Pras a su trouver différents formats pour exprimer ses ambitions musicales, d’abord collectif au sein de Calc, puis personnel avec ce deuxième album signé sous son patronyme. À la différence de Kerouac et de ses personnages, le compositeur bordelais ne se dissimule pas. Jamais il n’endosse une autre identité qui pourrait le propulser, lui et sa musique, dans la grande mythologie du rock. Il est et restera Julien Pras, songwriter français ayant fait honnêtement le choix de l’anglais dont la langue, fondamentalement mélodique, correspond à ses premières amours indie pop. Les seules. Pas plus qu’il n’a succombé aux tentations de la hype incarnée (?) par des hipsters à ourlets roulés sur fond navrant de chaussettes rouges. Julien Pras est un puriste et s’il s’embarrasse de détails, ça n’est qu’à la faveur de l’écriture et de l’enregistrement. Même si les compositions ont gagné en efficacité, elles n’en demeurent pas moins incroyablement ouvragées. Chose inédite, on y perçoit des souvenirs de fanfares, de grand-huit aux couleurs et parfums de fêtes foraines. Détail délicieux, certaines guitares, certains motifs d’orgue rappellent le Genesis de Foxtrot comme sur Ghost Patrol, Pras ayant le bon goût de ne pas forcer le trait, la comparaison. Ainsi, la première face – car il faut toujours raisonner ainsi – relève du sans faute. Elle renferme ses instants paisibles et ses moments intenses. De Seven More Hours au fragile Missionary Run, osant un arrangement de cordes qu’un George Martin n’aurait pas renié. La deuxième face s’ouvre sur l’universel White Lies, surprenant par ses inflexions heureuses, solaires, comme échappées d’un studio californien où se forgerait un nouveau Classique estampillé Laurel Canyon. Ici, le piano a presque supplanté les guitares d’où cette sensation de paix intérieure, de limpidité, – osons le mot – de ferveur. Alors que les premiers titres arboraient une tonalité anglophone –Funeral Mute en est un vibrant exemple –, les morceaux s’américanisent sur la fin. N’y voyez nulle ironie car le résultat est sublime, en témoigne l’équilibre parfait atteint sur Watchman Blues. Pour conclure, Shady Hollow Circus n’en finit pas de rappeler On The Road. Car une fois arrivé, le moteur coupé et le pied posé, on n’a qu’un désir : repartir.
http://www.deezer.com/fr/album/6194854