François Bon
« Temps machine »
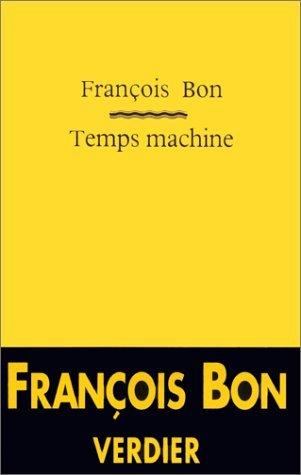
François Bon résume ainsi son livre : « Comme si une fascination non résignée avait obligé, mais à reculons, en se faisant à soi-même violence, de revisiter le monde défait et cassé des usines. Cela traversé autrefois la tête trop raide pour s’en dégager par une vue générale : obligeant à procéder par ces éclats arrachés, ces visages qui restent, et la mémoire plus précise des machines. Laissant travailler l’immense réserve plastique d’images, Moscou, Bombay ou Vitry-sur-Seine, à seule force d’éléments récurrents, abrasifs, pour retrouver la part qui nous revient d’une épopée désormais close ».
C’est un peu comme un retour en arrière, un retour visité et revisité par tant et tant de mots - parfois, on sent comme un amer mais si précieux souvenir chez l’auteur - ; oui, en arrière, ce temps dévolu au travail, au temps des machines, quand François Bon arpentait le plancher des usines où il a travaillé, ici et ailleurs dans d’autres mondes. Mais son rappel a quelque chose de poétique.
J’ai travaillé aussi dans des usines, jeune, puis, j’ai côtoyé des propriétaires d’usines, un jour prof-chercheur en gestion d’entreprise.
Son livre m’a rappelé, m’a fait rêver, des moments que j’avais un peu oubliés : jeune étudiant gagnant sa croute pour des études supérieures dans le monde des travailleurs d’usine, - le temps d’un travail d’été, à chaque été - un monde que l’on découvrait, un peu mystérieux, mais si vrai de réalisme ; oui, ce monde était plus vrai que nature, et il nous rendait heureux, heureux parce que nous avions cette impression de devenir de vrais hommes quand nous nous salissions les mains, d’huile, de graisse, de poussière ; des hommes virils quand nous les côtoyions, ces hommes des usines, qui nous montraient « ostensiblement » leurs muscles, leurs forces, leur autres vraies vies aussi quand nous sortions de notre shift pour aller prendre une bière avec eux à la sortie de l’usine, tout juste de l’autre côté de la rue, à la taverne. Nous avions alors l’impression d’être des leurs parce que nous buvions nous aussi de grosses bières... jusqu’à plus soif sinon jusqu’à l’ébriété trop souvent.
J’ai revu ce monde dans le livre de Bon, un monde contraint dit l’auteur, mais un monde libre pour moi, trop jeune encore pour y mesurer toute la misère qu’il cachait, toute l’exploitation du travail, des mains, de la tête, et des sentiments de ces hommes qui s’acharnaient, qui mettaient tellement de ferveur parfois à se dépasser. Bien sûr, je me rappelle les paresseux, mais je me souviens mieux des hommes fiers de leur travail. Ce n’est que peu de temps après, alors aux études, et lisant Le Capital de Marx que j’ai mieux compris certains aspects liés au travail et qui ne peuvent être démentis, comme l’aliénation.
Mais ce n’est pas avant un certain nombre de pages que j’ai pu apercevoir ce dont je viens de parler. J’ai d’abord dû comprendre le texte, lire plus d’une fois certaines phrases, reprendre même certain chapitre – comme celui des Bon-famille – pour mieux repérer ce monde des machines. Puis tout est venu plus facilement ; je vois ce texte comme une pure poésie, celle du métal, celle de l’odeur reconnaissable de l’huile chaude, celle de toutes les odeurs, celle des salissures, celle de longues « listes » de choses, d’hommes, de machines, de lieux, de temps... oubliés et remémorés. Oui, de la poésie à longueur de phrases qui montrent, qui nous font ressentir, sans les décrire, des odeurs, des situations de travail et des malaises, des catastrophes de travail obligé, des programmes structurés et pensés scientifiquement. Poésie de l’étranger, de la terre étrangère, aussi, de ces lieux et de ces manières autres qui désacculturent, où le son de sa propre langue ne vient plus à l’oreille que quand on se les dit, ces mots qui rappellent le pays d’où l’on vient, et que l’on oublie ces autres mots, d’une autre langue, que l’on s’efforce de baragouiner pour ne pas être trop absents du monde où l’on a abouti, pour un petit temps, obligé, toujours trop long. Poésie des petits arrangements avec les maladies industrielles possibles.
Poésie aussi des mots qui me demandaient souvent d’ouvrir le dictionnaire ; oui, pour comprendre ces mots qui souvent ne m’évoquaient rien et, comme le dirait Bon, « qui me prennent le volume entier du crâne » ; et pourtant, j’en connais de ces mots d’usines et de machines ; mais ici j’avais affaire à un « orfèvre » de la construction de mots mis en ordre et arrangés qui décrivent et font apparaître tout un monde. Je crois bien que celui qui n’a pas travaillé en usine ne peut comprendre le texte, - ce monde - à moins, oui, à moins de se laisser bercer par les mots, il y a une sorte de musique dans ce texte qui ne laisse pas indifférent. Il suffit de se laisser aller à la lecture, se fondre dans la musique des mots ; on entre alors en connexion avec l’auteur, avec le message, avec le réel.
Il n’est pas question d’analyse, de thèses, d’essais dans ce livre ; que des souvenirs ; que de « l’odeur insistante du cuir et des tuyaux », que des noms de collègues aujourd’hui disparus, recyclés, morts ; que des fantômes d’objets et de machines ; que des témoignages visuels – ces départs en retraite fêtés avec des cartons de Ricard - ; que des souvenirs d’usines de briques et de vieilles centrales thermiques ; que des rappels du travail de l’acier ; et encore tellement de souvenirs de ces autres lieux bizarres où l’on s’est échoué, obligatoirement requis : Moscou, Göteborg, Prague, Chine, Bombay, Chicago...
Pas d’analyse disais-je, j’oublie peut-être ces petits moments de blues amers : 1- « lever à six heures réveillés par la meute hurlante, acceptant à tant de dizaines contre une poignée d’être ainsi à dix-huit ans bafoués, rampants ou agenouillés ». Ou encore 2- « l’escalier social... pour petits cadres à cravates sages, l’obsession de ce qu’ils disent monter ». Ou encore 3- « La nuit aussi qu’un camion avait dévalé contrebas, restait là au petit matin ses quatre roues en l’air, la trace de quarante mètres que ça faisait dans la couche peuplée, que ça n’avait même pas mérité un article de journal ». Ou encore 4- « en revenant le matin à six heures à l’usine on se dit n’être à vingt-six ans qu’un mort qui marche et que rien du reste ne compte ».
Poésie des détails, devrais-je ajouter et qui ne démentent pas ces analyses qui n’existent pas, et qui les montrent mieux que ne peuvent le faire les mots savants : « habitudes imprimées à la crasse sur les coussins des tabourets... les marques noires sur les poignées de tiroirs... les premiers suintements aux lèvres... le bruit qui, malgré le casque et les ses coussins sur les oreilles, passait par les os... »
Poésie de la « porte jaune », chez les Bon, qui introduit, qui donne sur des couloirs, escaliers, autres pièces, corridors, magasins, bureaux, seuils, chambre... oui, « l’éternelle porte jaune par quoi on entre dans le mystère d’un texte ». Il y a des tonnes de souvenirs dans la tête, dans les têtes des Bon ; une grand-mère qui se souvient, un grand-père qui pleure en montrant ses mains.
Poésie des souvenirs d’un autre temps, ce temps des machines d’un autre temps : « Qui donc saura la richesse que c’était là... qui saura ce qu’il y avait là d’une fin du monde puisque déjà les hommes y avaient tourné le dos » ? Alors que maintenant, chaque outil a son calculateur numérique. L’expression « bras de fer » s’oppose à ce que savent, ou ne savent pas, ceux-là qui aujourd’hui portent « leurs anneaux à l’oreille et des guitares électriques en tatouage », et qui ne peuvent se souvenir ce qu’était autrefois la fabrique des alternateurs, et ce qu’était « le maniement à main d’homme, sur le sol tremblant et les bras liés aux chaines de sécurité ».
Ce livre est dédié aux morts, aux machines mortes, aux hommes morts sur ces machines, à tous ceux-là, hommes et machines qu’on oublie trop facilement et « les doigts qui manquent, les bras coupés au poignet et les lames de scie tournantes ». Morts les magasiniers, morts les étaux-limeurs et ceux qui les servaient, mort le métier qu’on disait de chaudronnerie, mort Dunand, mort Turpin, mort Cardin, et ... tant d’autres qu’on a déjà oubliés. « Comment à la mort même nous étions aveuglés quand tout déjà s’écroulait », raconte Bon ; ainsi ceux-là qui ne se voyaient pas morts, mais qu’on avait relégués aux magasins, guichets et paperasses, parce que devenus inutiles et bons à si peu dans la filière production.
« Le monde est fragile et s’alourdit... ce n’est plus un siècle à main », écrit Bon ; ce n’est plus qu’un monde à numéro. Les mains noires, c’est fini. Bon est triste de la révolte qui ne vient pas parce que la force de... n’existe plus.
