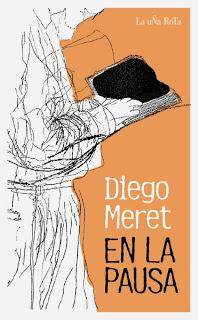
En la pausa de Diego Meret (Moron, province de Buenos Aires, 1977) est un livre qui nous reconcilie avec l'autobiographie, ce genre qu'une certaine médiocrité littéraire française avait fini par nous faire haïr. Avec ce texte court, on (re)découvre comment la pratique du "je" est affaire de ton, de justesse, mais aussi d'intention. Meret, dès les premières lignes, fait savoir au lecteur qu'il ne déteste ni mentir ni inventer. Car ce qui compte c'est faire passer ce qu'il y a à faire passer, ce qui compte c'est construire un regard poétique sur soi, car c'est bien au travers de celui-ci que l'on touchera le lecteur.
En la pausa, qui gagna le premier prix lors du concours de littérature autobiographique Indio Rico, décerné par Ricardo Piglia, Edgardo Cozarinsky et Maria Moreno, raconte l'histoire d'un apprenti écrivain, ouvrier dans une usine textile, né dans une maison où il n'y avait qu'un seul livre. Construit par fragments - les fragments de la pause - il narre avec humour, par circonvolutions, les préoccupations d'un écrivain en herbe, en quête à la foi d'une compréhension de lui-même et de la mémoire (une inconnue), et d'une compréhension (ou justification peut-être) de sa nécessité d'être écrivain et de sa nécessité aussi de "s'auto-romancer" en tant qu'écrivain "potentiel".
Où trouver ce qui nous rend romanesque ? Y a t'il une direction dans ce que je raconte ? Ces questions qui semblent naïves ou idiotes (plus d'une foi l'auteur se présente dans En la pausa comme un idiot, comme un type pas très intelligent), sont pourtant au cœur d'un récit sans effets autres que ceux qui naissent de l'étonnement même d'écrire. Comme chez Aurora Venturini, dont je parlais il y a quelques temps, chez Meret aussi on pourrait croire que la littérature vient de s'inventer. Et pourtant, non, elle est là, avec tout ce qu'il y a à lire (formidables pages où Meret nous parle de ses heures de lectures voraces, qui frôlent le pilotage automatique, heures volées à une vie quotidienne plombée par un travail omniprésent et épuisant), et elle est là aussi comme impulsion, comme appel, ainsi Meret se met à écrire là où il peut, quand il le peut : des poésies écrite à la craie sur la porte des toilettes de l'usine textile où il travaille.
La pause du titre, c'est cette espèce d'intermittence qui le prend et le fige, comme déconnecté du monde, à n'importe quel moment.
Récit touchant, dont le style faussement ingénu n'est pas sans évoquer le grand Felizberto Hernandez, c'est un de ces textes qui nous rappelle, si besoin était, que la littérature aujourd'hui peut encore dire le monde, dire le soi, dire le tout.
Je propose deux des ces "Fragments de la pause" traduit par mes soins :

L'écrivain
Il y a des choses qui me font penser que je ne suis peut-être pas un écrivain. Mais, au contraire, il y en a d'autres me font penser que si. Ça me donne du courage de savoir que ma mère assure que je suis meilleur que Borges. Mais ça m'en enlève de me douter que ma mère, comme tant d'autres qui à un moment ou un autre me l'ont recommandé (encore qu'elle ne me l'ai jamais spécialement recommandé), n'a évidement jamais lu Borges. Je viens d'avoir trente ans et la grande majorité de mes connaissances ne me considèrent toujours pas vraiment comme un écrivain. C'est pour ça que dès que l'opportunité se présente je dis que je suis en train d'écrire telle ou telle nouvelle, que j'ai commencé tel roman, ou alors je parle, le plus souvent sans arguments vraiment solides, de littérature. On peut dire que la plupart du temps j'exagère, je ment ou j'expose des théories obscures, bien obscures, de celles qui à la limite ne veulent rien dire. Parfois, je crois que si je disposais de suffisamment de temps je pourrais bel et bien être écrivain... et qu'arrivé là où j'en suis maintenant, j'aurais déjà écris la quantité de pages que j'aimerais bien avoir écrite. Quoi qu'il en soit, j'écris. Et écrire, au moins, me sauve d'un état d'horrible désespérance (si tant est que la désespérance puisse ne pas être horrible), car écrire veut dire que toutes ces années investies dans quelque chose d'inutile me sortiront avec un peu de chance un jour ou l'autre de la pause dans laquelle je vis. Et je le dis parce que ça au moins c'est vrai : je vis en pause. Je ne sent du mouvement que quand j'écris, encore que je ne sache pas très bien à quoi je fais référence avec ce mot de "mouvement". Et bien que je me sache limité mentalement, je suis sûr que l'intelligence ne produit pas dans tout les cas de la bonne littérature. La mienne n'est ni bonne ni mauvaise (ou peut-être qu'elle est mauvaise, mais je n'ai pas le courage de le dire), mais c'est une littérature faite sans intelligence, c'est une littérature faite contre la montre. C'est un vice que j'ai attrapé à cause de toutes ces années où j'étais ouvrier dans le textile. A une certaine époque, je me réjouissait de savoir que des écrivains comme Léonidas Lamborghini ou Andrés Rivera avaient été, comme moi, des ouvriers dans le textile (même si, bien entendu, l'ordre chronologique est nécessairement inverse). Maintenant, non, maintenant ce parallélisme ne me réjouis plus. D'un autre côté, c'est évident, pourquoi est ce que cela devrait me réjouir... et pourquoi devrais-je donc, moi, m'adjuger une place dans quelque parallélisme que ce soit. En plus, il y a eu un moment où m'est passé par la tête d'écrire quelque chose sur le lien entre littérature et industrie textile, mais rien n'en est sortis, entre autre raison parce que je n'ai jamais entendu parler d'un autre qui, tel Leonidas Lamborghini et Andres Rivera, aurait été écrivain et ouvrier dans le textile. Ce dont je n'ai jamais pu me défaire, c'est d'avoir à faire ce qu'il faut en terme de production. Il y a toujours eu le problème du temps. Maintenant, j'ai grandis, j'ai un enfant et j'ai un travail asphyxiant dans une administration publique. Je ne me plains pas, je sais ce que c'est que de ne pas avoir de travail. Mais si je n'écris pas, et ici je me permet un peu de mélodrame : je suis un malheureux. Alors je passe mon temps à rassembler les minutes qui me permettront de m'assoir ne serait-ce que pour salir une page ou une demi-page.
Elle me fait rire cette chose que je suis en train d'écrire. Je viens de la lire, on dirait un curriculum vitae. Et il me vient d'un coup à l'esprit qu'on ne fait jamais rien d'autre qu'écrire tout le temps son curriculum vitae. Ce serait donc comme ça que ça se passe ? Non. Je ne crois pas que ce soit comme ça. Mais bon, ça tourne en tout cas autour de quelque chose du genre. D'un autre côté, je dois admettre que mon parcours dans la vie a été jusqu'ici le classique parcours d'un lâche. Je n'arrête pas d'avoir peur. Je n'arrête pas de penser à ce que je vais faire. Je n'arrête pas de penser que je n'ai jamais fait ce que je pensais que j'allais faire.
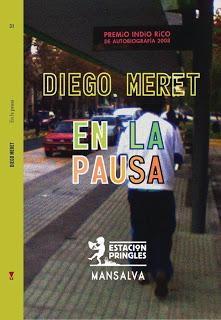
Peur
J'ai allumé l'ordinateur et je me suis assis sur le lit. Cette foi j'ai eu droit à la même chambre que celle d'il y a deux jours. Une chambre avec une table, une chaise et un lit. Ensuite je me suis mis sur le lit, j'ai appuyé la tête sur l'oreiller et j'ai fermé les yeux. Je n'ai pas regardé le réveil, mais j'ai du dormir quelque chose comme deux ou trois heures. En ouvrant les yeux, je ne me suis d'abord pas rendu compte d'où j'étais. Et je suppose que pas seulement où j'étais, mais aussi qui j'étais... et même comment j'étais arrivé ici, jusqu'à un tel état d'évanescence... comme si j'avais découvert, d'une certaine manière, que j'avais des yeux. Ce qui fait que la désorientation n'était pas seulement spatiale, mais aussi temporelle... et en plus d'un sens... comme celui qui ouvre les yeux, d'un coup, assit sur la terrible quiétude d'un siège de bus. J'ai eu la sensation d'être allé trop loin par rapport à moi-même. Mais trop loin d'où. De quoi étais-je allé trop loin. Bien sûr que tout de suite je me suis rappelé où j'étais, mais je m'en suis rappelé dans une espèce de présent. Je veux dire que ça n'a pas été précisément ce qu'on appelle se rendre compte. C'est de moi-même que je me suis rappelé. Ce qui ne veut pas dire que je me sois rappelé mon arrivé à l'hôtel... et pas plus certain détails de la chambre... ça a été comme se rappeler - de temps en temps j'aime exagérer - en nageant dans une réflexion endormie et soporifique, chacune des secondes que j'avais vécu jusqu'ici. Se rappeler de tout et de rien : voilà comment on se remémore au présent. Je me suis rappelé de moi-même à l'hôtel et j'étais dans l'hôtel. Alors je me suis levé, je me suis frottés les yeux, j'ai marché jusqu'à l'ordinateur et j'ai noté : "on se rappelle aussi au présent". J'ai éteins la machine et je l'ai rangée dans le sac. Ensuite je suis sortis de la chambre, je suis descendu dans le hall, j'ai salué Golo, dont je doute qu'il ait répondu à mon salut, et je suis partis. Il faisait froid... et le ciel était si noir et il y avait tant d'étoiles, que j'ai eu l'impression d'être un insecte.
